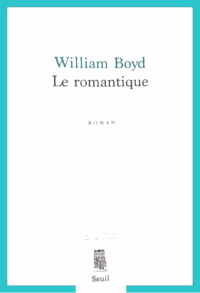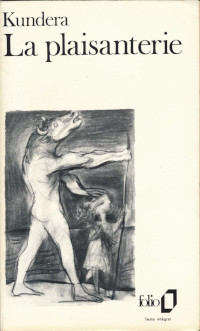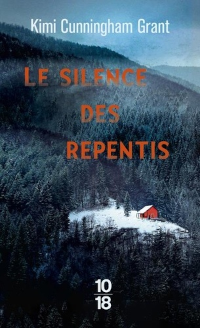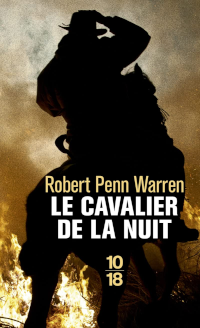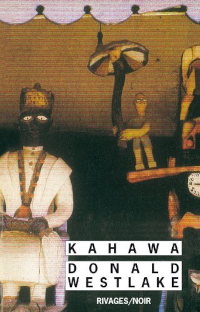
Il y a eu récemment deux émissions radios sur FC (redifusions) sur cet auteur de polars américain qui fait partie des grands maîtres du genre. Il a la particularité d’avoir utilisé plusieurs pseudonymes pour ses romans, mettant en scène des personnages très différents, et pratiquant l’humour dans un genre plutôt noir à priori. Bref, un auteur qui brouille les pistes.
Il en ressortait qu’un très bon roman mentionné dans l’émission était sur mon étagère, je me suis empressé de le relire, et ce fût un vrai plaisir, n’ayant gardé que peu de souvenirs de ma précédente lecture, il y a longtemps !
C’est d’ailleurs un des bons côtés du temps qui passe, les bouquins accumulés sur les étagères, mis en cartons et transportés au cours des différents déménagements d’une vie en se demandant si ça vaut la peine, commencent enfin à porter leurs fruits : si on ne se souvient pas l’histoire en détail, on se souvient qu’un roman vous avait plu ou pas, et venir piocher dedans est très agréable (et économique) !
Ici ce n’est pas vraiment un polar, Westlake nous proposant cette fois un roman d’aventure : le casse du siècle dans l’Ouganda d’Idi Amin Dada ! Il s’agit tout simplement de faire disparaître un train transportant toute la récolte de café du terrible dictateur. Valeur : six millions de dollars. De quoi attirer des convoitises, mais aussi des coups tordus, sans parler du danger à opérer à portée de la police secrète d’Idi Amin et de son « State Research Bureau », un endroit où il ne vaut mieux pas être emmené pour interrogatoire…
Le roman démarre au tout début de la préparation du projet, ce qui nous permet de découvrir les différents personnages impliqués, et nous laisse le temps de découvrir leurs personnalités, leurs motivations, de nous les faire aimer ou pas. Car on ne fait pas disparaître un train comme ça ! Mais quand l’opération proprement dite démarre, on reste scotché au bouquin jusqu’à la fin… Suspense garanti !
Cerise sur le gâteau, la traduction est de Jean-Patrick Manchette, gage d’une bonne traduction ! Selon lui, Westlake fait d’ailleurs partie des grands auteurs de polars américains :
On vibre avec Stark, on rumine amèrement avec Tucker Coe, et on rigole le plus souvent avec Westlake, quoique cette dernière et première signature soit celle qui réserve, et se réserve, le plus de surprises.
Ceux qui manquaient de hauteur ont voulu s’élever au-dessus de leur genre. La grandeur de Westlake est de travailler toujours contre sa propre élévation.
Donald Westlake (1933-2008) est un écrivain et scénariste américain, également connu sous de nombreux pseudonymes (Richard Stark, Alan Marshall, Tucker Coe …). Ses personnages les plus connus sont John Dortmunder, voleur brillant mais terriblement malchanceux (signature : Donald Westlake), et Parker, un personnage beaucoup plus sombre, sans états d’âme, brutal et violent (signature : Richard Stark).