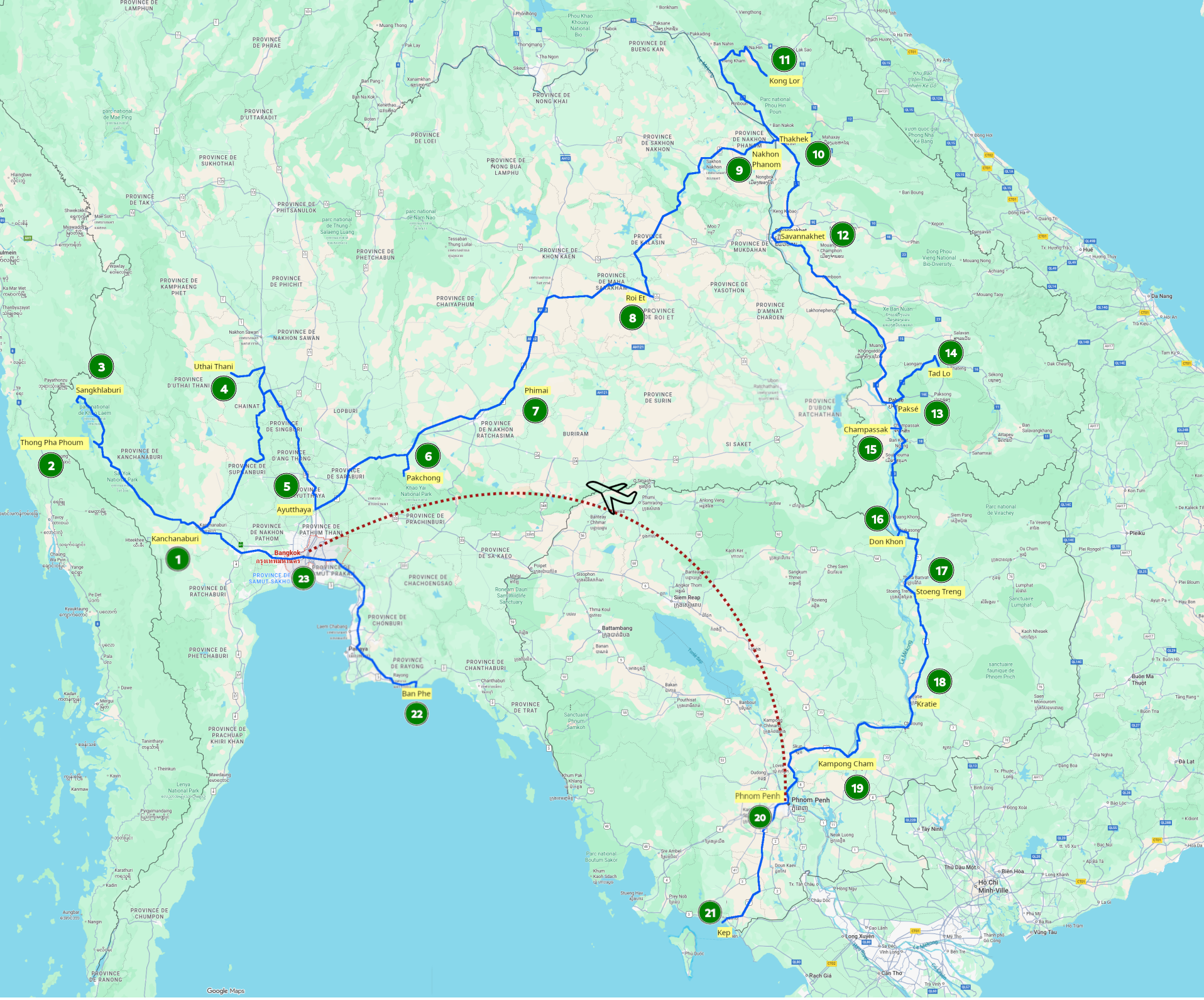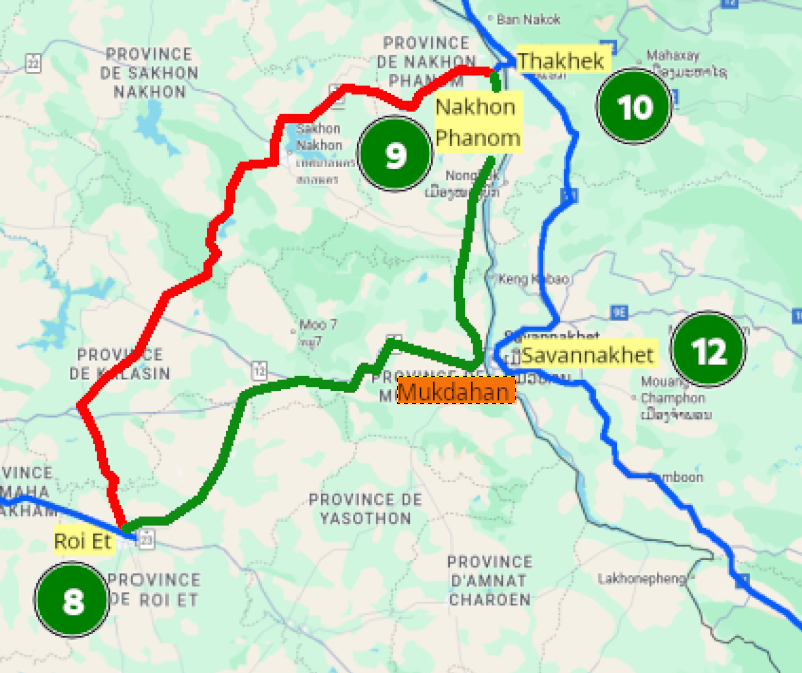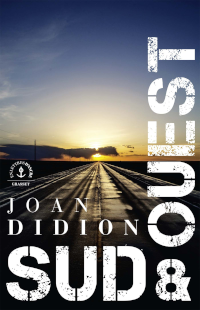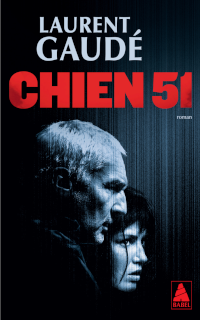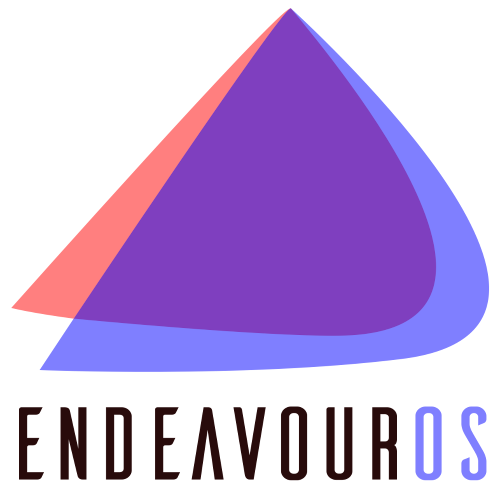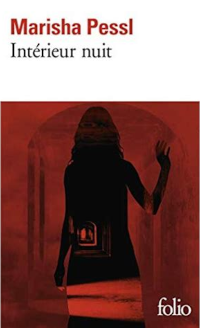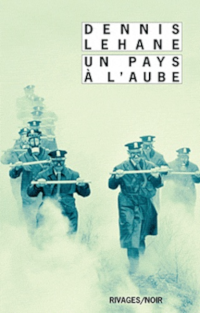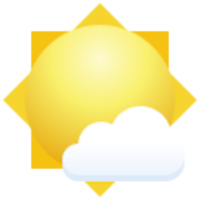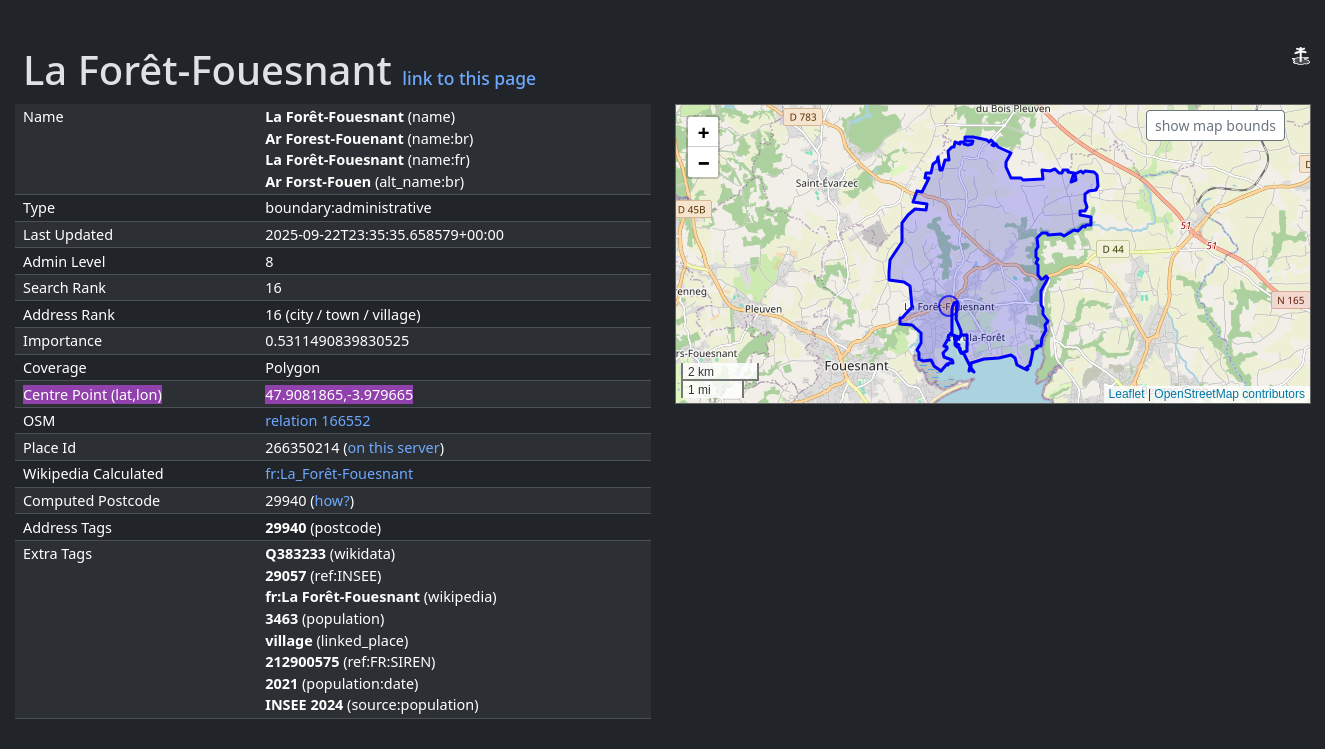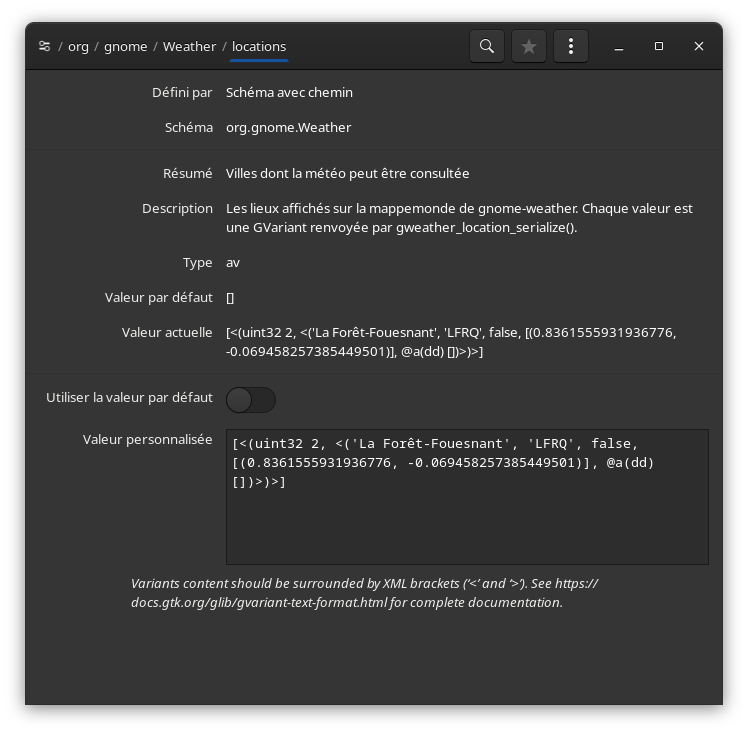Voilà un livre choisi au hasard chez le libraire, et qui s’est révélé être une très bonne surprise.
Je ne trouvais rien qui me plaisait ou m’attirait au rayon Littérature, je suis alors allé voir côté romans policiers, et j’ai regardé celui-là : la collection Rivages/Noir est une référence, et l’épaisseur du livre me convenait (856 p, je cherchais un gros roman pour mieux m’y plonger). Le quatrième de couverture parlait de l’après première guerre mondiale aux États-Unis, de problèmes raciaux ainsi que d’infiltration des milieux anarchistes… Tout cela m’a convaincu !
Ma première impression, c’est que c’est un vrai roman, pas un simple roman policier même si le personnage principal est flic ; c’est très bien écrit, avec une histoire bien prenante, et où l’auteur s’est bien documenté sur l’époque, ce qui ajoute toujours de l’intérêt au récit je trouve.
Le premier sujet abordé, c’est le racisme : ce dernier est omniprésent dans les rapports sociaux, et les noirs ont intérêt à rester à leur place ! À cette époque, on peut parler de ségrégation même si la situation peut différer d’un état à l’autre. Leurs droits sont réduits au minimum, et un blanc à tout pouvoir au moindre prétexte. Luther Laurence, jeune ouvrier noir de l’Ohio, en fera l’expérience dès le début du roman au cours d’une partie de base-ball improvisée avec des joueurs professionnels (blancs bien sûr) dont le train est en panne, et qui se font malmener par ces jeunes noirs pour qui le base-ball est un jeu… Mais peuvent-ils battre des blancs pour autant ?
Luther va finir par se retrouver à Boston, dans un climat d’après-guerre avec des policiers à peine payés qui ne peuvent nourrir leur famille, et menacent de se syndiquer ou pire de faire grève (une hérésie pour l’establishment). Tout cela dans un milieu social très tendu, avec des anarchistes, émigrés pour la plupart, qui veulent s’en prendre au système capitaliste tellement inégalitaire dans cette période d’immense pauvreté. L’agent Danny Coughlin, pourtant issu d’une famille de nantis, va se retrouver malgré lui à mener le mouvement contestataire, face à un chef de la police qui ne pense qu’à les réprimer (l’occasion aussi de voir brièvement J.E. Hoover encore tout jeune commencer à dresser ses listes de citoyens et à combattre « le péril rouge »). Tout cela va dégénérer en terribles émeutes. Luther et Danny vont se lier d’amitié au milieu de tous ces dangers.
Une histoire très prenante, d’autant qu’elle se base sur évènements qui ont vraiment eu lieu, décrivant une époque pas forcément connue, comme celle du mouvement anarchiste et de la montée du syndicalisme.
Dennis Lehane, né en 1965 à Boston, est un écrivain d’origine irlandaise, et auteur de romans policiers, dont le cadre est presque exclusivement la ville de Boston. Ses romans ont été plusieurs porté à l’écran :
- 2003 : Mystic River de Clint Eastwood
- 2007 : Gone Baby Gone de Ben Affleck
- 2010 : Shutter Island de Martin Scorsese
- 2014 : Quand vient la nuit (The Drop) de Michaël R. Roskam
- 2016 : Live by Night de Ben Affleck
Tout ça me donne envie de mieux découvrir cet auteur. Je lirais bien Mystic River par exemple, dont Eastwood a tiré un film très fidèle au roman. Et la bonne nouvelle, c’est que Un pays à l’aube est le premier d’une trilogie « Coughlin » : il est suivi de Ils vivent la nuit puis de Ce monde disparu. De bons moments de lecture en perspective !