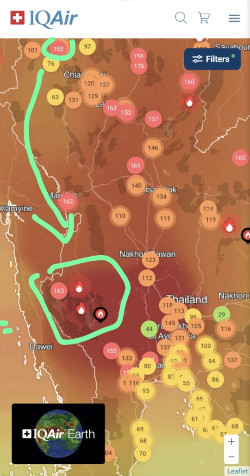Livre conseillé par une bonne âme à ma sœur, premier roman d’une saga de 5 tomes. En ce qui me concerne, je m’arrêterai là, pas du tout convaincu par ce premier opus, pour dire le moins.
L’histoire est pourtant propice à un grand roman : on retrouve le Vienne décrit par Stéphan Zweig dans Le monde d’hier. La ville où rayonne la liberté et la culture va basculer sous l’emprise du nazisme et de l’anti-sémitisme. Suivra un exil dans une République bananière qui aurait pu prolonger un récit somme toute tragique. Mais non, l’auteure a choisit de se focaliser sur l’aspect romance, hélas contrariée par les événements mondiaux.
C’est donc l’histoire de Wilhelm et Alma : lui est journaliste issu d’une famille de la classe moyenne, elle a suivi des études de dentiste et est issue de la haute bourgeoisie viennoise. Ils tombent éperdument amoureux l’un de l’autre et se marient rapidement. Alors que l’Allemagne d’Hitler étend son emprise sur le pays, ils coulent des jours heureux et insouciants, jouissant de leurs privilèges, aveugles au danger qui approche, malgré des signaux évidents qui poussent la sœur de Wilhelm et son mari à émigrer aux États-Unis.
Premier questionnement sur le récit : on a l’impression que l’auteure veut tellement nous raconter avec forces détails historiques l’évolution de la situation à Vienne (prouvant ainsi le sérieux de l’écrivain) qu’elle force ses personnages à y rester beaucoup plus longtemps que raisonnable. La seule raison donnée tient en une phrase d’Almah : « pas sans les parents ». Sauf que les parents, d’une autre génération, ont décidé de rester quoiqu’il arrive. Le sujet n’est plus évoqué par ailleurs…
Wilhelm et Almah vont partir très tard (en 1939, alors que Zweig est parti en 1934 : pour un journaliste Wil n’est pas très futé !), quand ça devient très compliqué et que les États-Unis ont depuis longtemps fermé leurs frontières. Le couple va donc se trouver par un concours de circonstances dans une espèce de Kibboutz en République Dominicaine, sous l’œil bienveillant du dictateur Trujillo, dont je connaissais l’histoire avec l’excellent La fête au Bouc de Mario Varga LLosa. L’histoire de ces colons juifs à Sosúa est par ailleurs véridique.
Au passage, si l’on compare ces deux livres, le talent d’écrivain de Mario Varga Llosa saute aux yeux et la comparaison fait mal à l’auteure de ce roman, manifestement dépassée par son sujet.
Il y a beaucoup de choses qui m’ont déçu dans ce roman, en premier lieu ce mélange entre la grande Histoire et la romance de nos deux personnages. La matière a un grand récit est là, et pourtant l’auteure ne réussit jamais à les fondre en un tout homogène, soit elle se concentre sur la première (disons la partie à Vienne), soit sur la seconde (toute la partie à Sosúa où on est résolument passé dans la petite histoire et où la grande (la dictature de Trujillo par exemple, ou même la difficulté à établir une colonie en partant de rien) est presque totalement absente.
Le récit est à la première personne (Wil) sauf de temps en temps où l’auteure reprend la main, c’est un peu surprenant et pas très plaisant à la lexture ; d’autres fois c’est le journal de Wil qui n’apporte vraiment que peu d’intérêt… Les chapitres sont très courts (mauvais signe), et sont affublés d’un titre tout aussi inutile que ridicule (en général le mot clef du chapitre en question). Même l’aspect romance est assez mièvre est caricatural dans l’ensemble.
J’arrête mes critiques ici, ce n’est vraiment pas le genre de littérature que je recherche. À classer dans la surproduction de romans qui encombrent les tables des libraires, compliquent le choix des lecteurs, et pour lesquels on abat des arbres.
Catherine Bardon ne dispose pas d’une page Wikipedia. Elle a apparemment travaillé longtemps pour des guides touristiques et est tombée sous le charme de la République Dominicaine. Après une carrière dans la communication, elle se consacre désormais à l’écriture. 😥