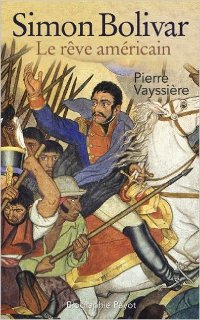 Quand j’avais lu Le général dans son labyrinthe de Gabriel Garcia Marquez, je m’étais dit qu’une biographie de Simon Bolivar devait être passionnante. J’ai donc regardé ce qui existait : rien de disponible en format poche, je me suis donc rabattu sur ce livre, écrit par un historien.
Quand j’avais lu Le général dans son labyrinthe de Gabriel Garcia Marquez, je m’étais dit qu’une biographie de Simon Bolivar devait être passionnante. J’ai donc regardé ce qui existait : rien de disponible en format poche, je me suis donc rabattu sur ce livre, écrit par un historien.
Et c’est un peu là le problème, Pierre Vayssière a choisi une approche thématique (l’homme politique, le chef de guerre, le mythe, etc..), là où j’aurai préféré une simple chronologie de sa vie, particulièrement l’histoire de ses conquêtes, qui n’occupe finalement que soixante dix pages de ce gros volume.
Le reste n’est pour autant ni inutile, ni inintéressant, loin de là : on cerne mieux le personnage complexe grâce à lui : ses origines, ses motivations, la part du mythe dans ce personnage au destin incroyable, surnommé « el Libertador », encore aujourd’hui célébré (et récupéré) dans toute l’Amérique latine ; il a même donné son nom à tout un pays, la Bolivie. Mais pour la partie conquête, je suis resté largement sur ma faim…
Alors comment résumer cette histoire ? Il reste avant tout l’homme qui libéra plusieurs pays de trois siècles de colonisation espagnole : Venezuela, Colombie, Équateur, et même le Pérou (pour ce dernier, il lui faudra franchir la cordillère des Andes dans des conditions proprement incroyables). Hélas, son rêve d’unification fera long feu, et les caudillos locaux, les luttes politiques y mettront fin rapidement.
Héritier du siècle des Lumières par son éducation et ses lectures, témoin des « révolutions atlantiques » aux États-Unis et en Europe, son rêve est d’unifier les pays d’Amérique latine, profitant du déclin de l’Empire espagnol mis à mal par Napoléon. Comme ce dernier (dont il est un fervent admirateur), Simon Bolivar est un républicain convaincu, mais partisan d’un pouvoir fort. Il est issu d’une riche famille créole (élite blanche, dont les origines remontent au pays basque), et se dit libéré de tout préjugé racial (il serait blanc métissé d’indien par son grand-père et en partie mulâtre par sa grand-mère). Il est de nature chétive, mais aussi un grand séducteur aimé des femmes.
Il faut dire que la société sud-américaine fonctionne comme un système de castes, fruit de trois siècles de colonisation ; entre les blancs, les créoles, les esclaves noirs et les indiens, il n’est pas simple de s’y retrouver, et de comprendre qui veut quoi… Comme à Cuba, on retrouve la réticence des grands propriétaires à libérer les esclaves, et Bolivar est issue d’une telle famille. Pourtant, Simon Bolivar réforme, mais plus par opportunisme, comme par exemple en libérant les esclaves noirs à condition qu’ils se battent avec lui, un marché qui ne les tente guère.
Pour conclure, le personnage reste tout de même sympathique, au regard de ce qu’il a accompli, même si le bilan est contrasté. Il est également surnommé « Le Don Quichotte de l’Amérique », ce qui résume assez bien le personnage. Il avait soif de gloire, mais pas de pouvoir.
Pierre Vayssière n’a pas de page wikipedia ! Il est un historien spécialiste de l’Amérique latine, professeur émérite de l’Université de Toulouse II, et selon bibliomonde, franchement marqué à droite :
Pierre Vayssière offre une vision conservatrice de l’Amérique latine. Ses ouvrages proposent une image systématiquement défavorable des mouvements de gauche du sous-continent et au contraire ont tendance à minimiser les méfaits des dictatures et de l’interventionnisme nord-américain.
Dans le cadre de cette biographie, cela a peu d’importance : George Washington avait signé un pacte de neutralité avec Madrid… mais Simon Bolivar se méfiait (déjà) de leur expansionnisme.
 Tout d’abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016 à toutes et à tous passant sur ce blog, par hasard ou pas…
Tout d’abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016 à toutes et à tous passant sur ce blog, par hasard ou pas…
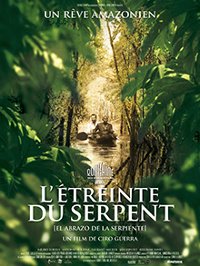 « Un rêve amazonien » est-il indiqué en haut de l’affiche… Il y est bien question de rêve, mais d’une sorte bien particulière, le rêve initiatique qui t’apprend qui tu es… Dès les premières images de ce film en noir et blanc, on est transporté dans un autre monde, au fin fond de l’Amazonie colombienne, et plus l’histoire va se dérouler, plus ce monde va nous paraître étrange…
« Un rêve amazonien » est-il indiqué en haut de l’affiche… Il y est bien question de rêve, mais d’une sorte bien particulière, le rêve initiatique qui t’apprend qui tu es… Dès les premières images de ce film en noir et blanc, on est transporté dans un autre monde, au fin fond de l’Amazonie colombienne, et plus l’histoire va se dérouler, plus ce monde va nous paraître étrange…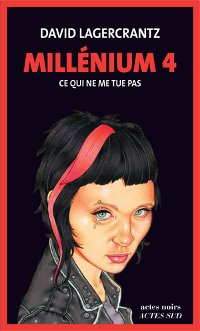 Voici la fameuse suite à la trilogie de Stieg Larsson, tant attendue puisque son auteur fut victime d’une crise cardiaque avant la parution de son œuvre…
Voici la fameuse suite à la trilogie de Stieg Larsson, tant attendue puisque son auteur fut victime d’une crise cardiaque avant la parution de son œuvre…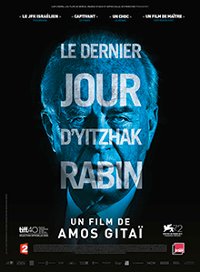 Ce film retrace l’enquête qui suivit l’assassinat de
Ce film retrace l’enquête qui suivit l’assassinat de 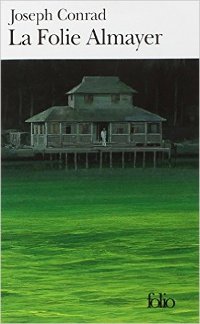 Retour à Joseph Conrad, avec son premier roman, celui qui le consacra comme écrivain… auprès des connaisseurs et des critiques essentiellement ! Car lors de sa sortie, le livre se vendît peu auprès du public, et encore aujourd’hui, ne fait pas partie de ses œuvres majeures.
Retour à Joseph Conrad, avec son premier roman, celui qui le consacra comme écrivain… auprès des connaisseurs et des critiques essentiellement ! Car lors de sa sortie, le livre se vendît peu auprès du public, et encore aujourd’hui, ne fait pas partie de ses œuvres majeures.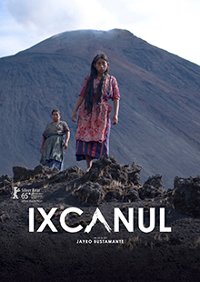 Encore un très bon film, V.O. en langue Maya (ce qui doit être assez rare), ce qui se révélera être la clef du film lors de l’épilogue que je n’ai pas vu venir et qui m’a laissé coi !…
Encore un très bon film, V.O. en langue Maya (ce qui doit être assez rare), ce qui se révélera être la clef du film lors de l’épilogue que je n’ai pas vu venir et qui m’a laissé coi !…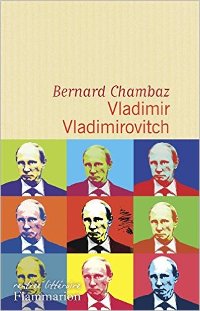 Bouquin offert par mon libraire (« sans aucune garantie, je ne l’ai pas lu… ») avant que je ne déménage ; sur la marge, il est écrit « Exemplaire offert »…
Bouquin offert par mon libraire (« sans aucune garantie, je ne l’ai pas lu… ») avant que je ne déménage ; sur la marge, il est écrit « Exemplaire offert »…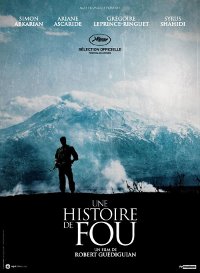 Encore un film qui m’a bien plu, merci à la bonne programmation du TNB de Rennes.
Encore un film qui m’a bien plu, merci à la bonne programmation du TNB de Rennes.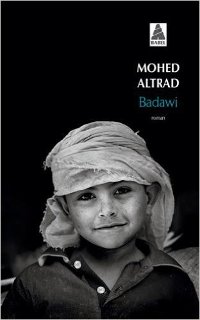 Je crois que c’était lors d’un reportage de Stade2 qui présentait le portrait pour le moins atypique de ce chef d’entreprise, également premier actionnaire et président du Montpellier Hérault Rugby. L’homme avait un parcours incroyable (fils de bédouin syrien), un discours très humble et reconnaissant à la France dont il a pris la nationalité.
Je crois que c’était lors d’un reportage de Stade2 qui présentait le portrait pour le moins atypique de ce chef d’entreprise, également premier actionnaire et président du Montpellier Hérault Rugby. L’homme avait un parcours incroyable (fils de bédouin syrien), un discours très humble et reconnaissant à la France dont il a pris la nationalité.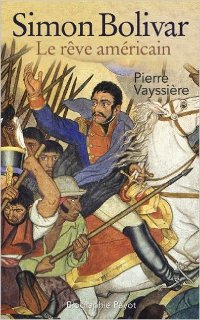 Quand j’avais lu
Quand j’avais lu