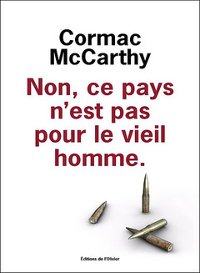 Je connaissais le film des frères Coen, excellent, avec ce tueur en série réellement effrayant qui se ballade avec sa bouteille d’oxygène et son pistolet à tige utilisé dans les abattoirs ! Brrr, d’autant qu’il semble toujours avoir une longueur d’avance sur tous les autres…
Je connaissais le film des frères Coen, excellent, avec ce tueur en série réellement effrayant qui se ballade avec sa bouteille d’oxygène et son pistolet à tige utilisé dans les abattoirs ! Brrr, d’autant qu’il semble toujours avoir une longueur d’avance sur tous les autres…
Et c’est un copain qui m’a prêté le bouquin qui a inspiré ce film. L’auteur, j’ai déjà lu un roman de lui : La route ; j’avais bien aimé, tout en notant une forte dose de chrétienté et de Châtiment Divin dans ce roman post-apocalyptique.
J’avais aussi noté un choix de traduction un peu surprenant : l’utilisation de « et » dans les énumérations, chose qui se fait en anglais, mais pas vraiment en français… Et comme c’est le même traducteur qui est à l’œuvre ici, on retrouve très souvent ce genre de phrases que je trouve personnellement plutôt lourdingues :
L’homme fait jouer la serrure d’un tiroir du bureau et en sort un coffret en acier et l’ouvre et en sort une carte et rabat le couvercle et ferme le coffret à clef et le range.
Et des phrases comme ça, il y en a des centaines, car le style de l’auteur est assez brut, très précis sur les gestes et actions des personnages du roman. Idem pour les dialogues, des phrases courtes, sèches, où l’on répond du tac au tac sans fioritures. Ne vous attendez pas à de grandes envolées littéraires, mais plutôt à des réflexions sur la vie en quelques mots bien sentis… Par contre, l’histoire est assez prenante, et l’on est assez vite accroché au récit, à espérer que Moss va quand même réussir à échapper aux tueurs à ses trousses.
Ce ne sera pas le cas, et sa mort est annoncée assez abruptement, sans que la scène ait été écrite. On l’apprend quand les flics arrivent sur la scène de crime, sans savoir de qui il s’agit (comme dans le film).
Et puis il y a le shérif Bell qui suit tout ça, complètement désabusé sur l’époque et sa violence, sur ce qu’est devenu son pays… Il démissionnera d’ailleurs, écœuré par l’impuissance ressentie à lutter contre le mal. On retrouve d’ailleurs, toutefois à dose plus légère, la référence à Dieu qui a abandonné le monde, et l’idée que la perte du sentiment religieux est responsable de cet état de fait.
À part ça, le film suit assez fidèlement le bouquin, ce qui est assez rare pour être signalé. Il y a juste l’auto-stoppeuse que prend Moss qui a disparue, dommage car leurs dialogues étaient intéressants, Moss essayant de raisonner la jeune fugueuse et de lui expliquer qu’on ne repart jamais vraiment de zéro, comme en partant en stop vers la Californie pour fuir ses parents.
Un bon polar, noir à souhait, à l’écriture toutefois un peu surprenante (et pas seulement par la traduction) : les dialogues ne sont pas franchement marqués, sauf par des retours à la ligne, mais se mêlant parfois à la narration. Mais bon on s’y fait.
Cormac McCarthy est né en 1933 à Providence (Etats-Unis). Reconnu comme l’un des écrivains majeur de son époque, il a reçu le prix Pulitzer en 2007 pour «La route».«No country for old men» date de 2005. Il est hanté par la violence des hommes et la question du Mal (Nathalie Crom – Télérama). Son meilleur livre serait Méridien de sang (Blood meridian) : un gamin au Texas qui se retrouve avec des chasseurs d’indiens, plongé dans un monde où seuls les plus violents survivent («sorte d’anti-western basé sur des faits réels. Noir, lyrique, et violent»). Et même très violent parait-il.
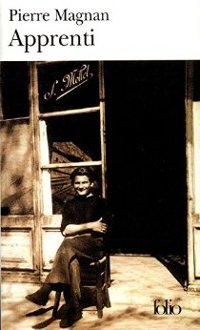 J’ai acheté ce livre à la librairie Le Bleuet du petit village de Banon (Alpes-de-Haute-Provence). Étonnant de trouver une librairie de cette taille dans un si petit village… Il semblerait qu’en 2010, le propriétaire ait eu les yeux plus grand que le ventre en voulant s’agrandir pour s’adapter à la vente en ligne. Ce fut le début de problèmes financiers, aboutissant à la vente de la librairie, qui reste tout de même la plus grande librairie française indépendante en milieu rural.
J’ai acheté ce livre à la librairie Le Bleuet du petit village de Banon (Alpes-de-Haute-Provence). Étonnant de trouver une librairie de cette taille dans un si petit village… Il semblerait qu’en 2010, le propriétaire ait eu les yeux plus grand que le ventre en voulant s’agrandir pour s’adapter à la vente en ligne. Ce fut le début de problèmes financiers, aboutissant à la vente de la librairie, qui reste tout de même la plus grande librairie française indépendante en milieu rural.
 Même si la baie Synology que j’utilise contient deux disques en miroir, ce qui réduit fortement le risque de perte de données, ce n’est pas une raison pour ne pas sauvegarder les données de celle-ci.
Même si la baie Synology que j’utilise contient deux disques en miroir, ce qui réduit fortement le risque de perte de données, ce n’est pas une raison pour ne pas sauvegarder les données de celle-ci.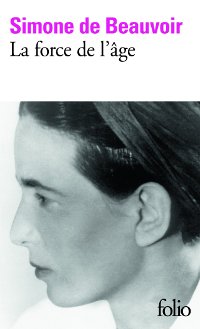 Après
Après 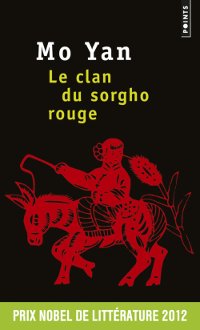 J’avais bien aimé les deux autres romans que j’ai lu de cet auteur :
J’avais bien aimé les deux autres romans que j’ai lu de cet auteur : 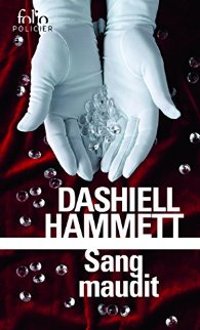 C’est en écoutant une émission sur France Culture que j’ai entendu parler de cet auteur considéré comme le créateur du roman noir américain, pionnier de la « hard-boiled school », soit « l’école des durs à cuire », en référence aux personnages violents et apparemment dépourvus de sensibilité qui fourmillent dans ses histoires ; cela changeait des Miss Marple ou Hercule Poirot !
C’est en écoutant une émission sur France Culture que j’ai entendu parler de cet auteur considéré comme le créateur du roman noir américain, pionnier de la « hard-boiled school », soit « l’école des durs à cuire », en référence aux personnages violents et apparemment dépourvus de sensibilité qui fourmillent dans ses histoires ; cela changeait des Miss Marple ou Hercule Poirot ! Il y a deux semaines, je suis passé à Ubuntu 16.04. Cette fois, je n’ai pas fait de mise à jour, mais une installation propre, profitant de passer à une version LTS (Long Term Support), et probablement d’y rester jusqu’à la prochaine.
Il y a deux semaines, je suis passé à Ubuntu 16.04. Cette fois, je n’ai pas fait de mise à jour, mais une installation propre, profitant de passer à une version LTS (Long Term Support), et probablement d’y rester jusqu’à la prochaine.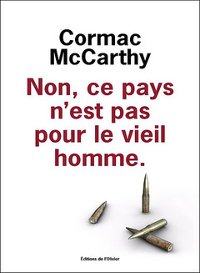 Je connaissais le film des frères Coen, excellent, avec ce tueur en série réellement effrayant qui se ballade avec sa bouteille d’oxygène et son pistolet à tige utilisé dans les abattoirs ! Brrr, d’autant qu’il semble toujours avoir une longueur d’avance sur tous les autres…
Je connaissais le film des frères Coen, excellent, avec ce tueur en série réellement effrayant qui se ballade avec sa bouteille d’oxygène et son pistolet à tige utilisé dans les abattoirs ! Brrr, d’autant qu’il semble toujours avoir une longueur d’avance sur tous les autres…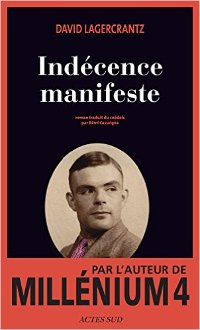 Cadeau offert par des amis, après avoir lu de concert
Cadeau offert par des amis, après avoir lu de concert 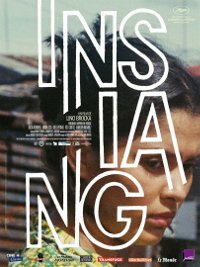 Insiang est le premier film philippin à avoir été sélectionné au Festival de Cannes en 1978. Le film avait été tourné en huit jours dans le bidonville de Manille ! Ici il s’agit d’une version restaurée (numérisée 4K) et présentée à Cannes Classics en 2015.
Insiang est le premier film philippin à avoir été sélectionné au Festival de Cannes en 1978. Le film avait été tourné en huit jours dans le bidonville de Manille ! Ici il s’agit d’une version restaurée (numérisée 4K) et présentée à Cannes Classics en 2015. Je suis allé voir ce film sans avoir aucune information préalable, sur la simple proposition d’un ami. Je suis donc entré dans la salle sans à priori, ne connaissant ni le réalisateur, ni le sujet… rien de rien !
Je suis allé voir ce film sans avoir aucune information préalable, sur la simple proposition d’un ami. Je suis donc entré dans la salle sans à priori, ne connaissant ni le réalisateur, ni le sujet… rien de rien !