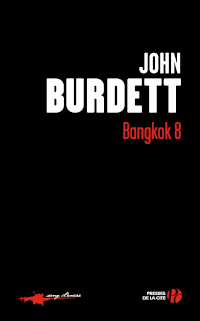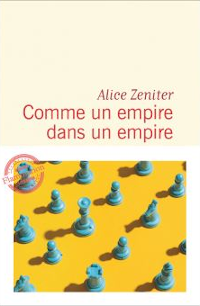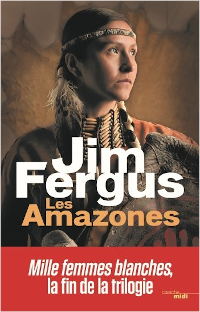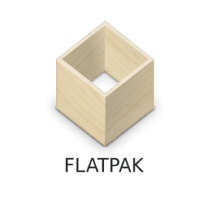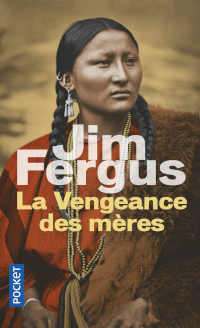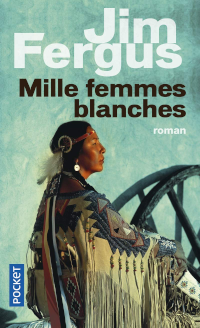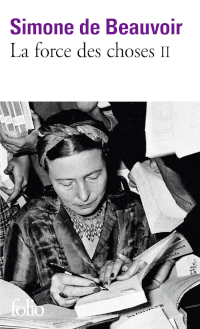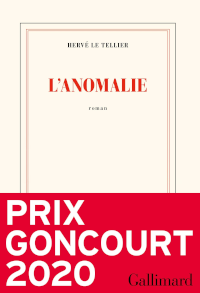
C’est plutôt rare que je lise le prix Goncourt de l’année avant la fin de celle-ci… Comme quoi tout arrive, et aussi qu’il est inutile de se précipiter, car ce n’a pas été un grand moment de lecture ! 😉
J’en avais entendu le ‘pitch’ à la radio : le même avion atterri deux fois à New-York, avec les mêmes passagers, à quelques mois d’intervalle… Un scénario digne d’un roman de science-fiction ; cela avait achevé de me décider.
Bien que la lecture soit agréable, je n’y ai rien trouvé de bien remarquable, pas plus dans le style que dans le récit, auquel je n’ai finalement pas du tout accroché. Cela ne fait que confirmer mes doutes sur ces prix littéraires : si c’est le meilleur roman de l’année, alors il y a de quoi s’inquiéter ! Par contre Gallimard a de quoi se réjouir…
Le premier tiers consiste en une galerie de portraits rapidement tracés, où les personnages ont en commun d’avoir pris ce vol Paris-NY. Le problème est que ces personnages manquent de profondeur, et l’on s’ennuie déjà en passant de l’un à l’autre.
La partie centrale est l’analyse du problème, par les scientifiques, le FBI, etc… Là, l’auteur hésite à basculer dans la farce, entre les procédures de sécurité établies par de jeunes scientifiques dignes de potaches, le niveau des réactions du président des États-Unis (manifestement, l’auteur avait tablé sur une réélection de Trump) : l’histoire perd en intérêt, et je commence à me demander si tout cela ne va pas se terminer par une jolie pirouette !
La troisième partie s’applique à traiter les différentes réactions de chaque personnage désormais dédoublé. Il y en pour tous les goûts, à chacun de faire son marché. On peine à reconnaître les individus de la première partie. Je ne vais pas spoiler la fin… Disons que c’est du niveau d’une nouvelle de SF.
C’est finalement l’auteur qui parle le mieux de son livre, puisque parmi les personnages, il y a un écrivain qui a écrit un livre intitulé « L’anomalie »… En général, ce genre d’introspection ou de mise en abîme ne me plaît pas trop, je trouve que cela reflète un manque d’imagination de l’auteur, ou un quant-à-soi bien parisien. Bref, voilà ce qu’il écrit :
Victor vient de poser le dernier mot au court livre qui raconte l’avion, l’anomalie, la divergence. Comme titre il a pensé à Si par une nuit d’hiver deux cent quarante-trois voyageurs – et Anne a secoué la tête –, puis il a voulu en faire l’incipit – et Anne a soupiré. Ce sera finalement un titre bref, un seul mot. Hélas, L’Anomalie était déjà pris. Il ne tente pas d’expliquer. Il témoigne, avec simplicité. Il n’a retenu que onze personnages, et devine qu’hélas, onze, c’est déjà beaucoup trop. Son éditrice l’a supplié, Victor, pitié, c’est trop compliqué, tu vas perdre tes lecteurs, simplifie, élague, va à l’essentiel. Mais Victor n’en fait qu’à sa tête. Il a attaqué le roman avec un pastiche à la Mickey Spillane, à propos de ce personnage dont nul ne sait grand-chose. Non, non, pas assez littéraire pour un premier chapitre, lui a reproché Clémence, quand cesseras-tu de jouer ? Mais Victor est plus joueur que jamais.
Allez à l’essentiel… oui, encore faudrait-il qu’il y en ait un ! Bref, décevant pour un prix Goncourt.
Hervé Letellier, né en 1957, est un auteur français de romans, nouvelles, poésies, théâtre. Il semble assez prolifique.