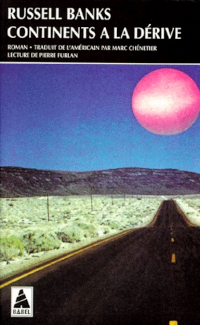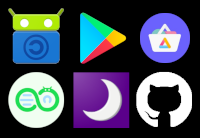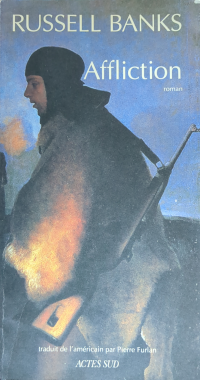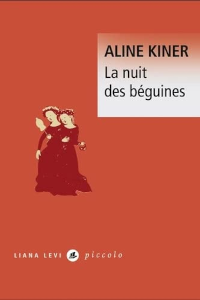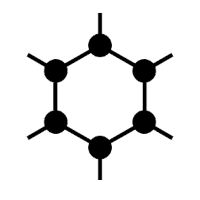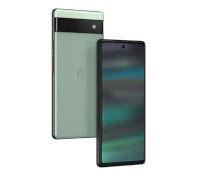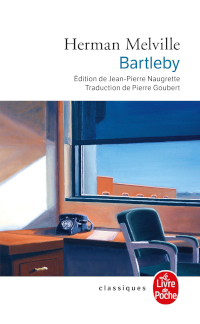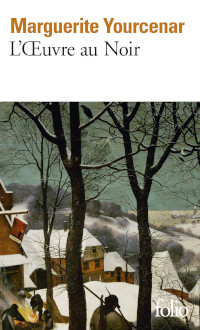Ayant lu et apprécié les Mémoires d’Hadrien (1951), premier grand succès de l’autrice, je ne pouvais faire l’impasse sur cet autre roman historique, clé de voûte de son œuvre si l’on en croit Wikipedia.
Cette fois, nous sommes transportés au Moyen-Âge, en Flandres au XVIème siècle, dans une époque assez agitée entre les guerres de territoire et celles de religion. Tout cela est d’ailleurs un peu compliqué à suivre, entre les catholiques et les protestants (réformes calviniste et luthérienne), et la réforme radicale avec ses anabaptistes. Ces derniers, mêlant révolte religieuse et sociale, et s’écartant un peu trop du dogme officiel, seront d’ailleurs massacrés par l’armée coalisée des princes, défenseurs du Saint-Empire romain germanique.
Une préface donnant les bases du contexte historique n’aurait vraiment pas été superflue ! D’habitude, je râle quand les préfaces dévoilent l’histoire et regrette qu’elles n’aient pas été des postfaces : pour une fois c’est l’inverse ! Heureusement, les notes de l’auteur en fin d’ouvrage aident un peu ; on y trouve aussi les « Carnets de notes » que l’auteur a tenu à faire incorporer aux éditions de son roman, et ils valent le détour !
Mais c’est le personnage de Zenon que nous allons suivre : libre penseur, philosophe, chirurgien, alchimiste… Il a eu une vie riche et traversé son époque en prenant toujours ses précautions, parfois amené à fuir du jour au lendemain pour sauver sa peau. Nous allons l’accompagner jusqu’à ses derniers jours, lorsqu’il sera finalement arrêté et jugé.
Le fait le plus marquant de l’époque est l’omniprésence de la religion et du christianisme en particulier, ainsi que l’obligation pour chacun d’y croire : dans le cas contraire, la vie ne vaut pas cher !
C’est magnifiquement écrit, avec un vocabulaire riche, comme Marguerite Yourcenar sait faire. Voilà ce que nous précise les notes de l’auteur sur le contexte historique :
La formule L’Œuvre au noir, donnée comme titre au présent livre, désigne dans les traités alchimiques la phase de séparation et de dissolution de la substance qui était, dit-on, la part la plus difficile du Grand Œuvre. On discute encore si cette expression s’appliquait à d’audacieuses expériences sur la matière elle-même ou s’entendait symboliquement des épreuves de l’esprit se libérant des routines et des préjugés. Sans doute a-t-elle signifié tout à tour ou à la fois l’un et l’autre.
Les quelques soixante années à l’intérieur desquelles s’enferme l’histoire de Zénon ont vu s’accomplir un certain nombres d’événements qui nous concernent encore : la scission de ce qui restait vers 1510 de l’ancienne Chrétienté du Moyen Âge en deux partis théologiquement et politiquement hostiles ; la faillite de la Réforme devenue protestantisme et l’écrasement de ce que l’on pourrait appeler son aile gauche ; l’échec parallèle du catholicisme enfermé pour quatre siècles dans le corselet de fer de la Contre-Réforme ; les grandes explorations tournées de plus en plus en simple mise en coupe du monde ; le bond en avant de l’économie capitaliste, associé aux débuts de l’ère des monarchies.
Cela donne envie de lire cette histoire, non ?
Mais le plus étonnant sont ces fameux « Carnets de notes » : ils nous révèle la face cachée qu’un auteur peut avoir avec son œuvre, et comment le temps qui passe continue de le faire réfléchir à son contenu. Voilà quelques exemples :
Où, quand, comment ? Où que ce soit, à quelle date et peu importe quels moyens, je suis sûre d’avoir à mon chevet un médecin et un prêtre – Zénon et le prieur des Cordeliers.
Comparant les personnages d’Hadrien et Sénon :
Deux êtres profondément différents l’un de l’autre : l’un reconstruit sur des fragments du réel, l’autre imaginaire, mais nourri d’une bouillie de réalité. Les deux lignes de force, l’une partie du réel et remontant vers l’imaginaire, l’autre partie de l’imaginaire et s’enfonçant dans le réel, s’entrecroisant. Le point central est précisément le sentiment de l’ÊTRE.
À propos de la longue période de la vie de Zénon qui n’est pas détaillée :
J’ai pourtant passé bien des heures à rêver ces épisodes, et il était tentant de les écrire, quitte à donner au livre cent pages de plus… Mais la hiérarchie des faits et des souvenirs eût été irréparablement compromise. On aurait eu une de ces pâles biographies où rien n’est dit parce que tout l’est.
Marguerite Yourcenar (1903-1987) est une femme de lettres française naturalisée américaine en 1947 (elle quitte la France en 1939), auteur de romans et de nouvelles « humanistes », ainsi que de récits autobiographiques. Elle fut aussi poète, traductrice, essayiste et critique littéraire. Son roman L’Œuvre au noir, paru en 1968, connaît un grand succès et remporte le prix Femina par un vote à l’unanimité du jury. Elle fut la première femme élue à l’Académie française (1980).