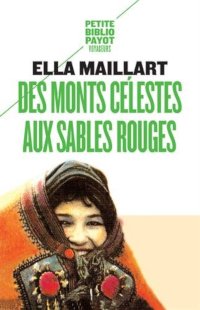 Avec un récit d’Ella Maillart, on n’est jamais déçu, rien de mieux pour se mettre en mode « voyage », ce que je ne vais pas tarder à faire, mais j’y reviendrai dans un futur article !
Avec un récit d’Ella Maillart, on n’est jamais déçu, rien de mieux pour se mettre en mode « voyage », ce que je ne vais pas tarder à faire, mais j’y reviendrai dans un futur article !
C’est donc un véritable journal de voyage qu’Ella nous livre ici : en 1932, elle part crapahuter (c’est bien le terme) au Kirghizistan et en Ouzbékistan. Elle parvient à s’incruster dans une expédition d’alpinistes amateurs vers les monts Célestes (Kirghizistan), aidés par la « Société de tourisme prolétarien », seul moyen pour elle d’obtenir un permis, les étrangers n’étant pas bien vus dans ces zones frontalières… Par la suite, elle continuera seule son voyage vers l’Ouzbékistan.
Par petites touches, elle nous offre une description d’une époque et d’un monde aujourd’hui révolu : dépaysement garanti ! Le style littéraire n’est pas toujours présent, mais la force des situations, des rencontres humaines et l’honnêteté de la narration le remplacent avantageusement.
Les brigands bassmatchis, omniprésents (et invisibles) que tout le monde craint dans la région… La récente occupation des soviétiques, qui amènent leur système communiste et la planification imposée (monoculture du coton) qui bouleverse les équilibres alimentaires ; la pauvreté des kazaks, dans un environnement rude où se nourrir est le problème quotidien.
On se pose la question : l’occupation soviétique est-elle une étape nécessaire vers la modernisation, ou plutôt la fin d’un monde et l’écrasement de cultures millénaires. Toujours est-il que le « plan de cinq ans en quatre ans » (sic !) laisse les populations affamées le temps de cette transition. A-t-il seulement réussi ?
Outre ses rencontres avec la population locale, elle croisera entre autres un déporté trotzkyste, un anarchiste, des noirs américains qui sont là comme experts de la culture du coton, des marins ouzbèques, etc… Et même des allemands mennonites arrivés là par les aléas de l’histoire et parce qu’ils ont fait serment de ne jamais toucher une arme… Leur mode de vie conservé intact dans ce pays d’une autre époque lui fait dire :
Il a fallu que je vienne jusqu’au milieu du Turkestan pour comprendre la force de la propreté, et la discipline d’une croyance…
Il faut faire attention aux vols, tout objet a de la valeur, et plus encore s’il est rare, comme le couteau à six lames d’Ella (qu’elle récupérera de justesse), ou sa paire de chaussures (qu’elle se fera voler avant sa dernière étape à dos de chameau), ou encore sa pipe, prêtée, et soi-disant perdue… Mais c’est aussi de magnifiques rencontres, où les gens donnent le peu qu’ils ont :
Vrai, il n’y a que les pauvres pour avoir le cœur pareillement large envers une passante.
Le livre se termine par ces derniers mots :
Voici enfin les hauts peupliers de la ville. Il n’y a plus d’imprévu possible, le vrai voyage est terminé.
Mais un peu avant, elle a ces mots magnifiques :
Jamais matin de ma vie ne m’a semblé plus beau. J’aimerais trouver un cri qui dise tout ce que je sens.
Partir, c’est revivre. Tout recommence, je ne sais pas ce que je vais traverser. Le soleil se lève, rouge comme il s’est couché hier. L’air étincelle de givre en suspension et j’avance dans une réalité plus belle qu’une féerie.
Pourtant, hier, comme ce fut dur d’ouvrir la porte du Lastotchka, de tourner le dos à cette cabine chaude ! J’ai bien hésité une heure avant de faire le geste athlétique de charger mon lourd sac sur l’épaule.
Autres livres d’Ella Maillart sur ce blog :
Voici quelques extraits supplémentaires pour vous donner envie… ou pas (lire l’extrait sur les puces !) 😀
Ses talents d’alpinistes mis à rude épreuve :
Je rejoins Auguste, par la suite il me dit :
— Je viens de faire fuit un bouquetin dans cette cheminée, droit au-dessus de nous. Il n’en est pas encore redescendu, j’ai entendu une pierre rouler. Il a deux cornes, plus grandes que celles d’un chamois.
Aussitôt, je grimpe dans la belle roche solide. La bête est prise au piège, je vais la surprendre. La montée en biais semble possible, essayons. J’entends le bouc se déplacer. Une corniche, une petite cheminée, je monte toujours, chaque muscle obéissant et précis ; une dalle vite traversée, trop vite, puis… heu… où continuer ?
Diable ! tout est lisse comme du marbre poli, une cascade a usé jadis la pierre, mais il faut que j’avance, je n’ai qu’une pointe de pied sur une prise transitoire… Le demi-tour est impossible, jamais je ne pourrai effacer mon épaule contre la paroi. Ma jambe se fatigue, le genou tremble de plus en plus… Je vais « vider » ! Sous moi, une hauteur de trois étages avant de rencontrer l’éboulis : je suis perdue. La peur m’injecte de grandes vagues de froid dans les membres, je dois agir dans cette seconde même, sinon… Du pied et de la main libres je tatônne vers mes avant-dernières prises, impossible de rien voir. Enfin, ça tient ! Mais je suis quasiment crucifiée et le vide me suce le dos. Il faut maintenant que mes doigts ne glissent pas pendant que je vais risquer un changement de pied.
Succès, sauvée, je peux regarder où je vais.
Les latrines mode soviétique :
Quoique simples, les latrines de Tokmak, village musulman, sont les plus propres et les plus agréables que je connaisse. Près de la mosquée surmontée de son croissant, au fond d’un jardin planté de souples peupliers, s’élève une maison sur pilotis, divisée en une dizaine de cellules sans porte ; dans chacune d’elles, deux planches pour les pieds de chaque côté de l’ouverture du plancher…
Le climat du pays dessèche et pulvérise tout, en le stérilisant ; l’air circule librement, il n’y a pas d’odeur. Au contraire, les Russes veulent à tout prix creuser des trous surmontés d’une cabane bien fermée ; dans cette terre glaise, la fosse n’est plus qu’un réservoir si infect que, pour l’éviter, on préfère les alentours.
Les puces pendant la nuit :
Imaginez-vous être confortablement installé sous la tente sombre, au chaud dans votre sac de couchage entre deux compagnons que vous touchez dès que vous bougez. À moitié endormi, vous sentez quelque chose de gênant sous la peau, comme une miette de pain. Est-ce une puce ou seulement une vieille morsure qui réveille ? Non, ça se promène, descend sous la manche et s’arrête maintenant : cela va encore se nourrir de vous ! Mais c’est bien localisé, juste sous le milieu du poignet ; alors, sans secousses, la deuxième main s’approche en rampant : un doigt s’abat sur la proie, l’assomme, la roule, et la saisit à l’aide du pouce.
Pour la tuer à coup sûr, il faut la partager en deux. Mais, prisonnier de votre sac, vous ne pouvez pas à chaque capture réveiller vos voisins en faisant de la lumière. Dans l’obscurité, je vous défie de faire deux morceaux de la chose dure, petite comme un grain de poivre. Vous voilà avec ce mangeur d’hommes entre les doigts, hésitant minute après minute sur la tactique à suivre. Mais somme toute, la langue et les dents sont bien plus habiles que les ongles : et voilà, l’affaire est liquidée, c’est tout simple, la « chose » a été prise par la langue, craquée en deux et crachée. Enfin débarrassé de l’ennemi, on peut dormir !
L’histoire terrible des kirghises, sur laquelle elle revient deux fois :
En 1916, il y eut une grave révolte des Kirghises que le tsarisme mobilisait de force pour les besoins de l’armée.
Déjà en 1905, il y avait eu un premier réveil nationaliste au moment de la parution du journal Kazak. Mais le soulèvement de 1916 fut génral ; les indigènes entreprirent de creuser un canal qui devait déverser les eaux du lac dans le Tchou et inonder ainsi les Russes de Tokmak et de Fruonzé-Pichpek. Les Cosaques arrêtèrent l’insurrection et exterminèrent les révoltés. (Général Anienkof.)On repère des traces de passage sur les cailloux, et, jalonnement macabre, des ossements. On ne fait pas cinquante mètres sans voir des côtes, des sabots, des vertèbres de bétail.
L’autre rive est dominée par un dent gigantesque, semblable à l’aiguille Verte, dont toute la face nord est piquée d’un glacier hérissé.
Notre moraine a la forme d’immenses vagues de pierre ; à chaque reprise, il y a un petit plateau d’une dizaine de mètres carrés, blanchi par des os éparpillés.
Chacun de ces replats a dû servir d’abri aux nomades fuyant avec leurs troupeaux exténués. Ce devait être en hiver parfois ; sous la neige, les bêtes ne voyaient pas les fondrières dressées par chaque caillou. Affamées, elles mouraient où elles se couchaient. Des crânes de chevaux apparaissent à demi ensablés.
Après le soulèvement national de 1916, alors que les Cosaques exterminaient les Kirghises, tous ceux qui le purent passèrent au Sin-Kiang. Mais là-bas, les Chinois n’avaient aucune raison de protéger ces Kirghises musulmans, d’origine turco-mongole : leur bétail fut volé peu à peu. Dénués de tout, ils décidèrent alors de rentrer chez eux. C’était l’hiver, ils périrent en route par milliers.
Ceux qui atteignirent leur village trouvèrent sur leur terres des Russes qui ne leur vinrent pas en aide, bien sûr.
Révoltés à nouveau, les Kirghises affamés se vengèrent comme ils purent. C’était la fin de la grande année 17 ; peu à peu, les Russes démobilisés revinrent du front, devenus Rouges après la Révolution. Trouvant à chaque pas des marques de ravages, ils usèrent de représailles, se livrant à leur tour à des exécutions.
Sur le voile :
Pilniak qualifie Tachkent de ville extraordinairement ennuyeuse ; il parle sans doute de la moitié russe de cette immense capitale de 500 000 âmes, si tant est qu »on puisse, comme dit Kisch, compter au nombre des âmes les communistes qui la nient et les femmes musulmanes auxquelles le Coran en refuse une.
Mais pour la première fois, je me trouve dans une grande agglomération orientale et, avant que tout ne soit modernisé, je m’empresse de voir ce qui reste de la vieille vie.
Tout me surprend : les étroites rues pavées, coudées en labyrinthe, le nombre de femmes voilées, silhouettes de cercueils dressés, avec le contour raide et monolithique du parandja. Sur les têtes, un paquet ou une corbeille en équilibre. Cela n’a aucun sens de parler de voile : c’est treillis qu’il faudrait dire, tant est rigide et sombre cette toile en crin de cheval qui leur blesse le bout du nez, qu’elles pincent entre leurs lèvres lorsqu’elles se penchent pour regarder la qualité du riz qu’on leur offre, le regards pouvant seulement filtrer lorsque le tchédra est perpendiculaire devant leurs yeux. À l’endroit de la bouche, un rond mouillé reste marqué lorsqu’elles se redressent, que les nuages de poussière ambiante viennent vite poudrer. Usés, les tchédras sont roux et crevés, comme mangés par des mites… La plupart des femmes ont des robes courtes, des bas et de souliers manufacturés.
Au Moyen Âge après qu’on lui ait raconté un récit digne de cette époque :
Ce terrible récit me fait penser une fois de plus que nous vivons en plein Moyen Âge ; il ne faut pas l’oublier. C’est seulement l’année 1311, avec quarante ans de retard sur le calendrier arabe de l’hégire. À chaque pas, le XIVème siècle se dresse en face du XXème ; le droit du plus fort a toujours primé et il faut créer de toutes pièces la notion de justice. À chaque pas, la force de l’habitude s’oppose à la force de volonté apportée par les soviets.
Ella Maillart (1903-1997), de nationalité suisse, est une voyageuse, écrivain et photographe. Jeune, très sportive et pratiquant la voile et ski, elle tentera une traversée de l’Atlantique, participera aux régates olympiques puis pendant quatre années consécutives à la coupe du monde de ski alpin sous les couleurs de la Suisse. Son métier de journaliste va l’envoyer une première fois en Russie et c’est le début d’une série de voyages : traversée du Caucase (1930), de l’Asie centrale Russe (1932, ce roman), puis envoyée au Mandchoukuo, l’état créé par les japonnais en Chine par Le Petit Parisien (1934). Et en 1935, ce sera le grand voyage de Pékin à Srinagar raconté dans Oasis interdites.
