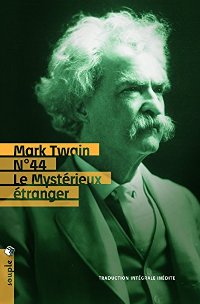 C’est sur les recommandations d’un ami que j’ai lu ce livre. Il s’agit du dernier roman de Mark Twain, qui ne sera publié qu’après sa mort (1910). Et encore : Mark Twain travailla sur trois versions de ce texte, des versions censurées seront d’abord publiées, et c’est finalement en 1969 que cette version complète et finale est enfin publiée aux U.S.A. En France, ce sont les éditions Tristram qui le publieront en 2011.
C’est sur les recommandations d’un ami que j’ai lu ce livre. Il s’agit du dernier roman de Mark Twain, qui ne sera publié qu’après sa mort (1910). Et encore : Mark Twain travailla sur trois versions de ce texte, des versions censurées seront d’abord publiées, et c’est finalement en 1969 que cette version complète et finale est enfin publiée aux U.S.A. En France, ce sont les éditions Tristram qui le publieront en 2011.
Autant le dire tout de suite, je n’ai pas du tout accroché. Mais alors pas du tout, et je me demande bien ce que mon ami a bien pu y trouver… Pour moi, c’est un conte assez enfantin, et où l’on s’ennuie ferme en y cherchant désespérément un intérêt quelconque.
L’histoire se passe au Moyen-Âge, et le narrateur est un jeune apprenti travaillant dans une imprimerie. Son récit est empreint d’une foi religieuse frisant la bêtise pure, plus proche de la superstition que d’autre chose (ce qui était sans doute le cas à l’époque). Arrive un étranger qui dit s’appeler « N°44 série 864962″… Ce dernier a des pouvoirs illimités et va mettre une belle pagaille dans le château, créant des avatars, faisant parler les animaux, j’en passe et des meilleures…. Puis à la fin du récit, il annonce au jeune apprenti :
Tout ce que je t’ai révélé est vrai : il n’y a pas de Dieu, pas d’univers, pas de race humaine, pas de vie terrestre, pas de paradis, pas d’enfer. Tout cela n’est qu’un Rêve, un rêve grotesque et imbécile. Rien n’existe à par Toi. Et Tu n’es qu’une Pensée – une Pensée vagabonde, une Pensée inutile,une Pensée sans attache, errant tristement dans les éternités vides !
Il disparut et me laissa consterné ; car je savais et j’avais compris que tout ce qu’il avait dit était vrai.
Un nihilisme total donc, qui peut expliquer les versions censurées, et le temps qu’il a fallu pour publier la version complète et originale (si tant est que Mark Twain ai considéré le roman comme terminé). Mais bon, franchement, de nos jours, le message paraît largement dépassé, surtout sous cette forme, celle d’un conte pour enfants.
Mark Twain (1835-1910) est un écrivain, essayiste et humoriste américain. Après avoir fait une carrière de militaire, été imprimeur puis journaliste, il se fait connaître par son roman Les Aventures de Tom Sawyer (1876) et sa suite, Les Aventures de Huckleberry Finn (1885). La page wikipedia précise aussi que « Mark Twain est un pamphlétaire virulent et irrévérencieux, notamment lorsqu’il s’en prend à Dieu, à la religion et aux fondements du christianisme ».


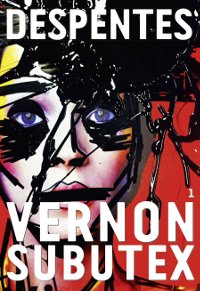 Premier roman de Virginie Despentes que je lis : cet été, je vois un ami terminer le tome 1 de Vernon Subutex en étant semble-t-il très accroché aux dernières pages… Étant à court de lecture, il me le recommande, et je le lui emprunte. Ce fut une bonne surprise.
Premier roman de Virginie Despentes que je lis : cet été, je vois un ami terminer le tome 1 de Vernon Subutex en étant semble-t-il très accroché aux dernières pages… Étant à court de lecture, il me le recommande, et je le lui emprunte. Ce fut une bonne surprise.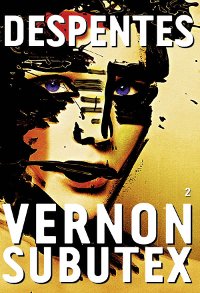 Le tome 2 (intelligemment précédé d’un index des personnages apparus dans le tome précédent) sera beaucoup plus lumineux, avec ce groupe d’amis qui se retrouvent autour de Vernon Subutex, au parc des Buttes Chaumont, pour discuter, écouter de la musique, fumer des joints et se la couler douce. Ça fait un peu penser aux années 70…
Le tome 2 (intelligemment précédé d’un index des personnages apparus dans le tome précédent) sera beaucoup plus lumineux, avec ce groupe d’amis qui se retrouvent autour de Vernon Subutex, au parc des Buttes Chaumont, pour discuter, écouter de la musique, fumer des joints et se la couler douce. Ça fait un peu penser aux années 70…
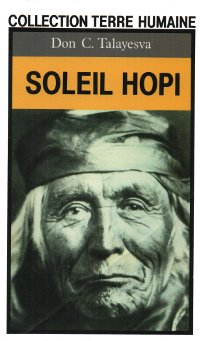 En rangeant mes vieux bouquins, je suis tombé sur celui-ci, et j’ai eu envie de le relire. Je croyais en avoir de bons souvenirs, et avec une préface de Claude Lévi-Strauss, je me suis laissé tenter. En fait, mes souvenirs n’étaient pas très précis : je me souvenais de bonnes lectures avec des textes de chefs indiens, comme « Pieds nus sur la terre sacrée »…
En rangeant mes vieux bouquins, je suis tombé sur celui-ci, et j’ai eu envie de le relire. Je croyais en avoir de bons souvenirs, et avec une préface de Claude Lévi-Strauss, je me suis laissé tenter. En fait, mes souvenirs n’étaient pas très précis : je me souvenais de bonnes lectures avec des textes de chefs indiens, comme « Pieds nus sur la terre sacrée »… C’est sur les conseils de Paul Jorion que je suis allé voir ce film (il en parlait sur son blog) ! J’en avais vaguement entendu parler, l’histoire d’un père qui élève ses enfants loin du monde développé, en pleine forêt. Ça m’avait fait penser à « Mosquito Coast », dont j’avais d’abord lu le roman de Paul Theroux (il y a bien longtemps !), puis vu le film de Peter Weir, avec Harrison Ford (1987).
C’est sur les conseils de Paul Jorion que je suis allé voir ce film (il en parlait sur son blog) ! J’en avais vaguement entendu parler, l’histoire d’un père qui élève ses enfants loin du monde développé, en pleine forêt. Ça m’avait fait penser à « Mosquito Coast », dont j’avais d’abord lu le roman de Paul Theroux (il y a bien longtemps !), puis vu le film de Peter Weir, avec Harrison Ford (1987).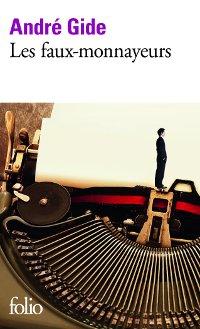 Encore un livre d’André Gide, mais un roman cette fois-ci. Je voulais voir ce que pouvait donner un roman de cet auteur, n’ayant lu que des récits de voyage :
Encore un livre d’André Gide, mais un roman cette fois-ci. Je voulais voir ce que pouvait donner un roman de cet auteur, n’ayant lu que des récits de voyage :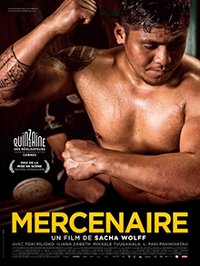 Bonne surprise que ce film, tourné avec des acteurs amateurs. Le rôle principal, celui de Soame, est excellent, avec sa masse athlétique impressionnante, et dont pourtant une douceur énorme se dégage.
Bonne surprise que ce film, tourné avec des acteurs amateurs. Le rôle principal, celui de Soame, est excellent, avec sa masse athlétique impressionnante, et dont pourtant une douceur énorme se dégage.
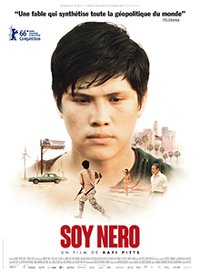 Film que je suis allé voir un peu au hasard, sachant que cela parlait d’immigration mexicaine aux États-Unis, et du problème de la fameuse « Green card », celle qui donne le droit de travailler, et donc de sortir de la clandestinité et obtenir à terme la nationalité américaine.
Film que je suis allé voir un peu au hasard, sachant que cela parlait d’immigration mexicaine aux États-Unis, et du problème de la fameuse « Green card », celle qui donne le droit de travailler, et donc de sortir de la clandestinité et obtenir à terme la nationalité américaine.