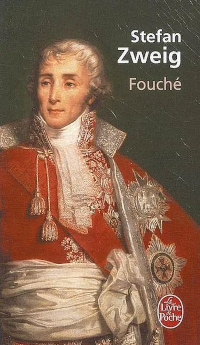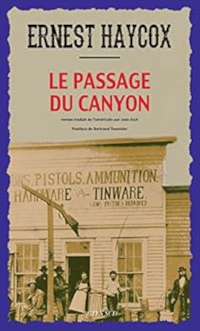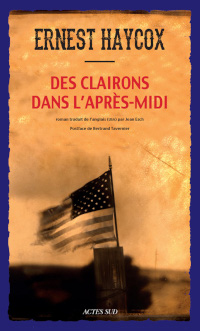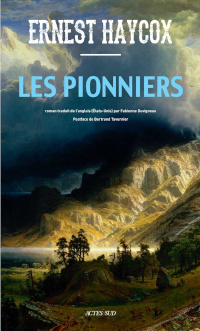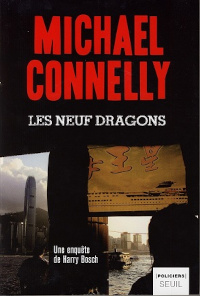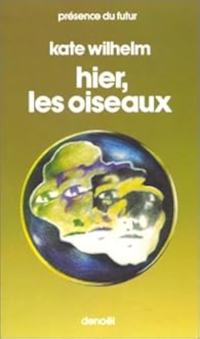Après avoir lu Le monde d’hier de Stefan Zweig, j’avais remarqué que cet auteur avait eu le talent d’écrire d’excellentes biographies de personnages célèbres. J’avais déjà lu Magellan qui confirmait cette impression. Son honnêteté intellectuelle et sa capacité de travail sont garantes d’un récit de qualité. Voici donc celle de Joseph Fouché, dont tout le monde connaît le nom, mais sans doute moins ce qu’a été sa vie… Enfin c’était le cas pour moi.
Le personnage vaut effectivement le détour, tellement il est resté énigmatique et caché derrière ses fonctions successives, véritable disciple de Machiavel, animal au sang froid, qui a su traverser des temps troublés et toujours rejoindre le camp des vainqueurs au gré des événements. Il suffit de résumer son parcours :
De santé fragile, il entre au séminaire de l’Oratoire de Nantes, où il devient professeur de sciences pendant dix ans, sans toutefois prononcer ses vœux sacerdotaux : est-ce un signe ? déjà il répugne à s’engager irrévocablement… Ce sera le trait principal de son caractère pendant toute sa vie.
Puis vient la Révolution française, dont il embrasse la cause avec ardeur et devient député de Nantes. Girondin (donc modéré), il vote pourtant la mort de Louis XVI sous la pression populaire alors que la veille encore il prétendait faire le contraire. Et devient aussi vite Jacobin parmi les plus extrêmes… Nommé proconsul, il se fait remarquer par son extrémisme à Nantes. À tel point qu’il est envoyé à Lyon (la ville se révolte contre les excès des révolutionnaires) : il y deviendra « le mitrailleur de Lyon » : la guillotine travaillant trop lentement, il va massacrer des groupes de prisonniers placés sous la mitraille des canons, les corps étant ensuite jetés dans le Rhône ; 2000 personnes seront ainsi exécutées.
Mais le vent tourne et cette violence commence à ne plus plaire à Paris. Fouché se rallie vite aux modérés, mais Robespierre le convoque à Paris. La lutte entre les deux hommes sera terrible, Fouché voit le couperet de la guillotine s’approcher de très près, il se cache, œuvre dans l’ombre, et réussit l’impossible : monter une conspiration avec la majorité des députés dit « faibles » contre l’homme le plus puissant de France, et le faire emprisonner. Un véritable coup de maître. Mais dans les jeux de pouvoir qui suivent, Fouché va tout perdre et sauver une nouvelle fois sa tête de justesse. Il disparaît pendant trois ans pour vivre ces années dans la plus grande misère.
Mais la Révolution se termine, les temps changent, l’argent revient, l’heure de Napoléon Bonaparte et de Louis XVIII arrive. Là encore, vite nommé ministre de la police, Fouché va réussir à se tenir quoiqu’il arrive au plus près du pouvoir en ces temps pourtant troublés. Il va arrêter les derniers républicains sans le moindre remord, et reprendre le jeu où il excelle, parlant peu, agissant dans l’ombre, et s’en sortant à chaque fois. L’affrontement avec Napoléon qui s’en méfie autant qu’il en a besoin vaut le détour. Fouché deviendra très riche, sera nommé Duc d’Otrante, mais après les Cent-Jours (quand Napoléon revient de l’île d’Elbe) puis l’avènement de Louis XVIII, où là encore Fouché a réussi à s’en sortir (du grand art !), son ambition finira par le perdre : il épouse une comtesse et son premier témoin est Louis XVIII : c’est-à-dire le frère Louis XVI, dont Fouché avait demandé la mort ! C’en est trop, et la noblesse ne va pas le lui pardonner, il va être banni et finira dans la solitude.
Pour finir, voilà ce qui Stefan Zweig à propos de Fouché et incidemment des diplomates. Je me souviens que dans Le monde d’hier, il leur attribue beaucoup de responsabilités dans le déclenchement de la 1ère guerre mondiale :
C’est ainsi que d’une manière tout à fait imprévue, simplement par plaisir psychologique, je me suis mis à écrire l’histoire de Joseph Fouché, comme une contribution à une étude biologique encore inexistante et pourtant très nécessaire, du diplomate, de cette race d’esprit qui n’a pas encore été complètement examinée et qui est la plus redoutable de notre univers.
Chaque jour nous constatons encore que, dans le jeu ambigu et souvent criminel de la politique, auquel les peuples confient toujours avec crédulité leurs enfants et leur avenir, ce ne sont pas des hommes aux idées larges et morales, aux convictions inébranlables qui l’emportent, mais ces joueurs professionnels que nous appelons diplomates, – ces artistes aux mains prestes, aux mots vides et aux nerfs glacés.
Stefan Zweig (1881-1942) est un écrivain, dramaturge, journaliste et biographe autrichien. Il quitte son pays natal en 1934, et se se suicidera au Brésil en 1942, désespéré d’assister à l’agonie du monde. Il est l’auteur de plusieurs biographies : Magellan que j’ai lu et aimé, Joseph Fouché donc, et aussi Marie-Antoinette ou encore Marie Stuart. Un auteur qui mérite certainement le détour.