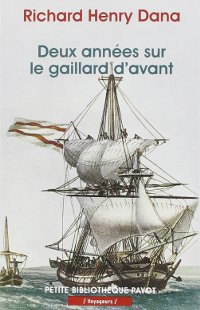 Un roman sur la mer, grand classique de la littérature américaine du XIXème siècle, qui plus est admirablement traduit et présenté par Simon Leys… Cela ne pouvait que procurer de bons moments de lecture, et ce fût bien le cas.
Un roman sur la mer, grand classique de la littérature américaine du XIXème siècle, qui plus est admirablement traduit et présenté par Simon Leys… Cela ne pouvait que procurer de bons moments de lecture, et ce fût bien le cas.
C’est avant tout un beau roman grâce à la narration très sincère de l’auteur, et le ton employé. On est vite pris par l’histoire, et la description de ce qu’était la vie des marins à cette époque ; il y a tout de même certaines pages utilisant un vocabulaire très technique, propre à la voile (il y a un glossaire à la fin du roman), mais elles ne sont pas gênantes, et reflètent plutôt l’énorme travail à fournir (et parfois l’urgence) lors d’un coup de vent ou d’une tempête sur ces grands voiliers de l’époque.
Alors qu’il étudiait le droit à Harvard, et suite à un mal mystérieux (faiblesse de la vue), R. H. Dana embarque en 1834 à Boston sur le « Pilgrim » pour rejoindre la Californie via le Cap Horn : là-bas, ils vont récolter des peaux le long de la côte, les stocker et les préparer sur place, jusqu’à ce que le bateau soit plein. Dana va revenir à Boston au bout de deux ans, sur un autre bateau, le « Pilgrim » restant encore plusieurs mois sur la côté ouest, ce que ne veut pas le narrateur : il n’entend pas faire le matelot toute sa vie, et on le comprend !
Ce qui frappe le plus, ce sont les conditions de vie des matelots sur le navire : outre la nourriture très basique (pain et bœuf bouilli, mais pas pour les officiers bien entendu, même le thé leur est réservé !), les vêtements sont très peu adaptés (comparé à nos jours) pour affronter la pluie et le froid. Imaginez-vous des heures sur le pont sous la pluie sans vêtement vraiment adapté, ou à grimper dans les haubans pour remonter des voiles à moitié gelées, tout cela pendant une tempête de grêle, et sans gants pour vous protéger les doigts…
La foi religieuse est par ailleurs omniprésente, et laisse transparaître une société américaine très puritaine (rappelons-nous le Mayflower)… D’ailleurs, le bateau s’appelle le « Pilgrim », tout un programme. Et même si le dimanche est censé être le jour de repos des matelots (jour du Seigneur oblige), ce n’est pas souvent respecté par le capitaine, qui s’arrange pour imposer certaines tâches ce jour-là afin d’améliorer la rentabilité de l’armateur. Le capitaine a donc tous les pouvoirs, et se comporte à l’occasion en véritable tyran avec l’équipage (voir plus bas).
C’est aussi l’occasion de découvrir la Californie avant que la civilisation n’arrive : à cette époque, il n’y a que quelques missions et de petits villages occupés par les locaux (espagnols et indiens) comme à Santa Barbara, Monterey ou San Diego. San Francisco n’est même qu’une simple mission ! Puis dans la postface, quand R. H. Dana y revient vingt ans plus tard, en tant que touriste, tout a déjà beaucoup changé : entre temps, la ruée vers l’or a eu lieu et San Francisco est devenu une ville…
Enfin, un dernier chapitre qui avait été retiré de la seconde édition par l’auteur porte sur des considérations concernant les matelots confrontés à l’autorité du capitaine, et particulièrement sur les châtiments corporels (coups de fouets !) que ce dernier n’hésita pas à donner. Son raisonnement est un peu surprenant : comme les interdire serait dangereux (une autorité absolue est nécessaire pour éviter des rébellions ou simplement une grève qui pourrait se révéler catastrophique sur un bateau), sa recommandation est d’éduquer les matelots (et les capitaines), sans oublier leur foi religieuse : sinon on transformerait un pêcheur ignorant en un pêcheur intelligent et donc renforcé dans l’erreur…
Toute une époque et tout un monde, dépaysement assuré !!
