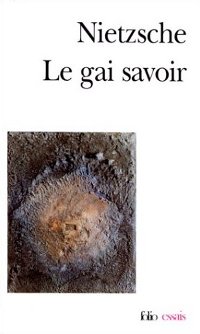 C’est le deuxième livre de Nietzsche que je lis, après Par delà bien et mal, et qui se présente sous la même forme, à savoir une série de textes courts, autant de réflexions sur une multitude de sujets comme la morale, la science, la logique, la santé, la religion, etc… bref sur la vie.
C’est le deuxième livre de Nietzsche que je lis, après Par delà bien et mal, et qui se présente sous la même forme, à savoir une série de textes courts, autant de réflexions sur une multitude de sujets comme la morale, la science, la logique, la santé, la religion, etc… bref sur la vie.
Je n’ai pas respecté l’ordre chronologique, puisque Nietzsche dit du Gai savoir qu’il est une introduction à Ainsi parlait Zarathoustra, de même que Par-delà bien et mal est son commentaire.
Je ne suis d’ailleurs pas pressé de lire Ainsi parlait Zarathoustra, poème philosophique et probablement l’œuvre majeure de Nietzsche, mais réputée hermétique, comme l’avoue son auteur lui-même :
Hélas ! mon Zarathoustra cherche encore cet auditoire [capable de le comprendre], il le cherchera longtemps.
Le genre de bouquin que l’on peut relire dix fois, ou emmener sur une île déserte ! 😉
Pour en revenir au Gai savoir, comme pour Par-delà bien et mal, c’est l’occasion de remettre en cause certaines idées reçues, et donc de commencer à penser par soi-même. C’est sans doute le grand intérêt qu’il y a à lire Nietzsche.
Tout n’est pas égal, ou peut-être certains textes m’ont parlé plus que d’autres…parfois je n’ai rien compris à ce qu’il voulait dire, et pour d’autres je pense qu’il a bien déliré. L’ensemble est tout de même excellent, et on ne trouve pas dans celui-ci certaines idées plus que contestables rencontrées dans Par-delà bien et mal comme par exemple sur les femmes, le peuple ou l’aristocratie, ou encore son concept du surhomme.
Nietzsche publie Le gai savoir en 1882, alors qu’il est convalescent (il sera malade toute sa vie). En 1879, il obtient une pension car son état de santé l’oblige à quitter son poste de professeur de philosophie à Bâle. Il commence alors une vie errante dans le sud de la France et en Italie. Voici ce qu’il dit dans la préface :
Ce livre aurait sans doute besoin de plus d’une préface ; en fin de compte, subsistera toujours le doute que quelqu’un, pour n’avoir rien vécu d’analogue, puisse jamais être familiarisé par des préfaces avec l’expérience préalable à ce livre. Il semble écrit dans le langage d’un vent de dégel : tout y est pétulance, inquiétude, contradiction, comme un temps d’avril, si bien qu’on y est constamment rappelé à l’hiver encore tout récent comme à la victoire remportée sur l’hiver, à cette victoire qui vient, qui doit venir, qui peut-être est déjà venue… La reconnaissance y coule à flots, comme si l’événement le plus inespéré venait de se produire, la reconnaissance d’un convalescent — car la guérison était cet événement le plus inespéré. Le « Gai Savoir » : voilà qui annonce les Saturnales d’un esprit qui a patiemment résisté à une longue et terrible pression — patiemment, rigoureusement, froidement, sans se soumettre, mais aussi sans espoir —, et qui tout d’un coup se voit assailli par l’espoir, par l’espoir de la santé, par l’ivresse de la guérison.
Comme d’habitude, voilà quelques extraits pour vous faire une idée.
Science
En raison de trois erreurs. — On a favorisé le développement des sciences durant les derniers siècles, en partie parce qu’avec elles et par elles on espérait le mieux comprendre la bonté et la sagesse de Dieu — motif capital de l’âme des grands Anglais (tel Newton) —, en partie, parce que l’on croyait à l’absolue nécessité de la connaissance, notamment au lien le plus intime entre la morale, la science et le bonheur — motif capital de l’âme des grands Français (tel Voltaire) —; en partie, parce qu’on prétendait posséder et aimer dans la science quelque chose de désintéressé, d’inoffensif, se suffisant à soi-même, de véritablement innocent, à quoi les mauvaises impulsions de l’homme n’auraient absolument aucune part, — motif capital de l’âme de Spinoza qui, en tant que connaissant, se sentait divin : — donc, en raison de trois erreurs!
Notre étonnement. — Un bonheur profond et foncier réside dans le fait que la science découvre des choses qui résistent à l’épreuve et qui ne cessent pas de donner lieu à de nouvelles découvertes : — il pourrait en être autrement ! Oui, nous sommes tellement convaincus de toute l’incertitude, de toute la fantasmagorie de nos jugements comme de l’éternel changement des lois et des notions humaines, que nous restons étonnés de voir combien stables demeurent les résultats de la science ! Jadis on ignorait tout de cette vicissitude des choses humaines, la coutume morale maintenait la croyance que toute vie intérieure de l’homme était fixée par d’éternels crampons à une nécessité d’airain : peut-être éprouvait-on alors à entendre des légendes et des contes de fées une volupté d’étonnement analogue. Le merveilleux devait procurer une grande détente à ces hommes, parfois sans doute exténués par la règle et l’éternité. Perdre pied pour une fois! Planer! Errer! Être fou! — voilà qui appartenait au Paradis et aux délices d’antan : tandis que notre béatitude est semblable à celle du naufragé qui a touché terre, qui pose ses deux pieds sur la vieille terre ferme — étonné de ne la point sentir osciller.
Réputation
Ce que d’autres pensent de nous. — Ce que nous savons de nous-mêmes et gardons dans la mémoire, n’est point si décisif que l’on croit pour le bonheur de notre vie. Le jour vient où ce que d’autres savent de nous (ou prétendent savoir) nous tombe sur le dos, — et dès lors nous reconnaissons que c’est là l’élément qui l’emporte. On vient plus facilement à bout de sa mauvaise conscience que de sa mauvaise réputation.
Dévouement féminin, qu’il ne semble pas prendre au sérieux
Dévouement. — Il est de nobles femmes d’une certaine pauvreté d’esprit, qui ne savent exprimer autrement leur dévouement le plus profond qu’en offrant leur vertu et leur pudeur : ce qu’elles ont de suprême. Et souvent ce don est accepté, sans engager le donataire aussi profondément que le supposent les donatrices — histoire fort mélancolique!
Morale
Ampleur de l’élément moral. — L’image que nous voyons pour la première fois, nous la construisons immédiatement à l’aide de toutes nos anciennes expériences, chaque fois selon le degré de notre probité et de notre équité. Même dans le domaine de la perception sensible il n’est d’autres expériences vécues que morales.
Santé
Santé de l’âme. — La formule de prédilection propre à la thérapeutique morale (dont l’auteur est Ariston de Chios) : « La vertu est la santé de l’âme » — pour être praticable, devrait être tout au moins modifiée dans ce sens : « Ta vertu est la santé de ton âme. ». Car il n’y a pas de santé en soi, et toutes les tentatives pour la définir ont échoué lamentablement. Ce qui importe ici, c’est ton but, ton horizon, ce sont tes forces, tes impulsions, tes erreurs, et notamment les idéaux et les phantasmes de ton âme, pour déterminer ce qui, même pour ton corps, constitue un état de santé. Ainsi il est d’innombrables santés du corps ; et plus l’on permettra à l’individu particulier et incomparable de relever la tête, plus l’on désapprendra le dogme de l' »égalité des hommes », et plus nos médecins devront se passer de la notion d’une santé normale, en même temps que celle d’une diète normale, d’un processus normal de la maladie. Le moment serait venu alors de réfléchir à la santé et à la maladie de l’âme et d’identifier la vertu, particulière à chacun, avec sa santé propre. En fin de compte resterait la grande question de savoir si nous pouvons être absolument quittes de la maladie, même pour le développement de notre vertu, et si notamment notre soif de connaissance et de connaissance de nous-mêmes n’aurait pas autant besoin de l’âme malade que de l’âme saine : bref, si l’unique volonté de santé ne serait point un préjugé, une lâcheté et peut-être un vestige de barbarie et d’état rétrograde des plus subtils.
Chrétienté
Une résolution dangereuse. — La résolution chrétienne de considérer le monde comme laid et mauvais a rendu le monde laid et mauvais.
Principe. — Une hypothèse inéluctable, à laquelle l’humanité doit revenir sans cesse, se révèle plus puissante à la longue que la foi la plus tenace en quelque chose de non-vrai (telle la foi chrétienne). À la longue : c’est-à-dire, en l’occurrence, au terme de cent mille ans.
L’erreur du Christ. — Le fondateur du christianisme estimait que rien ne faisait autant souffrir les hommes que leurs péchés : — c’était son erreur, l’erreur de celui qui se sentait sans péché, et à qui en cela l’expérience faisait défaut ! Ainsi son âme respirait cette merveilleuse et fantastique miséricorde pour une détresse dont même son peuple, inventeur du péché, souffrait rarement comme d’une grande détresse ! — Mais les chrétiens ont su rendre justice ultérieurement à leur maître, et consacrer son erreur en tant que « vérité ».
Stupéfiants
Danger des végétariens. — La consommation excessive du riz pousse à l’usage de l’opium et de stupéfiants, tout de même que la consommation excessive de pommes de terre pousse au schnaps ; — mais son effet ultérieur plus subtil est d’incliner à des manières de penser et de sentir qui agissent comme des narcotiques. Or, il se trouve que les promoteurs de ces manières-là de penser et de sentir, tels les docteurs hindous, prônent précisément une diète purement végétarienne dont ils voudraient faire la loi à la masse : ils veulent ainsi provoquer et augmenter le besoin qu’ils sont eux-mêmes en mesure de satisfaire.
Question et réponse. — Qu’est-ce que les peuplades sauvages empruntent en premier aux Européens ? L’alcool et le christianisme, stupéfiants européens. — Et de quoi périssent-elles le plus rapidement ? — des stupéfiants européens.
Voyageur
Joie et cécité. — Mes pensées, dit le Voyageur, à son ombre, doivent m’indiquer où j’en suis : non pas me révéler où je vais. J’aime l’ignorance de l’avenir et ne veux succomber à l’impatience ni à la saveur anticipée des choses promises.
Habitudes
Courtes habitudes. — J’aime les courtes habitudes et je les tiens pour l’inestimable moyen de connaître nombre de choses et de situations, jusqu’au fond de leur suavité et de leur amertume ; ma nature est entièrement faite pour de courtes habitudes, même quant aux besoins de sa santé corporelle et de façon absolue, pour autant que je puisse voir : du plus bas jusqu’au plus haut. Je crois toujours que ceci a de quoi me contenter de durable façon — la courte habitude elle aussi a la foi de la passion, la foi en l’éternité — et je m’imagine être enviable pour l’avoir trouvé et reconnu : — et dès lors cette croyance a la vertu de me nourrir matin et soir et de répandre une profonde frugalité autour de soi et en moi-même, si bien que je n’ai rien à désirer, sans avoir besoin de comparer, de mépriser ou de haïr. Le jour vient où la bonne chose a fait son temps : elle se sépare de moi, non comme devenue un objet de dégoût — mais paisiblement, rassasiée de moi comme je suis d’elle, et comme si nous nous devions un reconnaissance mutuelle, donc prêts à nous serrer les mains au moment de prendre congé ! Et déjà la chose nouvelle m’attend à la porte, de même que la croyance — l’imperturbable folle, l’imperturbable sage ! — la croyance que cette chose nouvelle sera la chose juste, définitivement juste. Pour moi, il en est ainsi des repas, des pensées, des hommes, des villes, des poèmes, de la musique, des doctrines, des programmes du jour, des manières de vivre. — En revanche, je hais les habitudes durables, et je sens comme l’approche d’un tyran et comme un empoisonnement de mon atmosphère, dès que les circonstances prennent une tournure qu’elles doivent nécessairement engendrer des habitudes durables : par exemple à la faveur d’une fonction, d’une vie dans la constante compagnie des mêmes personnes, d’une résidence stable, d’un unique genre de santé. Oui, au plus profond de mon âme, je sais gré à ma santé lamentable, comme à tout ce qui est imparfait en moi, de m’offrir des centaines d’issues dérobées par où je puisse échapper aux habitudes durables. — Le plus insupportable sans doute, et ce qu’il y aurait de proprement terrible pour moi serait une vie totalement dépourvue d’habitudes, une vie qui demanderait une improvisation incessante — ce serait mon exil et ma liberté.
Compréhension
Gémissement. — Je saisis au vol cette compréhension et je pris hâtivement les premiers mauvais termes venus, pour la retenir. Et voici qu’elle est morte de la sécheresse de ces mots, et elle y reste accrochée, ballottante — et c’est à peine si je sais, quand je la considère, comment j’avais pu avoir pareille chance, à prendre cet oiseau.
Friedrich Wilhelm Nietzsche est né en 1844, mort en 1900 (et fou les dix dernières années de sa vie). De nationalité allemande, philologue de formation, puis philosophe et poète. Sur Wikipedia, on peut trouver sa biographie ainsi qu’une présentation de sa philosophie.

Merci bien de cette présentation du Gai Savoir de mon cher Nietzsche 😉