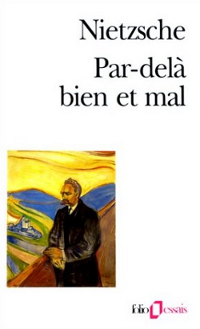 Après avoir écouté Michel Onfray l’année dernière nous conter l’histoire et la philosophie de Nietzsche, je me suis lancé dans la lecture de l’un de ses ouvrages, « Par-delà bien et mal ». Pour une première lecture d’un philosophe, ce petit bouquin de 200 pages en Folio essai me paraissait abordable.
Après avoir écouté Michel Onfray l’année dernière nous conter l’histoire et la philosophie de Nietzsche, je me suis lancé dans la lecture de l’un de ses ouvrages, « Par-delà bien et mal ». Pour une première lecture d’un philosophe, ce petit bouquin de 200 pages en Folio essai me paraissait abordable.
Le livre est composé de textes courts, autant de réflexions ou d’opinions exprimés sur les différents sujets abordés (philosophie, religion, morale, etc…). Si Nietzsche est assez lisible (je veux dire qu’il n’emploie pas un vocabulaire ésotérique), j’ai du en relire plus d’un pour mieux saisir ce qu’il voulait dire. La première lecture servait à voir à peu près de quoi il retournait, et où il voulait en venir (ce qui n’est pas toujours évident) ; et la deuxième, plus fluide, de saisir le texte dans son ensemble. C’était finalement assez agréable, quand le sujet ou l’idée me plaisait…
Il va bousculer bon nombre d’idées reçues, avec un certain plaisir et parfois avec un humour assez ravageur… beaucoup de choses vont être sérieusement remises en question ! Grand penseur (« esprit libre » comme il se définit), à une époque ou la psychologie et la psychanalyse apparaissent, il ouvre certes des perspectives nouvelles.
Il ne s’embarrasse ni ne doute de rien, et ses jugements vont parfois trop loin à mon goût (manque d’humanisme). Le « bas peuple » (la plèbe) est violemment dénigré et méprisé (élitisme ?). Quand il aborde « Peuples et patries », puis « Qu’est-ce qui est aristocratique ? ». Là… il faut sans doute mieux connaître la philosophie de Nietzsche pour bien comprendre ce qu’il veut dire quand il parle du surhomme ou de la volonté de puissance (malgré les explications de Michel Onfray), mais ce n’est pas vraiment surprenant que ses idées aient été récupérées par les nazis et le fascisme italien.
Comme vous pourrez le voir dans les extraits ci-dessous, il y a donc du bon et du moins bon, voir du mauvais et je reste assez partagé sur le personnage :
Il fut malade très tôt (syphilis ?), souffrant dans son corps toute sa vie ou presque, et cela explique peut-être ses réflexions sur les bienfaits de la souffrance, ou bien sa fascination pour les grands hommes et son mépris pour la démocratie qui « ramollit » les hommes. Il porte des jugements très sévères sur ces sujets qui ne me semblent pas empreints d’une réelle objectivité, mais plutôt d’une fascination.
Quant à ses jugements sur la femme, là aussi ça dérape ! mais finalement comme tant d’autres qui l’ont précédé, j’ai bien l’impression qu’il faille attendre l’émancipation de celle-ci pour trouver des philosophes portant un jugement plus équitable… comme quoi l’environnement influe sur la pensée, ce qui Nietzsche dit d’ailleurs à propos des philosophes : hélas, il n’échappe pas lui-même à la régle !
Tout l’intérêt du bouquin est nous faire réfléchir sur des choses que l’on considère comme acquises. On peut être ou ne pas être d’accord, l’essentiel est d’y réfléchir. De plus, comme les textes sont courts, on peut se ballader avec le bouquin en poche, en lire un, y réfléchir tranquillement, puis en lire un autre, etc…
Quelques extraits pour se faire une idée…
La préface débute ainsi :
A supposer que la vérité soit femme, n’a-t-on pas lieu de soupçonner que tous les philosophes, pour autant qu’ils furent dogmatiques, n’entendaient pas grand-chose aux femmes et que l’effroyable sérieux, la gauche insistance avec lesquels ils se sont approchés de la vérité, ne furent que des exemples maladroits et mal appropriés pour conquérir justement les faveurs de cette femme ?
Sur le philosophe, il cite Stendhal, « ce dernier grand psychologue » :
Pour être un bon philosophe, il faut être sec, clair, sans illusion. Un banquier qui a fait fortune a une partie du caractère requis pour faire des découvertes en philosophie, c’est-à-dire pour voir clair dans ce qui est.
Sur la volonté de puissance :
Les physiologistes devraient réfléchir avant de poser que, chez tout être organique, l’instinct de conservation constitue l’instinct cardinal. Un être vivant veut avant tout déployer sa force. La vie même est volonté de puissance, et l’instinct de conservation n’en est qu’une conséquence indirecte et des plus fréquentes. ? Bref, ici comme partout, gardons-nous des principes téléologiques superflus, tels que l’instinct de conservation (nous le devons à l’inconséquence de Spinoza). Ainsi le veut la méthode, qui doit être essentiellement économe en matière de principe.
Sur le libre arbitre, question soulevée par tant de philosophes :
Ce n’est certes pas le moindre charme d’une théorie que d’être réfutable : c’est ainsi qu’elle attire les esprits déliés. Il semble bien que la théorie cent fois réfutée du « libre arbitre » ne doive sa survie qu’à ce genre de charme ; il vient toujours quelqu’un qui se sent de taille à la réfuter encore.
Sur l’amour du prochain :
Rien n’y fait : il faut impitoyablement traîner au tribunal et mettre sur la sellette les sentiments d’abnégation et de sacrifice en faveur du prochain, la morale toute entière du renoncement, de même que l’esthétique de la « comptemplation désintéressée », par le truchement de laquelle l’art émasculé d’aujourd’hui cherche, non sans astuce, à se donner bonne conscience. Il entre beaucoup trop de charme et de douceur dans ces sentiments qui ont en vue « le bien des autres et non mon bien » pour qu’on n’ait pas à redoubler de méfiance sur ce point. « Ces sentiments, peut-on se demander, ne visent-ils pas à séduire ? » Le fait qu’ils plaisent — à celui qui les nourrit et à celui qui en profite, aussi bien qu’au simple spectateur — ne constitue pas un argument en leur faveur ; c’est précisément ce qui invite à la prudence. Soyons donc prudents !
Sur l’indépendance d’esprit
En fin de compte, il faut tout faire soi-même pour savoir soi-même quelque chose : c’est-à-dire que l’on a beaucoup à faire. Mais une curiosité comme la mienne n’en demeure pas moins le plus agréable des vices, — pardon, je voulais dire : l’amour de la vérité trouve sa récompense au ciel et déjà sur cette terre. —
Sur la religion
Partout où la névrose religieuse est apparue sur la terre, nous la trouvons liée à trois régimes dangereux : solitude, jeûne et continence, sans qu’il soit possible de dire avec certitude où il faut chercher la cause ou l’effet, ni même s’il existe sur ce point une relation de cause à effet. Ce qui autorise le dernier doute, c’est que les symptômes les plus ordinaires de cette névrose, chez les peuples sauvages aussi bien que chez les nations policées, consistent dans le déchaînement subit d’une frénésie sensuelle qui se mue tout aussi soudainement en convulsions de pénitence, en négation du monde et de sa volonté : deux phénomènes où il convient peut-être de reconnaître une épilepsie larvée ?
Sur la morale :
Toutes ces morales qui se proposent de faire le « bonheur » de l’individu, comme on dit, qu’offrent-elles sinon des compromis avec le danger qui menace la personne de l’intérieur ; des recettes contre ses passions, ses bons et ses mauvais penchants, dans la mesure où ils aspirent à dominer et à régner sur la conscience ; de petites et grandes roueries, des artifices, qui dégagent un relent de pharmacie domestique et de sagesse de bonne femme ? Toutes présentent des formes baroques et déraisonnables, parce qu’elles s’adressent à « tout le monde », parce qu’elles généralisent là où on a pas le droit de généraliser, toutes s’expriment dans l’absolu et se donnent pour absolues ; toutes sont dépourvues du moindre grain de sel et ne deviennent supportables, quelquefois même capiteuses, qu’une fois assaisonnées, quand elles dégagent une odeur dangereuse, celle surtout de « l’autre monde ». Tout cela, aux yeux de l’intelligence, n’offre pas grande valeur et n’a rien à voir avec la « science », ni encore moins avec la « sagesse » ; tout cela, je le répète, et même trois fois, n’est qu’astuce, astuce, astuce entremêlée de sottise, sottise et sottise, qu’il s’agisse de l’indifférence et de l’impassibilité marmoréenne que les stoïciens conseillaient comme un remède aux passions, du renoncement au rire et aux larmes préconisé par Spinoza avec sa prétention si naïve de détruire les passions en les soumettant à l’analyse et à la vivisection, ou encore du rabaissement des passions à un niveau si médiocre qu’il devient permis de les satisfaire tant elles deviennent inoffensives, ainsi que le réclame l’aristotélisme de la morale.
Toujours sur la morale, mais plus litigieux :
Certains instincts puissants et dangereux, tels que le goût du risque, le courage téméraire, la soif de vengeance, la ruse, la rapacité, la passion de dominer, instincts qui n’étaient pas seulement honorés — sous d’autres noms, bien entendu — mais cultivés et fortifiés (parce qu’on en avait besoin quand la société était mise en péril par des ennemis), furent ressentis comme doublement forts une fois qu’ils n’eurent plus d’exutoires, et peu à peu taxés d’immoralité et abandonnés à la calomnie. Sont honorés désormais et tenus pour moraux les instincts et les penchants opposés ; l’instinct grégaire en tire les conclusions et entamme pas à pas sa marche en avant. La morale change désormais d’optique et se demande si une opinion, une passion, une volonté, un don est susceptible de nuire ou de ne pas nuire à la collectivité, à l’égalité ; une fois de plus la crainte est la mère de la morale. […] L' »agneau », mieux encore le « mouton » gagnent en considération. On en arrive à un degré de déliquescence morbide et de ramollissement où la société prend elle-même parti, en tout sérieux et honnêteté, pour celui qui lui porte atteinte, pour le malfaiteur.
Un dictateur éclairé ?
Dans tous les cas où l’on ne croit pas pouvoir se dispenser de têtes de file et de chefs, on s’ingénie aujourd’hui à substituer aux dirigeants un ensemble d’individus avisés du type grégaire : telle est, par exemple, l’origine de tous les régimes représentatifs. Malgré tout, quel bienfaits pour ces Européens, pour ce bétail humain, quelle délivrance d’un malaise qui devenait intolérable, que l’apparition d’un maître absolu : c’est ce que montrèrent pour la dernière fois sur une vaste échelle les répercussions du phénomène napoléonien : l’histoire de ces répercussions est pour ainsi dire celle du plus haut bonheur auquel ce siècle ait pu atteindre dans ses meilleurs moments et dans ses hommes les plus remarquables.
Va-t-en-guerre ?
Peut-être ne faudra-t-il pas seulement des guerres aux Indes et des imbroglios en Asie pour délivrer l’Europe du plus grand danger qui la menace, mais des bouleversements intérieurs, l’éclatement de l’empire russe en une mosaïque de petits États et avant tout l’introduction de l’imbécilité parlementaire jointe à l’obligation pour chacun de lire son journal au petit-déjeuner. Ce n’est pas que je souhaite une pareille évolution, je souhaite plutôt le contraire, une telle aggravation de la menace russe qu’elle contraigne enfin l’Europe à devenir tout aussi menaçante, à se forger sa propre volonté, par le moyen d’une nouvelle caste régnant sur l’Europe, une volonté redoutable et à longue portée capable de se fixer des buts pour des millénaires.
Vive la souffrance !
Vous voulez abolir la souffrance dans la mesure du possible, et il n’y a pas de plus folle ambition. Et nous ? Il semble que nous la voudrions encore plus profonde et plus grave qu’elle le fût jamais. Le bien-être tel que vous le concevez n’est pas un but, c’est à nos yeux un terme. Un état qui rend l’homme aussitôt ridicule et méprisable, qui fait souhaiter sa ruine. La culture de la souffrance, de la grande souffrance, ne savez-vous pas que c’est là l’unique cause des dépassements de l’homme ? Cette tension de l’âme dans le malheur, qui l’aguerrit, son frisson au moment du grand naufrage, son ingéniosité et sa vaillance à supporter le malheur, à l’endurer, à l’interpréter, à l’exploiter jusqu’au bout, tout ce qui lui a jamais été donné de profondeur, de secret, de dissimulation, d’esprit, de ruse, de grandeur, n’a-t-il pas été acquis par la souffrance, à tracer la culture de la grande souffrance ?
Sur les femmes et la culture :
On les rend chaque jour plus hystériques et plus inaptes à suivre leur première et dernière vocation, qui est de mettre les enfants au monde. D’une manière générale, on veut les « cultiver » encore plus, et comme on dit, fortifier par la culture la faiblesse de leur sexe : comme si l’histoire n’enseignait pas avec toute la netteté désirable que la « culture » de l’être humain et son affaiblissement, je veux dire l’affaiblissement , la dispersion, l’alanguissement de la volonté, n’avaient pas toujours marché de pair, et que les femmes les plus puissantes, celles qui ont exercé la plus forte influence (en dernier lieu encore la mère de Napoléon) ont dû leur puissance et leur ascendant sur les hommes à l’énergie de leur volonté, et non pas aux maîtres d’école.
La femme propriété de l’homme :
Un homme profond […] doit voir dans la femme une propriété, un bien qu’il convient d’enfermer, un être prédestiné à la sujétion et qui s’accomplit à travers elle ; il doit se rallier en cette matière à l’incomparable sagesse de l’Asie, à la supériorité de l’instinct asiatique. Ainsi firent les Grecs, héritiers et disciples par excellence de l’Asie, qui d’Homère au siècle de Périclès, et à mesure qu’ils croissaient en civilisation et en force, se montrèrent toujours plus sévères, plus orientaux à l’égard des femmes. Qu’on veuille bien réfléchir à quel point une telle attitude était nécessaire, logique et même humainement souhaitable.
La loi du plus fort :
Des hommes encore tout proches de la nature, des barbares dans tout ce que ce mot comporte d’effroyable, des hommes de proie encore en possession d’une volonté intacte et d’appétits de puissance inentamés se sont jetés sur des races plus faibles, plus policées, plus paisibles, des races soit commerçantes soit pastorales, ou sur de vieilles civilisations usées qui dilapidaient leurs dernières énergies en d’étincelants et mortels feux d’artifice. La caste aristocratique fut toujours, d’abord, la caste des barbares : sa supériorité ne résidait pas avant tout dans sa force physique, mais dans sa force spirituelle ; ils étaient plus complètement des hommes (c’est-à-dire aussi, et à tous les niveaux, plus complètement des brutes).
Le bas peuple :
Or une aristocratie saine ne doit pas se sentir une fonction, soit de la monarchie, soit de la collectivité, mais voir en l’une ou en l’autre son sens et sa plus haute justification ; c’est pourquoi elle devra prendre sur elle de sacrifier sans mauvaise conscience une foule d’êtres humains qu’elle réduira et rabaissera, dans son intérêt, à l’état d’hommes diminués, d’esclaves, d’instruments. Sa croyance fondamentale doit être que la société n’a pas le droit d’exister pour elle-même, mais qu’elle ne doit être que le soubassement et la charpente qui permettront à une élite de se hausser à ses devoirs supérieurs, à la réalisation d’un être plus élevé : semblable en cela à ces plantes grimpantes de Java — on les nomme « sipomatador » — qui tendent vers un chêne leurs bras avides de soleil et l’enlacent si fort et si longtemps qu’enfin elles se dressent au-dessus de l’arbre mais en s’appuyant sur lui, exhaussant leur cime avec bonheur pour l’éployer à la lumière.
Friedrich Wilhelm Nietzsche est né en 1844, mort en 1900 (et fou les dix dernières années de sa vie). De nationalité allemande, philologue de formation, puis philosophe et poète. Sur Wikipedia, on peut trouver sa biographie ainsi qu’une présentation de sa philosophie.
