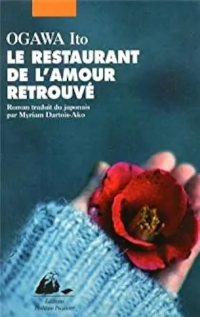
Roman offert par mon cousin Olivier : de la littérature japonaise et un roman traitant d’un restaurant et de cuisine, cela ne pouvait pas me déplaire !
C’est l’histoire de Rinco, une jeune fille vivant à Tokyo, qui perd sa voix quand son petit-ami l’abandonne, et qui décide de retourner dans le village de son enfance où vit encore sa mère, pour y ouvrir un restaurant, nommé « L’Escargot ».
Ce restaurant qui ne dispose que d’une seule table fonctionne de manière un peu particulière, et uniquement sur réservation : Rinco s’entretient alors longuement avec les convives auparavant afin de déterminer le plat qu’elle va leur préparer. Si le modèle économique paraît peu crédible, les plats ainsi préparés vont rendre les clients heureux, et la rumeur va ainsi se propager : en mangeant à L’Escargot, on voyait ses vœux réalisés et ses amours comblées. Il faut dire qu’ils sont justement préparés avec amour, comme Rinco l’explique :
Si tu cuisines en étant triste ou énervée, le goût ou la présentation en pâtissent forcément. Quand tu prépares à manger, pense toujours à quelques chose d’agréable, il faut cuisiner dans la joie et la sérénité. Ma grand-mère me le disait souvent.
C’est donc un hymne à la cuisine japonaise, à son raffinement, à la beauté et au goût unique d’un légume ou d’un fruit qui a poussé dans les meilleures conditions… On retrouve toute la sophistication de la culture japonaise, cette fois sur le côté culinaire.
Pour le reste l’histoire manque un peu de contenu, tout comme les personnages certes originaux mais pas vraiment aboutis. On ne peut pas dire non plus que ce soit très bien écrit, mais c’est le premier roman de cet autrice, on lui pardonnera donc en se concentrant sur les plats préparés et l’attention qui leur est portée.
Ito Ogawa, née en 1973, est une écrivaine japonaise. Ce roman a été porté à l’écran sous le titre de Rinco’s Restaurant. Elle a aussi écrit La papeterie Tsubaki, qui a l’air d’être plus apprécié des lecteurs, avec toujours comme centre d’intérêt la culture japonaise (ici la calligraphie). C’est la tome 1 d’une série de trois : suivent La république du bonheur, et Lettres d’amour de Kamakura. De tous ces romans, il ressort à chaque fois une atmosphère de « feel good story » semble-t-il, à voir si l’on aime ou pas.
L’ochazuke
Et puisque l’on parle cuisine, j’ai retenu son Ochazuke, qu’elle prépare avec le strict minimum, obligée de préparer quelque chose dans l’urgence en n’ayant pratiquement rien sous la main :
Dans l’autocuiseur à riz du bar, il devait rester du riz blanc qui n’avait pas été utilisé pour la soupe de riz, un peu plus tôt. Avec ce morceau de katsuobushi, je pourrais faire un excellent bouillon. Du bouillon et du riz : j’allais préparer un ochazuke tout simple. Je me suis mise à découper avec énergie la bonite séchée en copeaux. En cherchant bien, j’ai même eu la chance de retrouver des algues kombu dans un tiroir.[…] J’ai enlevé les algues de la casserole au bon moment et, après une brève pause, j’y ai versé une généreuse portion de copeaux de bonite fraîchement râpée. Dès que la bonite a commencé à sentir bon, j’ai éteint le gaz et filtré le liquide à la passoire. Jusque-là, tout allait bien, comme d’habitude. Un peu de sel pour finir et ce serait parfait. Puis j’ai rempli un grand bol, réchauffé au préalable, avec du riz pris dans l’autocuiseur, et j’ai versé par-dessus le bouillon que je venais juste de préparer. C’était prêt. Comme il restait quelques brins de ciboule de Hakata sur la planche à découper, je les ai rassemblés et posés sur l’ochazuke.
Voilà d’autres infos ici sur ce plat traditionnel. Il s’agit donc d’un plat tout simple à base de riz et de thé vert (ou de bouillon miso), auquel on vient ajouter un peu ce que l’on veut dans une version moins sommaire que celle du roman. Je pourrais m’inspirer de cette recette et faire mon propre Ochazuke… Car faire un bouillon avec des algues de Bretagne et du Katsuobushi fabriqué à Concarneau, ça devrait être facile non ? 😉

Un plat à base d’algues…
Je sais à qui ça va plaire
C’est vrai qu’un Ochazuke au petit-déjeuner, ça peut en faire rêver certain(e)s ! 😉