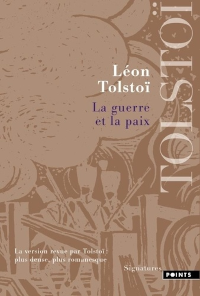
J’avais repéré il y a quelque temps cette édition de la grande œuvre de Tolstoï, d’un tiers plus courte, où les réflexions philosophiques de l’auteur sont réduites à l’essentiel et l’action resserrée (six versions seront publiées du vivant de l’auteur). Ce qui laisse tout de même 1200 pages… Mais bon, j’avais envie de me plonger dans un gros bouquin, et de découvrir ce classique.
Mon impression un peu mitigée tout de même : c’est bien écrit certes, on est dans la lignée des grands auteurs du XIXème, mais l’essentiel est consacré à la description des classes supérieures russes, aux discussions de salon entre princes, comtesses, jeunes ambitieux ou vieux comploteurs, fabuleusement riches ou en quête d’un bon mariage pour se refaire, et où la religion est omniprésente… Certes, cela décrit un monde et une époque, et plutôt bien d’ailleurs, mais on passe beaucoup de temps à décrire un monde superficiel et très convenu. Pour eux, la guerre ou la paix finalement importe peu, ce n’est qu’un sujet de discussion comme un autre, même lorsque Napoléon est à Moscou. Il y a bien un courant réformateur qui circule, aux idées nouvelles, Pierre, un personnage atypique et attachant côtoyant les francs-maçons, mais l’ensemble de la société, de type médiéval, est encore très conservatrice : il y a Dieu, l’Empereur et la Russie éternelle, le reste importe peu.
Il y a deux passages sur la guerre, le premier est traité rapidement et raconte la victoire d’Austerlitz en 1805 face à une armée russe, ses alliés autrichiens et allemands, tous totalement désorganisés, aux généraux incapables car nommés en fonction de leur titre et non de leur compétences. Le second passage, traite un peu plus longuement de la campagne de Russie, et l’auteur finit par nous expliquer que tout ce qui arriva n’est pas le résultat d’une tactique particulière, mais plutôt de l’enchaînement des circonstances : la nature conquérante de Napoléon, la désorganisation de l’armée russe jamais prête pour accepter l’affrontement, jusqu’à la bataille de Borodino, dont Tolstoï explique que chacun s’en déclare le vainqueur, mais que l’on ne peut se réjouir de 80 000 meurtres le même jour au même endroit.
En livrant et en acceptant la bataille de Borodino, Koutouzov et Napoléon agirent de façon involontaire et irréfléchie. Mais ce n’est que par la suite que les historiens falsifièrent en faits avérés des preuves alambiquées de la prescience et du génie des chefs de guerre qui, parmi tous les mécanismes involontaires des évènements du monde, en furent les acteurs les plus serviles et les plus involontaires.
Cela résume bien ce qu’il pense des campagnes militaires, et de ce que l’on en raconte : les soldats qui étaient sur le terrain font d’ailleurs de même, enjolivant ce qui leur est arrivé alors qu’il crevaient de peur. Tolstoï explique même que la guerre peut se résumer à cela : faire peur à l’adversaire le premier, pour qu’il tourne les talons et s’enfuie. En d’autres termes, le premier qui laisse la peur prendre le dessus a perdu la bataille.
Pour revenir à la noblesse russe, les descriptions psychologiques des personnages, tout comme les motivations de leurs actes, donnent tout de même de l’intérêt au récit. L’auteur a beaucoup de recul sur ce monde qu’il connaît bien (il est lui-même un aristocrate), comme il l’explique dans une rapide postface : c’est assez méprisant d’ailleurs, puisqu’il explique qu’il parle de ce monde car de toutes façons celui des marchands, des cochers, des moujiks, etc… n’a aucun intérêt, vu la bassesse de leur condition : leur vie est monotone, ennuyeuse, et tout ce qu’ils font relève de la jalousie, la cupidité et les passions matérielles. Cette postface était d’ailleurs une préface, puisque l’auteur termine en disant « il est encore temps de refermer ce livre ». L’éditeur a semble-t-il préféré déplacer ce court texte en fin d’ouvrage !
Léon Tolstoï (1828-1910) est un écrivain russe. Il est célèbre pour ses romans et ses nouvelles qui dépeignent la vie du peuple russe à l’époque des tsars, mais aussi pour ses essais, dans lesquels il condamne les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Il est excommunié par l’Église orthodoxe russe ; après sa mort, ses manuscrits sont détruits par la censure tsariste. Il veut et entend mettre en lumière dans ses œuvres les grands enjeux de la Civilisation. Guerre et Paix, qu’il met cinq ans à écrire, est considéré comme son œuvre majeure.
