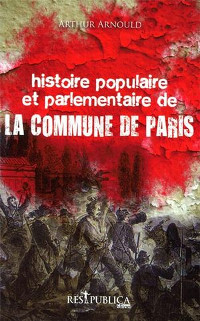 Après La Commune de 1871 – Jacques Rougerie [collection Que sais-je?], écrit par un historien contemporain et offrant un excellent résumé de ce moment de l’histoire où le peuple de Paris se souleva,
Après La Commune de 1871 – Jacques Rougerie [collection Que sais-je?], écrit par un historien contemporain et offrant un excellent résumé de ce moment de l’histoire où le peuple de Paris se souleva,
Après l’Histoire de la Commune de 1871 – Prosper-Olivier Lissagaray, écrit par l’un de ses acteurs, qui en raconte le déroulement au quotidien,
J’ai lu ce livre qui est un bon complément puisque cette fois l’auteur (journaliste, membre du premier conseil de la commune) s’attache à décrire le modèle de société que la Commune voulait organiser. Que pensait-elle ? Que voulait-elle ?
Le ton est sincère, Arthur Arnould s’attache aux faits en bon journaliste, même si, quoiqu’il en dise, l’émotion perce encore dans certains passages. Pourtant il a attendu six ans avant de le publier :
Depuis ce temps, le calme a pu se faire dans l’esprit, la sage raison a pu reprendre son empire sur les désespoirs et les colères du premier moment, et l’exil, morne et froid, a versé sa glace sur les emportements de la lutte.
Je crois donc être, aujourd’hui, dans les meilleurs conditions possibles pour me prononcer, sans exagération comme sans illusion.
Un peu comme Lissagaray d’ailleurs, qui mit cinq ans à publier le sien (« j’ai voulu sept preuves avant d’écrire ») : chez les deux auteurs, on sent ce besoin de tout pouvoir prouver de leurs écrits, tant la vérité est éloignée de ce que le pouvoir et la presse de l’époque ont bien voulu en raconter : l’État est sans pitié pour ceux qui ont osé le remettre en cause.
C’est plutôt bien écrit, le ton est alerte et la plume sait se montrer féroce quand il le faut, comme pour ce portrait :
Ce personnage, c’est M. Clamageran, petit homme tout rond et blafard, bâti comme un boudin, avec une figure de Nuremberg, le teint d’un fromage mou, l’air idiot, et plus idiot que son air.
En guise de préface, on peut lire cette citation (que l’on peut encore méditer de nos jours) :
Aujourd’hui, quoiqu’un fasse, la société est devenue, de militaire ou destructive, industrielle ou productive. Le travail est le maître, — non dans la loi il est vrai — mais dans la réalité scientifique. Les autonomies, les collectivités, quelles qu’elles soient, n’ont plus qu’un intérêt, qu’un besoin : la production abondante, l’échange assuré, la circulation rapide, la répartition universelle. À tout cela, il manque une chose : la justice.
Qui vous la donnera ? Les gouvernements ? Non, vous-mêmes !
Il s’agit d’en finir avec la centralisation du second empire, preuve que les révolutions précédentes avaient échouées à rendre le pouvoir au peuple. À chaque fois, celui-ci avait été rapidement repris par une oligarchie de circonstance, conduisant aux mêmes effets. La Commune, c’est donc autonomie et fédéralisme, réduisant le pouvoir centralisateur à sa plus simple expression.
Le modèle de la Commune, c’est de ne plus confier tout le pouvoir à l’État, sans pour autant le combattre ou nier sa légitimité quand il s’agit des affaires de la nation (rappelons que les prussiens sont aux portes de Paris, et que l’État souhaite signer un armistice très coûteux pour la nation, l’essentiel étant que « les affaires reprennent »…). La commune ne veut pas rendre les armes, réclame autonomie et indépendance, le fédéralisme permettant de structurer les groupes ainsi formés au niveau national.
La France venait d’accomplir une quatrième Révolution victorieuse, et, pour la quatrième fois, le peuple encore tout couvert de la sueur et de la poudre du combat, voyait cette Révolution tombée de fait entre les mains des éternels ennemis du peule. […]
Le 18 mars, le peuple déclara qu’il fallait sortir du cercle vicieux, couper le mal dans sa racine, non plus changer de maître, mais cesser d’avoir des maîtres, et, avec une admirable vision de la vérité, du but à atteindre, des moyens qui pouvaient y conduire, il proclama l’autonomie de la Commune et la fédération des communes.
Le nœud gordien était tranché, la pensée moderne avait trouvé un bras qui s’appelait Paris, et ce bras vigoureux venait de planter la cognée à la racine même du vieil arbre féodal, autoritaire et religieux.
L’ancien monde se sentit frappé de mort, et se souleva tout entier, depuis le gentillâtre idiot et le bedeau du village jusqu’au républicain formaliste, jusqu’au socialiste mystico-sentimentaliste et bourgeois, — depuis Lorgeril jusqu’à Louis Blanc.
Car le République qui avait remplacé l’Empire ne proposait finalement que peu de changements :
Il venait de constater encore que la République de Jules Favre n’aurait ni plus d’entrailles pour le peuple, ni plus d’intelligence des réformes sociales qu’une royauté quelconque, soit que cette royauté sortît des massacres d’une soldatesque avinée, comme en 1851, soit qu’elle sortît de la coalition des exploiteurs, des jouisseurs et des parvenus comme en 1830.
Il résultait de cette trouble expérience, que confier la gérance des intérêts et le statut des droits, soit au despotisme personnel d’un ambitieux, soit au despotisme oligarchique d’une caste, était une égale sottise, présentait le même danger, préparait de semblables mécomptes et des souffrances pareilles pour l’avenir.
Paris avait donc appris le mépris absolu des deux seules formes gouvernementales qui eussent été jusqu’alors en présence dans notre pays : — La monarchie et la République oligarchique ou bourgeoise.Paris ne croyait plus guère, après tant de Révolutions avortées, à l’efficacité de ces grands soulèvements qui lui donnent la dictature pendant huit jours, et qui le livrent à la réaction pendant vingt ans.
Le programme de la Commune était le suivant :
Nous ne voulons pas imposer nos volontés au reste de la France. Nous demandons simplement pour nous-mêmes les droits et les garanties qui nous sont essentiels.
Nous voulons l’autonomie absolue de la Commune de Paris.
Nous voulons nous administrer nous-mêmes.
Nous voulons que, dans l’enceinte de Paris, administration, justice, police, force armée, tout soit à nous.
Nous voulons que tout ce qui touche les impôts, les cultes, l’instruction publique, l’organisation du travail, etc., soit réglé par nous, en ce qui concerne Paris.
Nous ne voulons pas nous séparer de la France.
Nous accepterons les lois générales édictées par le gouvernement central, à condition que ce gouvernement soit républicain, dans tout ce qui ne portera pas atteinte à notre autonomie communale.
Ainsi, nous paierons notre part de la contribution de guerre.
Ainsi, quoique voulant abolir la conscription et les armées permanentes, nous fournirons, en cas de guerre, notre contingent, mais ce contingent nous le lèverons comme nous l’entendrons.
Nous engagerons les autres communes de France à imiter notre exemple, et à se fédérer avec nous.
Nous voulons, en un mot, être maîtres chez nous, y vivre à notre guise, suivant nos convictions et nos besoins.
Que Versailles reconnaisse notre autonomie, et nous ne le combattrons pas.
S’il attaque, nous nous défendrons, étant las de subir le joug des ruraux français.
Nous ne demandons pas que le gouvernement central revienne siéger à Paris. Nous préférons renoncer au titre et aux avantages matériels de la capitale, pour jouir des biens cent plus précieux de notre liberté.
Toutefois, si le gouvernement voulait revenir siéger à Paris, pourvu qu’il n’amène avec lui, ni un homme de troupe, ni un agent de police, et qu’il renonce à s’occuper de nos affaires communales, nous sommes prêts à lui ouvrir nos portes, étant bien entendu que la garde nationale seule sera chargée de veiller sur lui, et de le protéger, comme de nous protéger contre lui.
Voici quelques autres extraits pour apprécier la plume et les opinions de l’auteur :
La bourgeoisie et la révolution
Quand la bourgeoisie a fait ou laissé faire une Révolution, son premier mouvement est de se retourner pour regarder, avec terreur et menace, le peuple qui la suit. Le rejeter sous le joug dont elle s’est affranchie avec son appui, devient sa seule préoccupation.
Plus il a montré sa force, plus il a fait peur, plus il a excité de haine, et plus il a donné de cohésion aux bataillons un instant hésitants de ses implacables tyrans.
Aussi, le lendemain d’une Révolution, loin que le nombre des ennemis du peuple ait diminué, il a doublé.
La veille, ayant à combattre un autre adversaire, qui était le gouvernement établi, une partie de la bourgeoisie semblait marcher d’accord avec le peuple.
Le lendemain, la bourgeoisie n’ayant plus rien à craindre que du côté du peuple, se réunit toute entière contre lui.
Faire peur à ceux qui nous haïssent, sans les désarmer et les frapper, est la plus grande de toutes les fautes.
Les militaires
Amiral ou général, tout ça se vaut ! Attendre de ces gens-là une folie héroïque, ou seulement une initiative quelconque, c’est peine perdue.
L’habitude d’obéir et de commander a complètement oblitéré chez eux le sens moral. Ils ont un honneur qui n’est pas l’honneur, et qui s’appelle honneur militaire. Pourvu qu’ils rendent leur épée d’après certaines régles prévues par leur Code, cet honneur est sauf et leur conscience satisfaite.
Leur courage également est un courage à part, qui s’appelle courage militaire. Ce courage consiste à ne point baisser la tête quand les obus sifflent aux oreilles ; mais il doit cesser aussitôt qu’à certaines murailles il y a certaines brêches de tant de centimètres carrés.
Les soldats
Rien, en effet, ne peut rendre compte du néant moral et intellectuel de ces paysans qu’on arrache ignorants à leur charrue, pour les soumettre au régime immoral et stupéfiant de la caserne.
Sur ce sauvageon, auquel nulle culture n’a fait pousser de fruits, la discipline militaire a greffé l’idiotisme et l’avilissement.
Pour en faire un bête féroce, il ne manque plus que l’odeur de la poudre, la peur et quelques verres d’eau-de-vie.
Les marins, aussi peu instruits, aussi dominés par la discipline, montrèrent cependant une certaine supériorité intellectuelle.
Ils se mêlèrent davantage au mouvement.
Il y a chez eux un côté de fantaisie et une habitude de voir des choses nouvelles, qui les préparent à accepter avec une joie enfantine la nouveauté ! Ils la comprennent mieux ; ils ont l’esprit plus ouvert.
Quand les prussiens entrent dans Paris, Arnould part à Bordeaux pour raconter les faits aux députés d’opposition : il va être déçu.
Les autres me reçurent assez mal. Il était visible qu’ils avaient déjà fait leur siège, et que cette brusque intervention du peuple de Paris les gênait, en les forçant à sortir, d’une façon quelconque, des nuages commodes de l’opposition parlementaire, derrière laquelle s’abritent, depuis si longtemps, toutes les convoitises du pouvoir et tous les compromis de conscience.
Les Louis Blanc, les Langlois, les Tolain et consorts, voulaient rester députés et continuer tout simplement, dans de nouvelles conditions, le petit métier lucratif et sans danger exploité, avant eux, durant vingt ans, par les Jules Favre, les Jules Simon et les Picard.
L’attitude du peuple de Paris les arrachait à ce doux rêve. N’allait-elle pas les forcer à se prononcer catégoriquement, à déchirer le voile qui convenait à la modestie de leur courage, à l’inanité de leurs convictions, à la réalité de leur égoïsme ?
Le métier d’homme politique :
La plupart des vieux hommes politiques, qui ont fait de la politique un métier, qui se sont installés dans une opposition de carton, comme le rat dans son fromage, ont cette vile terreur et cette animosité misérable contre les lutteurs qui se font un nom à leurs côtés, et menacent de gâter le métier, en y apportant plus de passion, plus de sincérité, plus de talent, ou de nouvelles conceptions en rapport avec les besoins vrais de l’époque, et les aspirations du peuple.
Et en parlant de Louis Blanc :
Il y a aussi certains hommes que l’on ne peut fréquenter, écouter, subir, sans éprouver une sorte d’affaissement intellectuel, de relâchement de tous les ressorts de la volonté. Leur parole agréable ou éloquente à l’oreille vous endort, leurs raisonnements captieux, revêtus du masque de la fausse sagesse, de la fausse raison, de la fausse habileté, du faux patriotisme et de la fausse honnêteté, réveillent en vous tous les instincts d’égoïsme et de lâcheté qui rampent au fond des nos cœurs, leur donnent de beaux noms, les transforment en devoirs douloureux mais nécessaires, et vous conduisent à des abdications de principes où vos intérêts personnels trouvent toujours leur compte.
Liberté – Égalité, oui mais :
Le droit théorique est une fort belle chose… dans les livres et dans les Constitutions, mais, en réalité, ce n’est rien, si je suis dépossédé de la faculté, de la possibilité d’en user.
Or, pour un homme privé d’une certaine instruction, pour un homme astreint à l’esclavage de la misère par le salariat qui ne lui laisse aucun moyen matériel ni moral d’améliorer sa situation, il n’y a ni liberté, ni égalité.
Dans de semblables conditions, la souveraineté populaire est un mensonge, le suffrage universel une duperie, plus dangereuse peut-être que la brutalité cynique des anciennes lois franchement négatives.
Les paysans seront manipulés par le gouvernement qui lui décrit les Communards comme des assassins débauchés livrant la ville de Paris à l’anarchie et au pillage :
D’un autre côté, la Révolution avait, en partie, rendu la terre au paysan.[…]
Le paysan a donc gagné, ou, plutôt, croit avoir gagné à la Révolution, tandis que l’ouvrier des villes, lui, n’a absolument bénéficié en rien de la nouvelle situation, puisqu’il n’est point devenu propriétaire de son instrument de travail, et qu’il reste attaché à la glèbe du capital, comme jadis le paysan à la glèbe du seigneur.
Serf autrefois, il rongeait son frein et se sentait solidaire de quiconque souffre, de quiconque est exploité.
Propriétaire aujourd’hui, il s’est fait complice de tous les exploiteurs, et conservateur forcené, sans choix, sans raisonnement, sans mesure, de peur qu’on lui enlève ce morceau de terre, — son idéal, sa passion, son BIEN ! […]
Jadis, il courait sus aux châteaux.
Aujourd’hui, il monterait volontiers la garde à la porte du château, se figurant son arpent de vigne ou de blé solidaire du parc seigneurial, sa chaumière solidaire du château.
Jadis, il se levait à la voix du peuple de Paris démolissant la Bastille.
Aujourd’hui, déguisé en soldat, il égorge avec une férocité implacable l’ouvrier des villes, se figurant que cet ouvrier veut lui ravir sa terre, le dépouiller de sa propriété.
Cette situation explique toutes les Révolutions qui se sont succédées en France, depuis 89, et leur avortement.
Le 18 mars, le premier conseil de la Commune est composé d’anonymes :
Il y avait là à l’hôtel de ville, un gouvernement anonyme, composé presque exclusivement de simples ouvriers, ou de petits enployés, dont les noms, pour les trois quarts, n’avaient guère dépassé le cercle de leur rue ou de leur atelier.
À quelque point de vue que l’on se plaçât, cela avait quelque chose d’inouï et d’effrayant.
Au 4 septembre, comme au 24 février, les noms des hommes portés au pouvoir par la Révolution étaient du moins un programme.
On les connaissait. Ils avaient un passé qui semblait répondre de l’avenir. Ils avaient des antécédents. Satisfaits et mécontents savaient, ou du moins croyaient savoir à qui ils avaient à faire.
Mais cette dictature anonyme, je le répète, que contenait-elle dans ses flancs ?
Ce fut là, dès le premier jour, le grand caractère de cette Révolution du 18 mars.
À l’hôtel de ville, il y avait des hommes dont personne ne connaissait les noms, parce que ces hommes n’avaient qu’un nom : LE PEUPLE !
La tradition était rompue. Quelque chose d’inattendu venait de se produire dans le monde.
À propos de son élection :
Quant à moi, loin de désirer ou de rechercher ce titre, je le redoutais profondément, je le répète, je ne l’acceptai qu’à la façon de ces devoirs écrasants qui vont sont imposés par l’honneur. […]
Quant à moi, je dois dire pourquoi je redoutais mon élection.
J’étais de ceux qui ne se faisaient aucune illusion.
Je connaissais trop les hommes que nous avions à combattre pour attendre d’eux une lueur de justice, de patriotisme, et de simple humanité.
Je savais que d’eux, il n’y avait à attendre qu’une guerre implacable, guerre de calomnies infâmes et de férocité froide.
Arthur Arnould (1833-1895), est un écrivain et journaliste français. De tendance proudhonienne et anarchisante, il appartient à la minorité du Conseil et vote contre la création du Comité de Salut public. Après la Semaine sanglante, il se réfugie en Suisse et ne reviendra en France qu’après l’amnistie de 1880.
