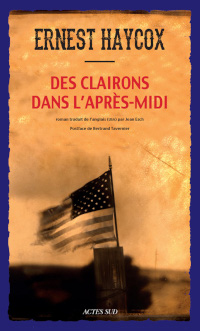
Je continue avec Haycox et j’ai choisi ce roman parce qu’il parle de la bataille de Little Bighorn menée par le fameux général Custer. C’est la plus grande bataille de la guerre contre les Sioux, et leur plus grande victoire, Custer y trouvant la mort.
Hélas, dans les westerns hollywoodiens, la réalité des faits n’est pas le premier critère, et il est toujours délicat de critiquer un général de l’armée américaine (comme dans l’histoire officielle d’ailleurs) : que ce soit dans « La charge fantastique » (Raoul Walsh, 1941) ou « Custer, l’homme de l’Ouest » (Robert Siodmak, 1967), l’homme est exonéré de beaucoup de choses. Il y a bien « Little Big Man » (Arthur Penn, 1970), mais l’histoire est volontairement imaginaire (et loufoque) et ne revendique rien du côté historique. Reste « Le massacre de Fort Apache » (John Ford, 1948), une fiction s’appuyant tout de même sur la bataille de Little Bighorn et dénonçant la vanité d’un alter-ego de Custer.
Bertrand Tavernier faisait l’éloge de ce roman dans la postface des Pionniers :
Haycox avait déjà affiché les mêmes convictions humanistes dès 1942, dans Des clairons dans l’après-midi, qui donnait de la bataille de Little Big Horn et de la guerre menée contre les Sioux une vision complexe, à mille lieues de la grandiose glorification hollywoodienne magistralement dirigée par Raoul Walsh, avec un portrait nuancé, contradictoire mais sévère non seulement de Custer, décrit comme un officier téméraire mais immature et assoiffé de publicité, mais aussi des autres généraux et de la politique indienne de Washington. Néanmoins, il s’agissait d’une fresque historique, centrée autour de l’armée, avec des personnages fouillés, non manichéens, un regard humaniste et tolérant, aussi le sujet, le propos empêchaient qu’on puisse y évoquer de vrais rapports interraciaux, intimes ou collectifs.
Le début du roman est assez passionnant avec l’énigmatique Kern Shafter qui accompagne la jeune Joséphine Russel jusqu’à « la frontière ». Shafter, officier déchu, va se réengager comme simple soldat dans le 7e de cavalerie commandé par Custer. Il y retrouve son ennemi juré le lieutenant Garnett, qui a le talent de savoir séduire les femmes. Là encore, Haycox va s’en donner à cœur joie pour décrire les rapport humains entre ces trois là… Un exercice où il excelle.
Au moment de la bataille de Little Bighorn, Shafter et Garnett seront dans le bataillon du major Reno que Custer a envoyé lancer la première attaque : la situation va très vite se compliquer pour eux, d’autant que pour une raison inconnue, Custer, qui devait prendre les Sioux en tenaille, n’arrivera jamais ; on apprendra juste qu’il est mort, ainsi que son bataillon, victime de ses ambitions et de son sentiment de supériorité. Sans doute une précaution de l’auteur pour s’en tenir à ce qui est officiellement reconnu par tous.
J’ai bien aimé ce roman, le personnage de Shafter est très intéressant, et si l’écriture de Haycox reste simple et directe, les rapports et les dialogues entre les personnages sont vraiment passionnants.
Ernest Haycox (1899-1950) est un écrivain américain, prolifique auteur de westerns. Parmi ses admirateurs, on comptait Gertrude Stein et Ernest Hemingway. Les pionniers (The Earthbreakers), son dernier roman, publié à titre posthume (1952), est sans doute le plus abouti.
Huit de ses œuvres ont été portées à l’écran, tels La Chevauchée fantastique (Stagecoach, 1939), Le Passage du canyon (Canyon Passage, 1946) et Les clairons sonnent la charge (Bugles in the Afternoon, 1952). En 2005, le prestigieux jury des Western Writers comptait Haycox parmi les vingt-quatre meilleurs auteurs de l’Ouest du XXe siècle.
