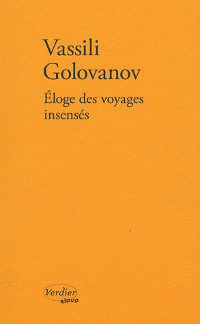 C’est à la radio que j’ai entendu parler de ce livre : Elisabeth Barillé était l’invitée de l’émission « Les racines du ciel » sur France Culture, pour y parler de Lou Andréas Salomé, et de son livre « Lou Andreas Salomé : L’école de la vie ».
C’est à la radio que j’ai entendu parler de ce livre : Elisabeth Barillé était l’invitée de l’émission « Les racines du ciel » sur France Culture, pour y parler de Lou Andréas Salomé, et de son livre « Lou Andreas Salomé : L’école de la vie ».
À la fin de l’émission, on lui demande si elle a un livre à recommander, et c’est ce livre qu’elle mentionne : « pour moi un des plus beaux livres jamais écrit depuis ces vingt dernières années… récit de voyage sur la quête du nord… en l’occurrence, quand on est russe, c’est le fin fond de la Sibérie… récit qui croise les mythes, ses mythes intérieurs, les mythes de l’humanité».
Il n’en fallait pas plus pour me convaincre. Hélas, le livre n’existe pas en poche, et coûte tout de même 29 €…
Le titre pourrait se limiter à « Éloge des voyages », même si celui-ci est effectivement assez insensé, puisque l’auteur se rend sur une île appelée Kolgouev, située dans la Mer de Barents (océan Arctique), et pratiquement déserte. Toujours est-il qu’à lire ce récit, on a une furieuse envie de prendre son sac à dos, même si une destination moins rude ferait aussi bien l’affaire…
La prose de Vassili Golovanov, superbe, nous emporte avec lui dans cette expédition un peu folle ; il nous fait partager ses doutes, ses réflexions, l’histoire de l’île, interroge les anciens, raconte des légendes, montre comment le peu de notre civilisation qui a réussi à venir jusqu’ici a réussi à détruire le mode de vie des locaux ; mais aussi l’expédition pour découvrir l’intérieur de l’île, les longues marches dans la toundra, les difficultés à trouver son chemin dans ce territoire vierge, le froid et l’humidité, la fatigue… tout en décrivant magnifiquement cette nature pourtant si rude.
Un très beau livre sans aucun doute, je l’ai lu tranquillement, et c’était un plaisir de s’y replonger à chaque fois. La presse surnomme l’auteur « le Nicolas Bouvier russe », et avec raison : même capacité à nous emmener dans un récit de voyage. Lui se classe dans les « géographes métaphysiques »…
Voilà quelques extraits pour vous faire une idée :
Les premières lignes du roman :
Dans la chambre d’hôtel glaciale. Sous deux couvertures. En caleçon de laine. Nuit. Pluie derrière la fenêtre.
Pourquoi ? Pourquoi tout cela ? Envie soudaine de manger, de prendre une douche chaude.
Qu’est-ce que je cherche ? l’Île ? Elle a été découverte bien avant moi. L’Île, mon invention saugrenue ! Pas besoin de rêver longtemps pour se représenter ce qu’il y a là-bas. Étendue plate. Toundra. Ciel gris, bas, creusé en labour de nuages sombres. Soleil terne, blafard, toujours caché. Herbes chétives tremblant dans le vent et fleurs de camomille – apothéose de la floraison estivale… Odeur d’humidité, partout des marécages, et le bord de mer qui ne sent que l’argile car l’eau, on ne sait pourquoi, ne sent rien. Jaune, glaciale…
Marche dans la toundra
Et progressivement… très progressivement… cette nuit a commencé. La magie de cette nuit là.
Je n’avais jamais marché de nuit dans la toundra.
Le soleil s’était couché. Ou plutôt, il avait disparu pour deux petites heures, s’enfonçant dans la brume bleue qui avait envahie l’horizon. Les ténèbres du brouillard nous avaient déjà cernés une première fois tandis que nous marchions mais, plus tard, lorsque nous somme parvenus à nous hisser sur le sommet du mont (là où, jadis, était plantée la croix des vieux-croyants) nous avons retrouvé derrière nous l’orange du soleil et le jaune du ciel, taches de gouache fraîche. Quand nous sommes enfin sortis de la forêt de saules, le ciel était déjà refroidi à l’exception d’une bande jaunâtre – fin ruban d’écorce arrachée à l’horizon – qui marquait l’endroit où le soleil avait disparu. Une mer de sombres collines s’étendait devant nous. Je n’avais encore jamais vu une toundra comme celle-ci. Jusqu’à présent, nous n’avions jamais perdu le repère de la plage et, même si nous traversions des lieux déserts, nous sentions toujours la présence de l’homme, ne fût-ce qu’à travers cet alphabet que la civilisation laissait traîner çà et là sur le sable.
À présent, tout avait changé. Plus nous avancions, et plus l’espace se refermait derrière nous, envoûtant et magique. Le vent continuait à rabattre un brouillard marin, glacé, presque aussi humide que la pluie. Duvet, sac à dos, jeans, chaussures, tout était trempé et la peau de renne, bien serrée, était luisante de gel. Le bruit des vagues s’estompait, les cris des oiseaux faiblissaient et, dans la profonde obscurité transparente de la nuit, un pays de rêve s’ouvrait à nous.
Nous suivions le bord escarpé de la rivière, franchissant de temps à autre de profonds ravins creusés par les affluents. En fait, cette nuit-là, il ne se passa rien : nous marchions, nous boitillions et, vaille que vaille, nous avancions, droit devant nous, montant, descendant les versants de collines, puis à nouveau droit devant. Clopin-clopant. Que faire lorsque le soc des eaux a retourné la terre ?
Apparemment, il ne se passa rien d’autre. Mais comment dire l’abîme ténébreux des gorges sous un ciel de nacre translucide ? Le vert sombre des collines bordant les rivières, la traîtrise du crépuscule et le miroitement de l’eau en bas, dans la vallée ? Comment raconter le petit aigle à queue blanche qui s’envola soudain sous les pieds de Petka, silencieux, ailes déployées, à la verticale, presque debout en appui dans l’obscurité ? Ou l’apparition soudaine d’un tapis de mousse venant recouvrir le bord d’un ruisseau ? Les campanules – ou étaient-ce des myosotis – gouttelettes bleues et froides incrustées dans la nuit ? Comment dire que plus la nuit s’avançait, plus l’aube se rapprochait, plus les couleurs flamboyaient, enchanteresses, incroyables ?
Le fils du Chaman
Il avait vu beaucoup de choses. Il avait vu comment les hommes avaient brutalement rompu les liens avec l’indicible, et comment le monde s’était effondré, privé de ses invisibles soutiens. Les gens de l’île n’égorgèrent plus les rennes ; au lieu de cela, ivres, ils commencèrent à les tuer, à leur fracasser la tête avec des barres de fer. Ils ne purent plus vivre sans biens matériels, ils perdirent leur endurance et leur sagesse de loup chasseur, ils devinrent méchants et insatiables comme des chiens et, comme les chiens, paresseux et dociles. Ils préférèrent la vodka à la vie lente et vide du temps jadis, lorsque son père était encore là, vie si rude, mais si merveilleuse. Assis sur les collines, ils chantaient tout en alimentant un maigre feu de brindilles arrachées à un buisson de la toundra.
L’intérêt des civilisés
La véritable raison devait provenir de l’intérêt illimité que nous autres, les « civilisés », portions à la « sauvagerie » des autres peuples, ainsi que notre volonté de nous approprier leurs cultures sous un prétexte « scientifique ». Cette démarche leur a causé tant de tort ! Tout ce qui avait été pris à ces peuples aux différents stades de leur développement culturel : les tambourins, les masques de chaman, les breloques, les poupées des sadeev (des idoles), les ustensiles d’usage courant, les superbes vêtements portés lors des fêtes ou à l’occasion de rites, tout cela était mort, s’était desséché dans nos musées sans pour autant faire partie d’une culture commune. Ce qui est normal. Nous ne savions pas utiliser ces objets parce que nous n’en avions pas besoin, et la seule chose dont nous ayons été capables avant de les reporter dans nos registres, fut de les trier selon l’idée que nous avions de ces cultures. Dans le meilleur des cas, ils devenaient des pièces de musée ; ex. n°… Et ces fragments inanimés de cultures jadis vivantes montraient à quel point notre science pragmatique pouvait devenir mortelle. Je pense que mon désir de voir la petite corbeille de Siirt n’était, en fin de compte, que de la curiosité, rien de plus. Alors que pour Grigori Ivanovitch, cette petite corbeille et – qui sait ? – le fait de vouloir qu’elle reste cachée, avait un lien avec ce qui avait existé, existait, et existerait dans l’Île ; avec quelque chose de très personnel et, en même temps, de très important dans les rapport avec les Siirts : cet objet pouvait devenir un atout, au cas où… Conservé entre ses mains, sur cette terre, il confirmait la permanence du temps et celle de la légende…
Je mis longtemps à m’habituer à ces pensées sans toutefois parvenir à y adhérer pleinement. Je me souviens que j’éprouvais souvent le désir de « déterrer » quelque chose : les tombes des vieux-croyants, puis la bougra (une hutte de terre) en amont de la Pestchanka, où avait vécu une famille de Nenets transplantée sur l’île à la fin du XVIIIe siècle. Alik évoqua l’existence de cette bougra par hasard et, pendant quelques longues et douloureuses minutes, je fus en proie à une méchante fièvre de chercheur d’or, prêt à modifier sur-le-champ notre itinéraire pour aller fouiller. Je pense que c’est l’absence de pelles qui m’a arrêté. Lorsque je repris mon calme, je demandai à Alik pourquoi personne ne m’avait parlé de cette bougra plus tôt.
— Et pour quoi faire ? demanda-t-il avec un tranquille étonnement.
Vassili Golovanov, né en 1960 à Moscou, est un journaliste, voyageur et écrivain. Cet ouvrage, publié en France en 2008, a reçu le prix de la Russophone et le prix Laure-Bataillon de la Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs de Saint-Nazaire.
