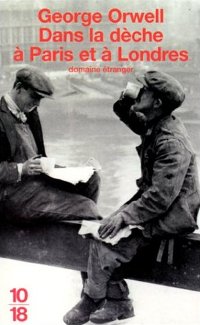 George Orwell, avant d’écrire 1984, a apparemment pas mal galéré, comme le raconte ce petit livre autobiographique intitulé Down and out in Paris and London dans sa version originale. Né aux Indes Britanniques en 1903, George Orwell s’engage six ans dans l’armée impériale en Birmanie, dont il démissionnera pour se consacrer à l’écriture.
George Orwell, avant d’écrire 1984, a apparemment pas mal galéré, comme le raconte ce petit livre autobiographique intitulé Down and out in Paris and London dans sa version originale. Né aux Indes Britanniques en 1903, George Orwell s’engage six ans dans l’armée impériale en Birmanie, dont il démissionnera pour se consacrer à l’écriture.
C’est à cette époque qu’il vient en Europe et va connaître la misère et la pauvreté entre Londres et Paris (1928-1930). Il participera ensuite à la guerre d’Espagne, luttant contre le totalitarisme. Son roman le plus connu, 1984, est publié en 1949. Il meurt à Londres en 1950.
C’est donc d’une sorte de journal qu’il s’agit, où George Orwell nous raconte ses galères pour survivre, et nous fait pénétrer le monde des classes défavorisées de cette époque.
Le sujet de ce livre c’est la misère, et c’est dans ce quartier lépreux que j’en ai pour la première fois fait l’expérience – d’abord comme une leçon de choses dispensée par des individus menant des vies plus impossibles les unes que les autres, puis comme trame vécue de ma propre existence. C’est pour cela que je m’efforce de planter au mieux le décor.
Première partie à Paris donc, dans la dèche la plus totale, ne mangeant pas tous les jours, mettant ses fringues au clou…
C’est à ce moment là que je commençai à comprendre ce que signifie vraiment la pauvreté. Car six francs par jour, si ce n’est pas à proprement parler la misère, ce n’en est pas loin. Avec six francs par jour, on peut encore subsister à Paris, à condition de savoir s’y prendre. Mais l’affaire n’est pas de tout repos.
Curieuse sensation qu’un premier contact avec la «débine». C’est une chose à laquelle vous avez tellement pensé, que vous avez si souvent redoutée, une calamité dont vous avez toujours su qu’elle s’abattrait sur vous à un moment ou à un autre. Et quand vient ce moment, tout prend un tour si totalement et si prosaïquement différent. Vous vous imaginiez que ce serait très simple : c’est en fait extraordinairement compliqué. Vous vous imaginiez que ce serait terrible : ce n’est que sordide et fastidieux. C’est la petitesse inhérente à la pauvreté que vous commencez à découvrir. Les expédients auxquels elle vous réduit, les mesquineries alambiquées, les économies de bouts de chandelle.
Les portraits sont sans concession, ni illusion :
Elle disait à qui voulait l’entendre que, dans le temps, elle avait été actrice. Péripatéticienne serait sans doute plus proche de la vérité, car la plupart des prostituées finissent leur vie comme femme de ménage. Cela faisait une curieuse impression de voir que, malgré son âge et sa condition présente, elle continuait à porter une perruque d’un blond éclatant, à se mettre du noir aux yeux et à se maquiller comme une fille de vingt ans. Il faut croire que soixante-dix-huit heures de travail par semaine ne suffisent pas à étouffer toute envie de vivre chez l’être humain.
Il finit par trouver un boulot de plongeur dans un grand hôtel, et c’est une occasion de plus de décrire de près un monde incroyable, qui ne donne guère envie d’aller dans un hôtel, et encore moins d’y manger ! Espérons qu’avec les règles d’hygiène actuelles, il soit totalement révolu. Il travaille dur dans des conditions qui le sont également. Une fois payé sa chambre et mit de côté l’argent du métro, de son tabac et des repas du dimanche, il lui reste qutre francs par jour «à dépenser en boisson».
On éprouvait – c’est difficile à exprimer – une sorte d’épaisse satisfaction, la satisfaction que doit avoir un animal convenablement engraissé, à l’idée que la vie était devenue si simple. Car rien ne peut être aussi simple que la vie d’un plongeur.
Au-delà de la description d’un monde, c’est aussi une critique sociale sans appel :
Si vous parlez à un riche n’ayant pas abdiqué toute probité intellectuelle de l’amélioration du sort de la classe ouvrière, vous obtiendrez le plus souvent une réponse du type suivant :
«Nous savons bien qu’il n’est pas agréable d’être pauvre; en fait, il s’agit d’un état si éloigné du nôtre qu’il nous arrive d’éprouver une sorte de délicieux pincement au cœur à l’idée de tout de que la pauvreté peut avoir de pénible. Mais ne comptez pas sur nous pour faire quoi que ce soit à cet égard. Nous vous plaignons – vous les classes inférieures – exactement comme nous plaignons un chat victime de la gale, mais nous lutterons de toutes nos forces contre toute amélioration de votre condition. Il nous paraît que vous êtes très bien où vous êtes. L’état des choses présent nous convient et nous n’avons nullement l’intention de vous accorder la liberté, cette liberté ne se traduirait-elle que par une heure de loisir de plus par jour. Ainsi donc, chers frères, puisqu’il faut que vous suiez pour payer nos voyages en Italie, suez bien et fichez-nous la paix.»
Cette attitude est notamment celle des gens intelligents, cultivés. On la retrouve en filigrane dans plus de cent essais. Parmi les nantis de la culture, bien rares sont ceux qui disposent de, mettons, moins de quatre cents livres par an, et c’est tout naturellement qu’ils épousent la cause des riches, parce qu’ils s’imaginent que toute bribe de liberté concédée aux pauvres menacerait la leur. Redoutant de voir un jour se matérialiser quelque sinistre utopie marxiste, l’homme cultivé préfère que les choses restent en l’état. Il ne porte peut-être pas dans son cœur le riche qu’il côtoie quotidiennement, mais il ne s’en dit pas moins que le plus vulgaire de ces riches est moins hostile à ses plaisirs, plus proche de ses manières d’être qu’un pauvre, et qu’il a donc intérêt à faire cause commune avec le premier. C’est cette peur d’une populace présumée dangereuse qui pousse la plupart des individus intelligents à professer des opinions conservatrices.
Puis il ira à Londres, où un ami lui a promis du travail. Hélas, il devra patienter et se retrouvera encore à errer de lodging-house en asile de nuit (la loi anglaise les obligeant à ne pas dormir deux fois au même endroit), clochard parmi les clochards. Autre occasion de sujet d’étude :
Si vous abordez un passant et lui demandez s’il n’a pas deux pence pour vous dépanner, ce passant peut appeler un agent qui vous mettra en sept jours au bloc pour mendicité. Mais si vous cassez les oreilles de vos contemporains en chantant « Plus près de Toi mon Dieu », ou tracez quelques gribouillis à la craie sur le trottoir, ou encore si vous vous promenez avec un plateau chargé de boites d’allumettes – bref si vous vous muez en casse-pied patenté – on considère que vous vous livrez à une activité licite.
S’en suit une analyse pertinente du statut social des mendiants, et pourquoi ils sont méprisés par la société.
Je crois quant à moi que c’est tout simplement parce qu’ils ne gagnent pas «convenablement» leur vie. Dans la pratique, personne ne s’inquiète de savoir si le travail est utile ou inutile, productif ou parasite. Tout ce qu’on lui demande, c’est de rapporter de l’argent. Derrière tous les discours dont on nous rebat les oreilles à propose de l’énergie, de l’efficacité, du devoir social et autres fariboles, quelle autre leçon y a-t-il que «amassez de l’argent, amassez-le légalement, et amassez-en beaucoup» ? L’argent est devenu la pierre de touche de la vertu. Affrontés à ce critère, les mendiants ne font pas le poids et sont par conséquent méprisés. Si l’on pouvait gagner ne serait-ce que dix livres par semaine en mendiant, la mendicité deviendrait tout d’un coup une activité «convenable». Un mendiant, à voir les choses sans passion, n’est qu’un homme d’affaire qui gagne sa vie comme tous les autres hommes d’affaire, en saisissant les occasions qui se présentent.
Un bon bouquin donc, décrivant une époque pas si lointaine… Beaucoup de choses ont-elles d’ailleurs vraiment changées ? sur les conditions de travail, certainement, oui. Pour le reste…

Une réflexion sur « Dans la dèche à Paris et à Londres – George Orwell »