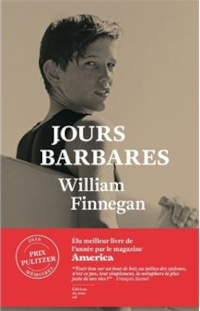
Ce livre était proposé par François Busnel lors de son émission « La p’tite librairie ». Le sujet m’a plu, l’histoire d’une vie, même si j’étais averti qu’il y avait « beaucoup de surf » dans ce récit.
Beaucoup de pages sur le surf donc, mais on y apprend tout de même beaucoup de choses, en particulier la complexité des connaissances à acquérir sur un spot pour en apprécier les qualités et savoir choisir les vagues : les vents, les fonds, la houle, le take-off, la météo, etc… Il faut beaucoup de temps et d’abnégation pour y arriver. Sans oublier les dangers de ce sport, entre les récifs sur lesquels on peut être projeté, et la vague qui vous plaque sous l’eau qui vous obligera à attendre de remonter à la surface pour respirer à nouveau ; si à ce moment là une deuxième vague vous renvoie au fond, cela peut devenir très compliqué…
En dehors de ça, la vie de ce jeune homme passionné qui quitte tout, réfractaire au système, est très intéressante : nous sommes dans les années 70, en Californie :
Avec véhémence, je me faisais l’avocat de l’insoumission, qui, sans doute, modèlerait un peu mon futur, et commençait déjà à bouleverser l’existence des frères aînés de certains de mes amis. La guerre du Vietnam était mauvaise, pourrie jusqu’à l’os. Dans ma tête, l’armée, le gouvernement, la police et les grandes entreprises se confondaient. Comme soudés les uns aux autres, en une unique masse oppressive… le Système, le Pouvoir. C’était à l’époque, bien entendu, l’idéologie politique courante chez les jeunes, et je n’ai pas tardé à ajouter les autorités scolaires à l’ennemi. Mon attitude désinvolte, voire méprisante, à l’égard de la loi, n’était surtout qu’une rémanence de l’enfance, où le défi et les ennuis auxquels on peut se soustraire forment une bonne partie de la gloriole.
C’est bien sûr une époque, mais sa façon de penser et de voyager (au moins dans les premières années), de vouloir s’imprégner des coutumes locales, ça m’a parlé. Parti de Californie à Hawaï avec un ami, il poursuit sa quête des vagues à travers le Pacifique Sud, toujours vers l’ouest : les îles Fidji, Samoa, jusqu’à l’Australie, puis l’Afrique du Sud, où il va se retrouver enseignant dans une école réservée aux Noirs, en plein Apartheid. Cette expérience sera fondatrice. Il va revenir aux États-Unis, à New-York, et y devenir journaliste et écrivain. Mais malgré tout, malgré les années qui commencent à peser physiquement (car le surf demande beaucoup d’énergie), il continue de surfer, encore et encore…
Voilà un autre extrait vers la fin du livre, empreint de nostalgie sur une époque désormais révolue, où le surf était la passion de quelques uns, et où les meilleurs spots étaient un secret jalousement gardé :
Cinq planches de surf rouge sang sont boulonnées à un mur de granit de Times Square. Depuis 1987, date à laquelle j’ai commencé à travailler pour le New Yorker, j’ai traversé Times Square par tous les temps, mais je n’ai commencé à m’y sentir mal à l’aise qu’au cours de ces dernières années. En grande partie à cause de ces planches. Ce sont des pintails en single, au nose élégamment mais exagérément effilé. Ce ne sont pas de vraies planches, seulement un décor – la vitrine d’un point de vente Quiksilver –, mais leur contour en goutte d’eau étirée me rappelle viscéralement un moment de ma vie et un lieu (Hawaï, la fin de mon adolescence), où des planches de forme identique étaient du dernier cri lorsqu’on prenait les plus grandes vagues. Mais, en plus, il y a cette vidéo qui passe en boucle sur les nombreux grands écrans qui surplombent le même magasin. Pour tous les autres passants, ce n’est sans doute que clinquant et plaisir pour les yeux. Cette vague turquoise qui roule d’un écran à l’autre ? Je la connais, cette vague. Elle se trouve dans l’est de Java, à la lisière d’une jungle. Bryan et moi avons campé là-bas, dans une cabane branlante au sommet d’un arbre. C’était dans une vie antérieure. Pourquoi faut-il qu’ils montrent ici cette vague précisément ? Et ce jeune gars qui, le dos voûté, glisse dans ses profondeurs ? Je sais qui c’est. C’est un personnage curieux, en raison surtout de son refus d’exploiter son talent. Il ne concourt pas, ne se livre pas non plus à des démonstrations ostentatoires dans les situations qui, de toute évidence, devraient les appeler. Ses sponsors, dont Quiksilver, le paient pour surfer ainsi avec obstination et style : une sorte de Bartleby postmoderne, admiré dans tout le milieu du surf pour son déni de tout. Et alors, si je reconnais au premier coup d’œil ce flemmard qui enfile un tube indonésien qui m’est familier, quelle importance ? Eh bien, c’est parce qu’il me semble, parfois, que ma vie privée, une partie importante de mon âme, est exposée là, livrée au regard de tous, comme n’importe quelle affiche publicitaire vantant telle camionnette ou tel crédit à la consommation, et ce, sur toutes les surfaces où mes yeux se posent, y compris, dernièrement, sur les écrans de télévision des taxis. Les surfeurs espèrent avec amertume que le surf se ringardisera un jour comme la pratique des rollers. Alors, peut-être, des millions de kooks renonceront-ils et laisseront-ils les vagues aux seuls purs et durs. Mais les multinationales qui cherchent à fourguer l’image et l’idée du surf sont bien décidées, naturellement, à “promouvoir ce sport”.
Dans ce dernier chapitre, malgré la nostalgie d’une époque, l’auteur garde toujours l’amour et l’envie d’aller surfer dès qu’il en a la possibilité, et c’est sans doute le message qui reste après cette lecture : l’histoire de la passion d’une vie, jamais reniée et jamais épuisée.
William Finnegan, né en 1952, est un écrivain et journaliste américain. Il s’est particulièrement attaqué aux questions du racisme et des conflits en Afrique australe et de la politique au Mexique et en Amérique du Sud. Ce livre (titre original : « Barbarian Days: A Surfing Life« ) a reçu le prix Pulitzer 2016 pour la biographie ou l’autobiographie.
