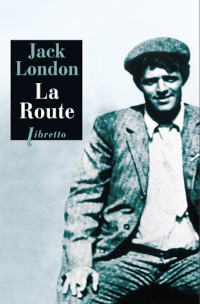
C’est ma sœur Dominique qui m’a parlé à maintes reprises de cet auteur à la vie incroyable, dont j’avoue être passé un peu à côté (j’ai du lire Croc-Blanc à l’adolescence, je n’en ai aucun souvenir).
J’ai donc fait ma petite sélection parmi ses œuvres, et décidé de commencer par celui-ci, où Jack London nous raconte ses aventures de hobo (sorte de vagabond, ou travailleur sans domicile) pour nous en expliquer les bases, ce qu’il faut faire, ou éviter… Un témoignage intéressant de l’époque.
Connu en France sous le titre « Les vagabonds du rail », son titre original « The road » a inspiré Jack Kerouac pour son célèbre « On the road ».
Dès le premier chapitre, il nous démontre qu’il est un beau parleur, car pour mendier, il faut savoir inventer une histoire dès la première seconde, et pas une histoire que l’on raconte tout le temps et à tout le monde, mais une histoire adaptée à votre interlocuteur, qui va le faire flancher… En une fraction de seconde, au premier regard, il faut être capable d’inventer une histoire propre à arriver à ses fins ! Du coup, en lisant son récit, je me demandais quelle était la part de vérité ! 😉
La mendicité, il en a honte au début, puis finit par la voir comme un exercice intellectuel :
De ma vie je n’avais encore tendu la main ; ce fut la plus dure épreuve dont j’eus à souffrir en partant sur le trimard. Sur ce chapitre j’avais des notions absurdes. D’après ma philosophie, il était plus digne de voler que de demander l’aumône : le vol était plus noble, parce que le risque et le châtiment étaient proportionnellement plus grands. En tant que pilleur d’huîtres, j’avais déjà récolté des condamnations qui m’eussent valu, si j’avais dû les purger, un séjour d’un millier d’années dans les prisons d’État. Voler était un acte viril ; mendier était sordide et méprisable. Mais je devais modifier plus tard cette façon de voir ; je finis par considérer la mendicité comme une joyeuse farce, une aimable plaisanterie, une gymnastique de l’audace.
L’époque est difficile, sans travail, avec cette incroyable histoire que celle de l’armée du « général Kelly », 2000 hommes traversant le pays, que Jack London a suivi quelque temps. Voilà ce que nous apprend sur cet épisode Jean-François Duval dans son excellente postface :
Durant les années 1893-1894, les États-Unis traversaient une crise économique telle qu’ils n’en connaîtront plus avant 1929. Rarement dans l’histoire de ce pays, on aura vu autant de vagabonds: ils sont des millions. Bon nombre d’entre eux, pleins d’espoir, s’étaient dans les années de prospérité rués vers l’Ouest : la fortune était au bout du chemin, et en effet du travail les y attendaient. Mais tout à coup, les voilà chômeurs, c’est le temps du reflux, du retour vers l’Est, d’une immense désillusion. Le 25 mars 1894, à l’initiative d’un petit industriel idéaliste de l’Ohio, Jacob S. Coxey, un mouvement se crée qui veut contraindre le gouvernement fédéral à réagir. Coxey projette une marche sur Washington qui doit réunir cent mille chômeurs. Le nombre sera loin d’être atteint, mais cette pétition « portant bottes aux pieds » va tout de même prendre une ampleur spectaculaire dont la presse fera ses gros titres : elle réclame le lancement d’un programme de travaux publics et l’affectation de fonds à la construction de routes. Répondant à cet appel, des milliers de sans-emploi et d’exclus rejoignent des « armées industrielles » qui surgissent spontanément dans les États de Californie, d’Oregon, de Washington, d’Idaho, du Montana, dirigés par des leaders s’autoproclamant « généraux ». […] Ces troupes qui se déplaçaient […], procédaient dans l’ensemble avec discipline, ordre, respect des lieux traversés. Dans certaines villes, elles sont accueillies et saluées par curieux, sympathisants, comité de soutien et détachements de police ; dans d’autres – c’est fonction de la sensibilité politique du coin -, l’inquiétude des autochtones est manifeste et l’on se réjouit de voir ces milliers d’importuns déguerpir – d’autant qu’il s’agit d’assurer leur ravitaillement gratis. Alors que les responsables des compagnies de chemins de fer en appelent à la police ou à l’armée pour expulser les hobos des trains de marchandises qu’ils ont réquisitionnés, la population locale, elle, voudrait au contraire les y maintenir ou les y remettre pour les voir repartir aussi vite qu’ils sont arrivés !
On voit même dans le récit de London que des trains sont affrêtés spécialement pour se débarrasser des hobos, aux frais de la ville !… Bref, un petit récit sans prétention et bien sympathique.
Jack London (1876-1916) est un écrivain américain dont les thèmes de prédilection sont l’aventure et la nature sauvage. Il a connu le succès après des années de pauvreté, de vagabondage et d’aventures. Il ne faut le réduire à un écrivain pour adolescents avec ses succès « L’Appel de la forêt » ou « Croc-Blanc », son œuvre est beaucoup plus vaste et aussi politiquement engagée.
