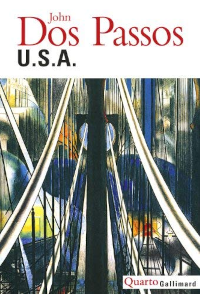
« Je tiens Dos Passos pour le plus grand écrivain de notre temps ». Signé : Jean-Paul Sartre, à propos de « 1919 », le second volet de cette trilogie appelée U.S.A.
J’avais déjà entendu parler en bien de cet auteur, mais aussi de la difficulté à lire certains de ses ouvrages. Après m’être renseigné, je me suis lancé dans la lecture de cette trilogie retraçant le début du vingtième siècle aux États-Unis à travers le destin de personnages appelés à se croiser ou pas.
La première chose que j’ai envie de dire, c’est l’extraordinaire fluidité du texte : j’ai été littéralement absorbé par la vie de ces personnages, que l’on voit se dérouler sous nos yeux. Je relevais parfois la tête, encore saisi par le récit, me rendant compte tout à coup du morceau de vie qui vient d’être raconté… Dos Passos adopte un style « behavioriste », à savoir qu’il raconte les faits sans porter de jugement ni s’attarder sur la psychologie de ses personnages : c’est au lecteur de se construire sa propre idée. D’où l’espèce de vertige qui nous envahit quand on prend soudainement conscience du pan de vie qui vient de s’écouler.
Chaque chapitre porte le nom d’un personnage, puis on passe à un autre, pour revenir au précédent (ou pas). Dos Passos intercale entre eux des sections un peu particulières, appelées « Actualités » et « L’Œil-caméra ». Le premier type est composée d’extraits de coupures de presse, publicités, chansons populaires, et se lit à peu près facilement, donnant même un peu de cadre historique au récit. Le second est très particulier, composé des morceaux de phrases collés les uns aux autres (qui sont autobiographiques nous apprend la préface), et je les ai lues je l’avoue en diagonale. De courtes biograpĥies de personnages marquants de l’époque sont aussi insérées de-ci de-là, souvent caustiques, toujours pertinentes.
Hormis cette particularité, j’ai dévoré les 1200 pages de ces trois romans :
« Le 42e paralèlle » suivi de « 1919 » puis « La grosse galette ». Avec tout de même une préférence pour le premier, où les personnages sont des gens proche du peuple, qui essaient de s’en sortir dans la vie, y arrivant ou pas. Je pense à Mac attiré par les mouvements ouvriers révolutionnaires de l’époque, ou Janey sa sœur qui essaie de s’en sortir et où l’on voit la difficile condition des femmes de cette époque.
Époque d’ailleurs terriblement conservatrice, où le mariage semble déjà bien mal perçu par les femmes, ressemblant plus à une impasse qu’à un épanouissement. Les hommes ne pensent qu’à coucher avec elles sans s’engager, alors qu’il y a pas vraiment de solutions de contraception. Ajoutez une morale religieuse à tout cela, et vous avez le tableau d’une société qui ne laisse aucune place à la nostalgie.
« 1919 » est consacré à l’époque de la première guerre mondiale. Celle-ci n’est pas traitée directement, au départ on voit plutôt des américains volontaires partir comme ambulanciers ou infirmiers, qui passent plus leur temps à se saouler ou à rechercher une conquête féminine qu’à autre chose. On perçoit l’immense foutoir derrière tout ça, et l’énorme démotivation des combattants, qui partent à l’assaut en criant « À bas la guerre ! ». Aucun n’y croit, c’est le marasme (et le massacre) complet, on parle des bolcheviques, des allemands qui n’en pensent pas moins, et de la révolution ouvrière à l’œuvre de chaque côté, à bas le capitalisme ! D’autres pensent à leur carrière et déjà à l’après-guerre. Les personnages du roman sont souvent dans les salons, à boire du champagne et se saouler au whisky. La fin du tome est tout de même marquée par les troubles ouvriers, les syndicats, le traitement qu’on leur réserve. Une brève bio de Henry Ford, personnage aux idées bien arrêtées et rétrogrades, fervent adepte du Taylorisme dans ses usines (Frederik Taylor a aussi droit à sa bio) , antisémite qui ramena d’Europe le protocole des Sages de Sion dont il fera la promotion. J’avais déjà entendu cette histoire sur un podcast France Culture, Ford est largement impliqué dans le développement du sentiment antisémite.
« La grosse galette », c’est l’après-guerre, la capitalisme à l’œuvre, les débuts de l’industrie aéronautique. L’on est définitivement dans les milieux d’affaire, l’alcool coule à flot malgré la prohibition, au point de se demander si cette dernière n’était pas un mal nécessaire : beaucoup de personnages sont carrément alcooliques. Dos Passos semble oublier totalement la classe ouvrière pour se concentrer sur un monde de privilégiés ou qui tentent de l’être.
Côté historique, et comme Dos Passos s’abstient aussi de commentaires sur le contexte, on en est réduit à ses propres interrogations. J’aurais bien voulu en savoir plus par exemple sur ce président Woodrow Wilson (démocrate) qui avant guerre va lutter contre les trusts et autoriser les grèves ; et qui réélu en 1916 sur la promesse de ne pas entrer en guerre, y engagera pourtant le pays quelques mois plus tard. À la fin de la guerre, la conférence de Paris est l’occasion d’interminables tractations : si Dos Passos insiste bien sur la durée inhabituelle de celle-ci, il ne nous éclaire en rien là non plus. On connaît aujourd’hui l’influence de ces accord sur le seconde guerre mondiale, le partage du monde, etc… C’est un peu la limite de son œuvre : il raconte merveilleusement, mais n’explique rien.
Il me semble qu’après-guerre, aux États-Unis, un virage est pris : la parti communiste est déclaré illégal, les immigrants sont pointés du doigt (venant d’Europe avec leurs utopies socialistes), les grèves ouvrières sont durement réprimées ; parallèlement la prohibition est déclarée, les capitalistes spéculent, et la grande dépression de 1929 arrive. Tout ceci fait le lien avec l’époque de la « contre-révolution » chère à Jean-Patrick Manchette qui arrive, avec l’essor de la pègre américaine, et l’organisation totalitaire de la société démocratique (voir cet article), d’où naîtra le polar à l’américaine, le fameux « hard boiled ».
John Dos Passos (1896-1970) est un écrivain et un peintre américain. Cette édition comporte comme toujours une biographie, l’occasion de voir que Dos Passos est un grand érudit, sans doute assez mondain, qui voyagea et écrivit beaucoup. Son autre succès littéraire est Manhattan Transfer, dont le personnage central est la ville de New-York, décrite à travers de multiples personnages ; le reste de son œuvre semble plus difficile d’accès d’après ce que j’ai pu voir.
Philippe Roger explique dans son excellente préface le parcours politique atypique de Dos Passos :
C’est son parcours d’homme des Lumières et de progressiste devenu, à la fin de sa vie, hostile à toute réglementation sociale, consacrant même ses dernières forces à polémiquer contre la loi de huit heures par haine de l’interventionnisme d’État – c’est ce bizarre trajet de la gauche la plus « libérale » à la droite extrême, au nom de la tradition libertarian américaine, que John Dos Passos reproduira pour son propre compte, passant du socialisme anarchisant de sa jeunesse et du militantisme aux côtés des communistes à la défiance envers le « collectiviste » Franklin Delano Roosevelt – jusqu’à épouser la cause du maccarthysme dans les années 1950 et à rallier l’aile droite du Parti républicain dans les années 1960. Mais qui lui eût fait cette prédiction dans les années 1930, du temps de U.S.A., aurait sans doute été mal reçu…
L’un des moments clés de revirement est sans doute la guerre d’Espagne, quand son ami républicain José Roblès est assassiné au nom du « communisme de guerre » par les staliniens. Ce sera aussi le début de sa brouille avec Hemingway, qui persistera à nier le noyautage des staliniens pourtant bien réel lors de la guerre d’Espagne.
