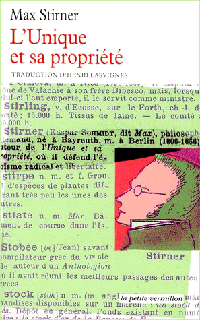 Voilà un livre dont j’avais déjà entendu parler plusieurs fois, d’abord par Michel Onfray, puis au fil des lectures : souvent cité, toujours critiqué ou tourné en dérision (Marx l’appelle Sancho…). Publié en 1844, il est immédiatement censuré, puis autorisé deux jours plus tard car « trop absurde pour être dangereux » ! Alors forcément, tout ça donnait envie de le lire.
Voilà un livre dont j’avais déjà entendu parler plusieurs fois, d’abord par Michel Onfray, puis au fil des lectures : souvent cité, toujours critiqué ou tourné en dérision (Marx l’appelle Sancho…). Publié en 1844, il est immédiatement censuré, puis autorisé deux jours plus tard car « trop absurde pour être dangereux » ! Alors forcément, tout ça donnait envie de le lire.
La lecture n’a pas été facile, car Stirner tourne et retourne la même idée dans tous les sens, sans relâche et sous tous les angles, jusqu’à vous tourner la tête. Paradoxalement, je n’ai jamais fait autant de marques dans la marge, tant ses jugements sont percutants. Heureusement, le ton est plutôt agréable, l’auteur ne se réfugiant pas derrière des concepts philosophiques abscons.
De quoi s’agit-il ? un véritable réquisitoire contre toute aliénation de l’individu, que ce soit la religion, la philosophie, l’humanisme, l’État, le socialisme, le communisme… et par conséquent une apologie de l’égoïsme qui seul peut nous rendre notre liberté. Stirner refuse toute sujétion, rien n’est au-dessus de son Moi, et il l’annonce clairement dès les premières lignes :
Qu’y a-t-il qui ne doive être ma cause ! Avant tout la bonne cause, puis la cause de Dieu, la cause de l’humanité, de la vérité, de la liberté, de la justice, la cause de mon peuple, de mon prince, de ma patrie et jusqu’à celle de l’esprit et mille autres. Seule ma cause ne doit jamais être ma cause. « Anathème sur l’égoïste qui ne pense qu’à soi! ».
Voyons donc comment ils l’entendent, leur cause, ceux-là mêmes qui nous font travailler, nous abandonner, nous enthousiasmer pour elle. […]
Pour Moi, il n’y a rien au-dessus de Moi.
Il prône l’égoïsme donc, ce qui pose forcément le problème de la vie en société… et c’est sans doute pour cela qu’il est si décrié. C’est aussi ce que j’attendais de comprendre : que propose-t-il à la place ? Il y répond, mais je trouve de manière assez succincte : Stirner remplace la loi (soumission) par une association libre d’égoïstes : la cause n’est pas l’association mais celui qui en fait partie. On multiplie ainsi la puissance, et l’association n’est que temporaire.
Il est persuadé qu’ainsi tout se passera très bien… un peu léger tout de même, car cela laisse la part belle aux prédateurs. Mais en y regardant de plus près, n’est-ce pas ce que l’on fait tous plus ou moins ? derrière les grands principes de l’humanisme, quand on regarde ce que font les gens (l’actualité nous en fait la démonstration tous les jours), n’est-ce pas Stirner qui a raison ?
L’intérêt du livre à mon avis est surtout la mise en évidence de la sujétion de l’homme, que ce soit à la nature, puis à Dieu, puis à l’Homme, puis à l’État (dans l’ordre chronologique). Soyons nous-mêmes, et pas ce que l’on nous demande d’être. C’est la seule manière de s’épanouir complètement, partir de ce qui est en nous (et nous sommes tous unique) et pas de ce qui vient de l’extérieur. J’ai particulièrement aimé la partie où Stirner parle de la révolution française, c’est pour le moins percutant !
Place à quelques extraits pour vous faire une idée…
L’antiquité
« Pour les anciens le monde était une vérité », dit Feuerbach, mais il oublie cette addition capitale : une vérité dont ils cherchaient à trouver la non-vérité et que finalement ils découvrirent effectivement. On comprendra facilement le sens de ces paroles de Feuerbach si on les rapproche de la parole chrétienne sur « la vanité et l’instabilité du monde ». De même que le chrétien ne peut jamais se convaincre de la vanité de la divine parole, qui à mesure qu’on en pénètre les profondeurs doit apparaître au jour plus éclatante et triomphante, de même les anciens de leur côté vivaient dans le sentiment que le monde et les rapports au monde (par exemple les liens du sang) étaient le vrai devant quoi leur moi impuissant devait s’incliner. Or justement les plus hautes valeurs de l’antiquité sont rejetées par les chrétiens comme sans valeur ; ce que ceux-là reconnaissaient comme étant le vrai est flétri par ceux-ci comme vain mensonge : la haute signification de la patrie disparaît et le chrétien doit se considérer comme un « étranger sur cette terre » (Hébreux, XI, 13), le saint devoir de la sépulture, thème d’un chef-d’œuvre comme l’Antigone de Sophocle, est un soin misérable aux yeux des chrétiens : « Que les morts ensevelissent leurs morts » ; l’inviolable vérité des liens de famille est représentée comme une non-vérité dont on ne saurait trop tôt s’affranchir (Marc, X, 39), et ainsi en tout.
Prenons l’époque la plus brillante de l’antiquité, le siècle de Périclès ; alors l’éducation sophistique de l’époque faisait de rapides progrès, et la Grèce traitait comme chose légère ce qui jusque-là avait été pour elle d’une extrême gravité.
Trop longtemps les pères avaient été asservis à la puissance de l’état de choses existant auquel on n’osait toucher, pour que les générations suivantes n’eussent pu apprendre aux amères expériences du passé à prendre conscience d’elles-mêmes. Hardiment les sophistes proclament cette parole fortifiante : « Ne t’en laisse pas imposer », et répandent cette doctrine de lumière : « Éprouve sur tout objet ton intelligence, ta sagacité, ton esprit ; une bonne intelligence bien exercée est un excellent viatique pour traverser le monde, elle nous prépare la meilleure des destinées, la vie la plus agréable ». Ils reconnaissent ainsi dans l’esprit l’arme véritable de l’homme contre le monde. Voilà pourquoi ils tiennent tant à l’habileté dialectique, à la facilité d’élocution, à l’art de la discussion, etc. Ils annoncent que l’esprit doit être employé contre tout, mais ils sont loin encore de la sainteté de l’esprit, car il n’est pour eux que moyen, il ne vaut que comme arme, comme pour les enfants la ruse et l’audace : leur esprit est l’incorruptible intelligence.Aujourd’hui, on appellerait cela l’éducation exclusive de l’intelligence et on y ajouterait cet avertissement : ne formez pas seulement votre intelligence mais aussi votre cœur. C’est ce que fit Socrate. […] C’est pourquoi, dit Socrate, il ne suffit pas d’employer son intelligence à toute chose, mais il importe pour quelle cause on la met en œuvre. Nous dirions aujourd’hui : « On doit servir la bonne cause. » Mais servir une bonne cause, c’est être moral. Par suite, Socrate est le fondateur de l’éthique. […] Vous devez être « de cœur pur », dit Socrate, pour qu’on estime votre sagesse. Dès lors commence la deuxième période de libération de l’esprit grec, la période de la pureté de cœur.
L’expérience quotidienne nous apprend que l’intelligence peut avoir renoncé depuis longtemps à une cause alors que le cœur bat de longues années encore pour elle. Ainsi l’intelligence était à tel point devenue maîtresse des vieilles puissances dominantes qu’il ne restait plus qu’à les chasser du cœur où elles séjournaient tranquillement pour que l’homme en fût définitivement délivré.
Cette guerre fut entreprise par Socrate, la paix n’eut lieu que le jour où le vieux monde mourut.
Avec Socrate commence l’examen du cœur, tout ce qu’il contient est passé au crible. Dans leur dernier et suprême effort, les anciens expulsèrent du cœur tout ce qui en faisait la substance ; ils ne voulurent plus qu’il battît pour quelque chose, — ce fut le fait des sceptiques. Les sceptiques atteignirent pour le cœur à cette même pureté que les sophistes avaient donnée à l’intelligence.
L’éducation sophistique a fait que l’intelligence ne reste plus tranquille devant rien, l’éducation sceptique a fait que le cœur n’est plus ému par rien. […]Et c’est là le résultat du travail gigantesque des anciens que l’homme se connaisse comme un être sans liens avec le monde, — hors du monde, — comme esprit. […]
Les anciens, dans leur lutte avec le monde, dans leurs efforts pour délivrer l’homme des liens pesants qui l’enveloppent et l’attachent à autre chose, en vinrent à chercher la dissolution de l’État et à donner la préférence à tout ce qui d’ordre purement privé. La chose publique, la famille, etc., prises comme rapports naturels, sont d’odieuses entraves qui amoindrissent ma liberté spirituelle.
Les modernes
Il a été dit plus haut « pour les anciens le monde était une vérité ». Maintenant nous devons dire « pour les modernes l’esprit fut une vérité mais sans oublier d’ajouter, comme précédemment, une vérité dont ils cherchaient à saisir la non-vérité qu’ils sont en voie de découvrir réellement.
Le christianisme suit une marche analogue à celle de l’antiquité : jusqu’à la veille de la Réforme, l’intelligence demeure sous la domination des dogmes chrétiens, mais dans le siècle qui la précède elle se lève dans une attitude sophistique et joue avec tous les articles de foi un jeu hérétique. On disait couramment en Italie et principalement à la cour romaine : pourvu que le cœur demeure chrétien, on peut laisser la raison à ses fantaisies.
On était tellement habitué longtemps avant la Réforme aux querelles scolastiques que le pape et nombre d’autres avec lui prirent au début la révolte de Luther pour une querelle de moines. L’humanisme correspond à la sophistique et de même qu’au temps des sophistes la vie grecque était en plein épanouissement (siècle de Périclès), de même l’époque de l’humanisme, ou comme on pourrait dire encore du machiavélisme (l’imprimerie, la découverte de nouveau monde, etc.), fut brillante entre toutes. Le cœur alors était bien loin encore de vouloir se débarrasser de son contenu chrétien.
Comme Socrate, le Réforme prit le cœur au sérieux et on le vit se déchristianiser à vue d’œil. Il allait être bientôt délivré de l’accablant fardeau du christianisme. De jour en jour moins chrétien, le cœur perd la substance sur laquelle il travaille, il ne lui reste qu’une cordialité vide, un amour très général de l’humanité, l’amour des hommes, la conscience de la liberté et « la conscience de soi ».
C’est maintenant seulement que le christianisme est révolu parce que, maintenant, il est dénudé, mort, vide. Le cœur ne s’ouvre plus, ne se laisse plus envahir par rien, il rejette même ce qui pourrait se glisser en lui sans qu’il fût conscient ou « qu’il eût conscience se soi ». Le cœur critique tout de qui le veut pénétrer, impitoyablement, à mort, et n’est capable d’aucune amitié, d’aucune affection (sauf inconsciemment ou par surprise). D’ailleurs qu’y aurait-il à aimer parmi les hommes, quand tous sont égoïstes, qu’aucun n’est homme dans le sens du mot, c’est-à-dire qu’aucun n’est exclusivement esprit ? Le chrétien n’aime que l’esprit. Mais où en trouver un qui ne serait véritablement rien qu’esprit ?
Aimer l’homme en chair et en os ne serait plus une cordialité « spirituelle », ce serait une trahison à la cordialité « pure », à « l’intérêt théorique ». Car il ne faut pas s’imaginer que la pure cordialité soit seulement cette aimable disposition qui vous fait serrer la main à tout le monde. La pure cordialité n’est cordiale envers personne, elle est seulement une sympathie théorique, un intérêt que l’on porte à l’homme en tant qu’homme et non pris comme personne. La personne lui est antipathique parce qu’elle est « égoïste », parce qu’elle n’est pas l’homme, cette idée. Mais c’est seulement pour l’idée qu’il y a un intérêt théorique. Pour la pure cordialité ou la pure théorie, les hommes n’existent que pour être critiqués, honnis et foncièrement méprisés. Pour elle, comme pour le prêtre fanatique, ils ne sont rien qu’immondices et autres choses du même goût.
Ayant atteint cette pointe extrême de la cordialité qui n’a d’intérêt pour rien, nous devons apprendre finalement que l’esprit, qui est l’objet unique de l’amour du chrétien, n’est rien ou que l’esprit est un mensonge.
Tout cela présenté brièvement et quelque peu incompréhensible encore s’éclairera, espérons-le, dans les développements ultérieurs.Les anciens servaient, comme nous l’avons vu, le naturel, le temporel, l’ordre établi dans la nature, mais ils se demandaient continuellement s’ils ne pouvaient se dispenser de ce service et après qu’ils eurent fait des efforts surhumains pour s’en affranchir, à leur dernier soupir, le Dieu « vainqueur du monde » naquit. Toute leur action n’avait pas été autre chose que « philosophie », effort pour découvrir le monde et le dépasser. et qu’est-ce la sagesse des nombreux siècles qui suivent ? Qu’est-ce que les modernes ont cherché à découvrir ? Non plus le monde, les anciens l’avaient déjà fait, mais Dieu que les anciens leur avaient légué, Dieu « qui est esprit », qui est tout, et enfin tout ce qui appartient à l’esprit, toute spiritualité. Mais cette activité de l’esprit « qui sonde même les profondeurs de Dieu », c’est la théologie. Ainsi les anciens n’ont rien de plus à nous montrer que la philosophie, les modernes ne vont pas plus loin que la théologie. Nous verrons plus tard que même les révoltes les plus récentes contre Dieu ne sont rien que les efforts extrêmes de la théologie, c’est-à-dire des insurrections théologiques.
À propos de Néron
Un Néron aux yeux des « bons » n’est qu’un « mauvais » homme ; aux miens, ce n’est pas autre chose qu’un possédé, comme les « bons », aussi. Les « bons » voient en lui un scélérat fieffé et l’attribuent à l’enfer. Pourquoi son arbitraire ne trouva-t-il aucun obstacle ? Pourquoi tout lui fut-il permis ? Valaient-ils mieux que lui ces Romains domestiqués qui subirent toutes les volontés d’un pareil tyran ? Les vieux Romains ne fussent jamais devenus ses esclaves et l’eussent aussitôt exécuté. Mais, parmi les romains d’alors, les « bons » se contentaient de lui opposer les exigences de la morale, au lieu d’opposer leur volonté ils soupiraient parce que leur empereur ne rendait pas hommage à la vertu : eux-mêmes demeuraient des sujets vertueux, jusqu’à ce qu’enfin l’un d’eux trouva le courage d’abandonner ce rôle de « sujet vertueux et obéissant ». Alors ces mêmes « bons Romains » qui avaient supporté en citoyens soumis toutes les hontes réservées aux hommes sans volonté crièrent d’allégresse devant l’acte criminel et immoral du révolté. Où donc était chez eux ce courage révolutionnaire qu’ils estimaient maintenant qu’un autre avait osé l’avoir ? Ils ne pouvaient pas avoir ce courage, car une révolution et même une insurrection est toujours quelque chose d' »immoral », à quoi on ne peut se décider que quand on cesse d’être « bon » et qu »on devient soit « mauvais », soit ni l’un ni l’autre. Néron n’était pas pire que son temps où il n’y avait qu’une alternative : être bon ou mauvais. Son temps devait penser de lui : il est mauvais, au sens le plus complet du mot, ce n’est pas un tière, mais un méchant achevé. Tous les gens moraux ne peuvent que porter ce jugement. Des gredins de son espèce il s’en trouve encore aujourd’hui de temps à autre parmi les gens moraux (voir les Mémoires du chevalier de Lang). Sous de tels scélérats, on ne respire pas à l’aise, car en aucun instant on n’est assuré de sa vie, mais vit-on plus aisément sous le gouvernement des gens moraux ? On n’est pas plus assuré de sa vie, sauf que l’on est pendu « suivant les formes du droit », on est du moins sûr de son honneur, et les couleurs nationales flottent en évidence. Le rude poing de la morale impitoyable sur les nobles manifestations de l’égoïsme.
À propos de l’éducation
Qui donc, plus ou moins consciemment, n’a pa remarqué que toute notre éducation a pour objet de faire naître en nous des sentiments, de nous les suggérer au lieu de laisser ce soin à nous-mêmes quoi qu’il en arrive ? Entendons-nous le nom de Dieu, nous devons ressentir en nous la crainte divine ; celui de sa Majesté le roi, nous éprouvons les sentiments de respect, vénération, soumission ; le nom de la morale, nous pensons à quelque chose d’inviolable ; le nom du Mauvais, nous tremblons, etc. C’est à ces sentiments que l’on tend et quiconque par exemple éprouverait de la satisfaction aux actes du « Mauvais » devra être « fouetté ». Ainsi bourrés de sentiments suggérés nous paraissons aux portes de la majorité et sommes déclarés « majeurs ». Notre équipement consiste en « sentiments élevés, pensées sublimes, maximes inspiratrices, éternels principes, etc. ». On pousse les jeunes en troupeau à l’école afin qu’ils apprennent les vieilles ritournelles et quand ils savent par cœur le verbiage des vieux, on les déclare « majeurs ».
À propos de la hiérarchie
On divise parfois les hommes en deux classes, les gens cultivés et ceux qui ne le sont pas. Les premiers, tant qu’ils furent dignes de leur nom, s’occupèrent de pensées, de choses de l’esprit. La pensée étant le principe du christianisme, avec l’ère chrétienne ils devinrent les maîtres, et ils exigèrent, pour les pensées par eux reconnues, soumission et respect. L’État, l’empereur, Dieu, la morale, l’ordre, etc., sont des pensées de ce genre ou des esprits qui n’existent que pour l’esprit. Un être qui se contente de vivre, un animal, ne s’en inquiète pas plus qu’un enfant. L’homme inculte, en réalité, n’est pas autre chose qu’un enfant, et celui qui ne connaît que ses besoins naturels a pour ces esprits une parfaite indifférence ; mais aussi parce qu’il est faible contre eux, il succombe sous leur puissance et est dominé par la pensée. Tel est le sens de la hiérarchie.
La hiérarchie, c’est la domination de la pensée, la suprématie de l’esprit.
Le mépris chrétien du monde
« Quand le monde disparaîtrait, nous n’aurions pas peur » (psaume XLVI, 3). En somme, le champ est préparé pour la doctrine que le monde est vain, pour le mépris chrétien du monde.
En fait, l’histoire des temps antiques se clôt sur ce fait que j’ai atteint ma propriété dans le monde. « Toutes les choses me sont données par mon père » (Matthieu, XI, 27). Le monde a cessé vis-à-vis de moi d’être supérieur en puissance, inaccessible, sacré, divin, il a perdu son caractère céleste et je le traite suivant mon bon plaisir, au point qu’il dépendrait absolument de moi d’exercer sur lui tous mes pouvoirs miraculeux, c’est-à-dire la puissance de mon esprit ; déplacer des montagnes, ordonner aux mûriers de s’arracher eux-mêmes et d’aller se planter dans la mer (Luc, XVII, 6), enfin faire tout ce qu’il est possible de faire, c’est-à-dire tout ce qu’on peut imaginer : « Toute chose est possible à qui a la foi » (Marc, IX, 23). Je suis le maître du monde. La « souveraineté » m’appartient. Le mode est devenu prosaïque, car le divin a disparu de lui : il est ma propriété dont je dispose comme je (c’est-à-dire l’Esprit) l’entends.
Je me suis donc élevé à posséder le monde ; ç’a été la première complète victoire de l’égoïsme, il avait vaincu le monde, il s’en était délivré, et enfermait sous de solides serrures l’héritage d’une longue suite de générations.
La première propriété, la première « souveraineté », est conquise.
Cependant, le maître du monde n’est pas encore maître de ses pensées, de ses sentiments, de sa volonté : il n’est pas maître et possesseur de l’esprit, car l’esprit est encore sacré, il est le « Saint-Esprit », et le chrétien qui s’est délivré du monde ne peut pas se délivrer de Dieu. Si l’antique combat fut dirigé contre le monde, le combat médiéval (chrétien) fut la lutte conte soi, contre l’esprit ; si le premier eut pour objet le monde extérieur, le second s’attaqua au monde intérieur ; c’est « le retour sur soi-même », l’examen réfléchi, la méditation.
Toute la sagesse des anciens est philosophie ou sagesse du monde, toute sagesse des modernes est théologie.
Les anciens (y compris les juifs) en avaient fini avec le monde, il s’agissait maintenant d’en finir avec soi-même, avec l’esprit, c’est-à-dire de se libérer de l’esprit ou de Dieu.
L’État
Quand, au XVIIIème siècle, on eut vidé jusqu’à la lie le calice de la soi-disant royauté absolue, on s’aperçut trop bien que le breuvage qu’il contenait n’avait pas goût humain pour ne pas jeter des regards de convoitise sur une autre coupe. Nos pères étaient des « hommes » et ils finirent pas désirer être pris comme tels.[…]
Unissons-nous donc et que chacun de nous défende l’homme chez les autres ; nous trouverons dans notre union la protection nécessaire et nous formerons, alliés, une communauté d’hommes conscients de leur dignité d’hommes et unis comme « hommes ». Notre union c’est l’État, et nous sommes, nous les alliés, na nation.L’homme véritable, c’est la nation, mais l’homme isolé est constamment un égoîste. Donc faites abstraction de votre personnalité, de votre individualité isolée, en laquelle demeurent l’inégalité égoïste et la discorde, et consacrez-vous tout entier à l’homme véritable, à la nation, l’État. Alors vous serez estimés comme hommes et vous aurez tout ce qui est le propre de l’homme ; l’État, l’homme vrai, vous reconnaîtra ses privilèges et vous donnera « les droits de l’homme ». L’homme vous donne ses droits !
Ainsi parle la bourgeoisie.
Le régime bourgeois se résume en cette pensée que l’État, c’est l’homme vrai et que la valeur humaine de l’individu consiste à être un citoyen de l’État. Il met tout son honneur à être un bon citoyen, au-dessus il ne connait rien, tout au plus cette vieillerie, — être un bon chrétien.
La révolution française
La propriété fut la matière essentiellement inflammable qui fit éclater l’incendie de la Révolution. Le gouvernement avait besoin d’argent, il était mis en demeure de prouver le principe que le gouvernement est absolu, et par conséquent seul maître de toute propriété, seul propriétaire. Il devait reprendre son argent qui se trouvait être la possession mais non la propriété de ses sujets. Au lieu de cela il convoque les états généraux, pour se faire accorder cet argent. On n’osa pas pousser la logique jusqu’au bout et l’illusion du pouvoir absolu fut détruite ; celui qui se fait « accorder » quelque chose ne peut pas être considéré comme absolu. Les sujets reconnurent qu’ils étaient propriétaires véritables et que c’était leur argent que l’on voulait. Ceux qui avaient été jusque-là sujets parvinrent à la conscience qu’ils étaient propriétaires. Bailly dépeint en peu de mots la situation : « Si vous ne pouvez disposer de ma propriété sans mon consentement, à plus forte raison ne pouvez-vous disposer de ma personne, ni de tout ce qui se rapporte à mon être moral et social. Tout cela est ma propriété comme la pièce de terre que je cultive et j’ai un droit, un intérêt à faire moi-même les lois ». Les paroles de Bailly laissent entendre que chacun était propriétaire. Cependant à la place du gouvernement, à la place du prince, ce fut la nation qui devint propriétaire et souveraine. Désormais l’idéal s’appellera « Liberté du peuple », « Un peuple libre », etc.
La bourgeoisie est l’héritière des classes privilégiées. En fait les droits des barons qui leur furent confisqués comme « usurpés » ne firent que passer à la bourgeoisie. Car la bourgeoisie s’appelait maintenant « la nation ». Tous les privilèges furent « remis aux mains de la nation ». Ils cessèrent ainsi d’être des privilèges : ce furent des « droits ». C’est la nation maintenant qui perçoit la dîme, qui exige les corvées, elle a hérité des cours de justice nobles, du droit de chasse, des serfs. La nuit du 4 août fut la nuit de mort des privilèges (les villes aussi, les communes, les municipalités, étaient privilégiées, pourvues de droits seigneuriaux et féodaux) ; elle prit fin, une aube nouvelle apparut, celle du droit, des « droits de l’État », des « droits de la nation ».
Le monarque en la personne du « souverain roi » était un bien misérable monarque, comparé au nouveau, à « la nation souveraine ». Cette monarchie était mille fois plus tranchante, plus sévère et plus conséquente. Contre le nouveau souverain il n’y avait plus aucn droit, plus de privilèges ; combien est limité, en comparaison, le « roi absolu » de l’ancien régime. La Révolution transforme la monarchie limitée en monarchie absolue. Désormais tout tout droit qui n’est pas conféré par ce monarque est une « usurpation ». Mais tout privilège qu’il confère est un « droit ».
Qu’était donc devenu l’individu ? Un protestant de la politique, car il était entré en relation directe avec Dieu.
Contre la loi de raison personne ne doit se révolter, autrement on encourt les plus durs châtiments. On veut que ma raison seule — et non pas ma personne ou les miens — se meuve et se manifeste librement ; c’est-à-dire qu’on veut la souveraineté de la raison, une souveraineté.
Liberté politique
« Liberté politique », qu’est-ce que qu’il faut entendre par là ? Sans doute la liberté de l’individu libre de l’État et de ses lois ? Non, au contraire, l’assujettissement de l’individu dans l’État et aux lois de l’État. Mais pourquoi « liberté » ? Parce qu’on n’est plus séparé de l’État par des personnes intermédiaires, mais parce qu’on se trouve en rapport direct et immédiat avec lui, parce qu’on est un citoyen de l’État, parce qu’on n’est pas le sujet d’un autre, pas même du roi, considéré comme personne, car seule sa qualité de « chef de l’État » nous fait ses sujets. La liverté politique, ce point fondamental du libéralisme, n’est pas autre chose qu’une seconde phase du protestantisme et court parallèlement à la « liberté religieuse ».
La liberté de la presse
La liberté de la presse entre autres est une de ces libertés du libéralisme qui ne combat la contrainte de la censure que comme celle de l’arbitre personnel, tandis qu’elle se montre extrêmement encline à exercer la tyrannies par des « lois de presse », en d’autres termes c’est pour eux-mêmes que les libéraux bourgeois veulent la liberté d’écrire ; car, comme ils sont avec la loi, leurs écrits ne les feront pas tomber sous le coup de la loi. On ne peut imprimer que ce qui est libéral, c’est-à-dire légal ; autrement, les lois, les « pénalités de presse » vous menacent. La liberté personnelle paraît assurée, et l’on ne remarque pas, quand une certaine limite est dépassée, que c’est le règne de la plus criante des servitudes. Certes nous sommes affranchis des ordres et personne n’a plus rien à nous commander, mais nous sommes devenus d’autant plus soumis à la loi. Nous sommes maintenant esclaves selon toutes les formes du droit.
Les travailleurs
L’État, c’est l’État bourgeois, c’est la constitution même de la bourgeoisie. Il protège l’homme non pas suivant son travail, mais suivant son obéissance (« loyalisme »), suivant qu’il exerce les droits qui lui sont conférés par l’État, conformément à la volonté, c’est-à-dire aux lois de l’État.
Dans le régime bourgeois, les travailleurs tombent constamment sous le joug des possesseurs, c’est-à-dire de tous ceux qui ont à leur disposition un bien de l’État quelconque (or, tout ce qui est susceptible d’être possédé est bien de l’État, appartient à l’État, et n’est que le fief attribué à l’individu), particulièrement l’argent ou des biens territoriaux, ainsi que le travailleur tombe aux mains des capitalistes. Le travailleur ne peut faire valoir son travail en raison de la valeur qu’il a pour ceux qui en jouissent. « Le travail est mal payé : » Le capitaliste en tire le plus grand profit. Exception seulement pour les travaux de ceux qui contribuent à rehausser l’éclat et la domination de l’État, pour les travaux des hauts fonctionnaires qui sont bien, trop bien payés. L’État paye bien afin que ses « bons citoyens », — la classe possédante, — puissent sans danger mal payer ; il s’assure par de bons traitements ses serviteurs dont il fait une arme de défense pour les « bons citoyens », une « police » (à la police appartiennent les soldats, les fonctionnaires de toutes sortes, par exemple ceux de la justice, de l’instruction publique, etc., bref toute la « machine de l’État »), et les « bons citoyens » lui versent bien volontiers de forts impôts pour pouvoir payer d’autant moins leurs travailleurs.
Mais la classe des travailleurs en ce qui concerne ses intérêts essentiels n’est pas protégée (car ce n’est pas comme travailleurs qu’ils jouissent de la protection de l’État, mais comme sujets qu’ils jouissent de la protection de la police, une prétendue protection légale), aussi demeure-t-elle une force hostile à l’État, à cet État des gens qui possèdent, à cette « royauté » bourgeoise ». Son principe, le travail, n’est pas reconnu à sa valeur, il est exploité, c’est le butin de guerre des possédants, des ennemis.
Les travailleurs ont entre les mains la puissance la plus formidable, s’ils en prenaient une fois conscience et voulaient la mettre en œuvre, rien ne leur résisterait : ils n’auraient qu’à cesse de travailler, qu’à considérer la matière travaillée comme la leur propre et à en jouir. Tel est le sens des agitations prolétaires qui se manifestent de temps à autre.
L’État repose sur l’esclavage du travail. Si le travail devient libre, l’État est perdu.
L’individualisme
À l’antique formule « rendez hommage à Dieu » correspond la formule moderne « rendez hommage à l’homme ». Mais moi je pense qu’il vaut mieux conserver pour moi cet honneur. […]
Parmi les théories sociales, la Critique est incontestablement la plus achevée, parce qu’elle éloigne et déprécie tout e qui sépare l’homme de l’homme ; tous les privilèges jusqu’au privilège de la foi. En elle, le principe d’amour du christianisme, le vrai principe social arrive à sa réalisation la plus pure, en elle est fait le dernier effort possible pour détruire chez les hommes l’exclusivisme et le parti pris de repousser : combat contre l’égoïsme,sous la forme la plus simple et la plus dure, l’exclusivisme, l’individualisme.
« Comment pouvez-vous véritablement vivre en société, tant qu’il existe parmi vous un tel exclusivisme ? »
Je demande au contraire : comment pouvez-vous vraiment êtres uniques tant qu’il existe entre vous un seul rapport ? Si vous avez ensemble connexion, vous ne pouvez vous séparer, su un « lien » vous attache ensemble, vous n’êtes quelque chose qu’ensemble ; et vos douze font une douzaine, vos mille font un peuple, vos millions l’humanité !
« Ce n’est que quand vous êtes humains que vous pouvez, comme hommes, avoir des relations avec les autres, de même que c’est seulement si vous êtes patriotes, que vous pouvez comme patriotes vous comprendre. » Parfait ! Et moi je réponds : « C’est seulement si vous êtes uniques que vous pouvez comme tels avoir des rapports ensemble. »La proposition « Dieu est devenu Homme » s’est transformée en celle-ci : « l’Homme est devenu Moi ». Ce Moi est le moi humain. Mais nous, nous renversons la proposition et disons : je n’ai pu me trouver tant que je me suis cherché comme homme ; mais maintenant il apparaît que l’homme cherche à devenir Moi et à acquerir en Moi une corporalité, je remarque bien pourtant que tout dépend de Moi, et que l’homme sans Moi est perdu. Mais je ne puis consentir à me faire le tabernacle de ce Très-Saint et ne m’inquiéterai pas à l’avenir de savoir si mon activité réalise l’homme ou le non-homme : qu’on me délivre de cet esprit importun.
Je ne veux rien reconnaître ou respecter en toi, ni le propriétaire ni le gueux, pas même l’homme, mais de toi je veux seulement user. Je trouve que le sel donne du goût à mes aliments, c’est pourquoi je l’y mêle, je reconnais que le poisson est une chair excellente, c’est pourquoi je m’en nourris, en toi je découvre le don d’égayer la vie, c’est pourquoi je te choisis pour compagnon. Ou bien j’étudie dans le sel la cristallisation, dans le poisson, l’animalité, en toi, l’homme, etc., pour moi tu n’es que ce que tu es pour moi, c’est-à-dire mon objet, et, parce que mon objet, ma propriété.
Le communisme
De son côté, le communisme, par l’abolition de toute propriété individuelle, me rejette encore plus sous la dépendance d’autrui — la généralité ou la totalité — et bien qu’il attaque violemment l’État, son intention est d’établir aussi son État, un status, un état de choses qui paralyse mon activité libren une autorité souveraine sur moi. Contre l’oppression que je subis de la part des propriétaires individuels, le communisme se soulève de plein droit, mais plus terrible encore est la puissance qu’il met aux mains de la toatlité.
Association d’égoïstes
C’est pourquoi nous sommes tous deux, l’État et moi, ennemis. Moi, l’égoïste, je ne m’inquiète guère du bien de « cette société humaine » ; je ne lui sacrifie rien, je l’utilise seulement ; mais pour pouvoir l’utiliser complètement, je la transforme aussitôt en ma propriété, en ma créature, c’est-à-dire que je l’annihile et crée à sa place une association d’égoïstes.
Max Stirner (1806-1856) est un philosophe allemand, considéré comme un des précurseurs de l’existentialisme et de l’anarchisme individualiste, bien qu’il ait lui-même toujours refusé le qualificatif d’anarchiste. Son livre fut violemment critiqué par Marx, et considéré par d’autres comme l’acte de décès de la philosophie… Stirner finira sa vie dans la misère, allant deux fois en prison pour dettes.
