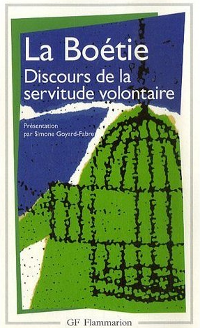 Ce texte d’Étienne de La Boétie est souvent cité comme une référence, je l’avais donc mis sur ma liste. S’il ne fait en lui-même qu’à peine quarante pages, l’introduction de Simone Goyard-Fabre en fait plus de cent vingt, donnant un peu d’épaisseur au livre.
Ce texte d’Étienne de La Boétie est souvent cité comme une référence, je l’avais donc mis sur ma liste. S’il ne fait en lui-même qu’à peine quarante pages, l’introduction de Simone Goyard-Fabre en fait plus de cent vingt, donnant un peu d’épaisseur au livre.
Cette introduction est très intéressante, décrivant très bien ce qu’est Le Discours et ce qu’il n’est pas, sa date de composition incertaine, donnant le contexte historique, etc… C’est toujours un peu frustrant de lire 120 pages à propos d’un texte que l’on s’apprête à lire, mais c’est assez réussi cette fois.
Le Discours a également été appelé le Contr’un : selon La Boétie, la tyrannie est fondamentalement et essentiellement monocratie : l’autorité d’un seul. Dès lors, l’important n’est pas de poser l’origine du pouvoir ; c’est d’en examiner l’exercice. Et cet exercice, puisqu’il ne peut être « public », est nécessairement mauvais, ne répondant pas à l’essence du politique.
La « république » — entendons la res publica (la chose publique) — doit avoir un caractère « public », qui est, comme tel, irréductible à des rapports privés comme le sont les rapports domestiques ou les rapports de patronage.
Mais le tyran n’est pas le seul responsable, les peuples se laissant volontiers asservir :
Paresse native qui est comme sa seconde nature : si la nature de l’homme est bien d’être franc [libre] et de le vouloir être, mais aussi sa nature est telle que naturellement il tient le pli que la nourriture [l’habitude] lui donne.
Aspiration à la liberté et tendance à la paresse s’affrontent donc en l’homme… si l’on regarde notre société de consommation et de divertissement, cette remarque n’a pas pris une ride. À croire que nos gouvernants sont au courant !
Pour La Boétie, il y a une « dé-naturation » à la fois de l’homme qui aspire naturellement à la liberté et du tyran qui devrait gouverner pour le bien de tous. Il ne l’explique malheureusement pas.
« Le XVIème siècle ouvre l’âge moderne » (P. Villey) : cette formule s’applique parfaitement au texte de La Boétie. Il annonce probablement l’âge des Lumières, une première pensée en dehors du dogme théologique et de la royauté de droit divin, ainsi qu’un vibrant appel à la liberté des peuples.
En voici un bon résumé, tiré de l’introduction :
D’un bout à l’autre du Discours, une idée-force porte l’élan du verbe : La Boétie — comme Machiavel devant les désordres de l’Italie ou Thomas More devant la misère de l’Angleterre — dénonce la maladie à laquelle s’abandonnent les peuples sous le joug de leurs maîtres et il s’interroge sur la thérapeutique qui ferait cesser de tels maux. Il entreprend donc d’analyser et d’expliquer la servitude des peuples à la fois par les tendances de la nature humaine et par le rôle néfaste des tyrans et de leurs complices ; puis, s’interrogeant sur les remèdes qui enrayeraient le mal endémique qui risque de conduire l’humanité à une mort prochaine, il lance, à l’adresse des peuples qui se laissent asservir et des principes qui se plaisent à les asservir, un appel au bon sens dans lequel vibre le sens de la liberté.
Le texte est écrit 15 ans après Le Prince de Machiavel et certains y ont vu une réponse de La Boétie : tandis que Le Prince codifie la tyrannie, le Discours énonce la revendication de la liberté.
Mais tous deux sont des penseurs de la modernité attentifs et expriment le rapport de la condition humaine non plus à l’ordre de la divinité, mais à l’ordre de l’humanité.
Car il refuse que le pouvoir politique soit fondé en Dieu, que le prince soit un lieutenant de Dieu sur terre. Cette politique de la verticalité n’est pour lui qu’une fable. Mais alors, s’il n’appartient qu’à l’homme de gouverner la terre des hommes, il lui appartient de déterminer lui-même sa condition : il est responsable de son sommeil dogmatique et de sa servitude, comme il est responsable de son réveil et de sa liberté.
La Boétie ne remet pas en cause l’existence de Dieu (à l’époque, ça peut rapporter le bûcher !), ni ne s’attaque pas de manière frontale à la religion. Il se permet toutefois une hypothèse à propos du droit divin de la monarchie : « et encore, quand cela n’y serait pas… », et milite pour la République (la « res publica », la chose publique), ce qui pour l’époque ne manque ni de courage ni de lucidité.
Pour autant, le rôle de la religion servant le tyran est clairement évoqué. Le dernier paragraphe du texte en est d’autant plus inattendu puisqu’il s’en remet à Dieu et à son châtiment pour les tyrans. Peut-être une clause de prudence ?
Extraits du Discours
J’adore le début, il cite Homère, et cela donne une idée de la tournure des phrases :
D’avoir plusieurs seigneurs aucun bien je n’y voi :
Q’un, sans plus, soit le maître et qu’un seul soit le roi.ce disait Ulysse en Homère, parlant en public. S’il n’eût rien dit de plus, sinon :
D’avoir plusieurs seigneurs aucun bien je n’y voi.
c’était autant bien dit que rien plus ; mais, au lieu que, pour le raisonner, il fallait dire que la domination de plusieurs ne pouvait être bonne, puisque la puissance d’un seul, dès lors qu’il prend ce titre de maître, est dure et déraisonnable, il est allé ajouter, tout au rebours :
Qu’un, sans plus, soit le maître, et qu’un seul soit le roi.
Il en faudrait, d’aventure, excuser Ulysse, auquel, possible, lors était besoin d’user de ce langage pour apaiser la révolte de l’armée; conformant, je crois, son propos plus au temps qu’à la vérité.
La Boétie ne prêche pas pour la révolution, c’est pour lui inutile, il suffit de refuser le système :
Encore ce seul tyran, il n’est pas besoin de le combattre, il n’est pas besoin de le défaire, il est de soi-même défait, mais que le pays ne consente à sa servitude ; il ne faut pas lui ôter rien, mais ne lui donner rien ; il n’est pas besoin que le pays se mette en peine de rien faire pour soi, pourvu qu’il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples mêmes qui se laissent ou plutôt se font gourmander, puisqu’en cessant de servir ils en seraient quittes ; c’est le peuple qui s’asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix ou d’être serf ou d’être libre, quitte la franchise et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt le pourchasse.
Plus dangereuse est la nature de l’homme à se laisser asservir :
Il est vrai qu’au commencement on sert contraint et vaincu par la force ; mais ceux qui viennent après servent sans regret et font volontiers ce que leurs devanciers avaient fait par contrainte. C’est cela, que les hommes naissant sous le joug, et puis nourris et élevés dans le servage, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés, et ne pensent point avoir autre bien ni autre droit que ce qu’ils ont trouvé, ils prennent pour leur naturel l’état de leur naissance.
Ainsi la première raison de la servitude volontaire, c’est la coutume : comme les plus braves courtauds [chevaux], qui au commencement mordent le frein et puis s’en jouent, et là où naguère ruaient contre la selle, ils se parent maintenant dans les harnais et tout fiers se gorgiassent sous la barde.
Et le tyran sait parfaitement en tirer partie :
La Boétie raconte l’histoire du tyran Cyrus le Grand (fondateur de l’Empire perse) qui pour tenir en main les Sardains qui se révoltaient, installa des tavernes et des jeux publics plutôt que d’y maintenir une armée : le peuple ne se révolta plus…
Ainsi les peuples, assotis, trouvent beaux ces passe-temps, amusés d’un vain plaisir, qui leur passait devant les yeux, s’accoutumaient à servir aussi niaisement mais plus mal, que les petits enfants qui, pour voir les luisantes images des livres enluminés, apprennent à lire.
Toujours le populaire a eu cela : il est, au plaisir qu’il ne peut honnêtement recevoir, tout ouvert et dissolu, et, au tort et à la douleur qu’il ne peut honnêtement souffrir, insensible.
La religion fait quant à elle bon ménage avec les tyrans :
Les tyrans mêmes trouvaient bien étrange que les hommes pussent endurer un homme leur faisant mal ; ils voulaient fort se mettre la religion devant pour garde-corps, et, s’il était possible, emprunter quelque échantillon de la divinité pour le maintien de leur méchante vie.
Reste bien sûr les profiteurs et autres ambitieux sans qui rien ne serait possible :
Mais maintenant je viens à un point, lequel est à mon avis le ressort et le secret de la domination, le soutien et le fondement de la tyrannie. […] Ce sont toujours quatre ou cinq qui maintiennent le tyran, quatre ou cinq qui tiennent tout le pays en servage. Toujours il a été que cinq ou six ont eu l’oreille du tyran, et s’y sont approchés d’eux-mêmes, ou bien ont été appelés par lui, pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les maquereaux de ses voluptés, et communs aux biens de ses pilleries. […] Ces six ont six cents qui profitent sous eux, et font de leur six cents ce que les six font au tyran. Ces six cents en tiennent sous eux six mille, qu’ils ont élevés en état, auxquels ils font donner ou le gouvernement des provinces, ou le maniement des deniers afin qu’ils tiennent la main, à leur avarice et cruauté et qu’ils l’exécutent quand il sera temps, et fassent tant de maux d’ailleurs qu’ils ne puissent durer que sous leur ombre, ni s’exempter que par leur moyen des lois et de la peine.
Pareillement, dès lors qu’un roi s’est déclaré tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne dis pas un tas de larroneaux et essorillés, qui ne peuvent guère en une république faire mal ni bien, mais ceux qui sont tâchés d’une ardente ambition et d’une notable avarice, s’amassent autour de lui et le soutiennent pour avoir part au butin, et être, sous le grand tyran, tyranneaux eux-mêmes.
Étienne de La Boétie (1530-1563) était un écrivain humaniste et un poète français. La Boétie est célèbre pour son Discours de la servitude volontaire. Il fut un grand ami de Montaigne, qui lui rendit hommage y compris dans ses Essais.
